Support de cours d’introduction au commerce equitable
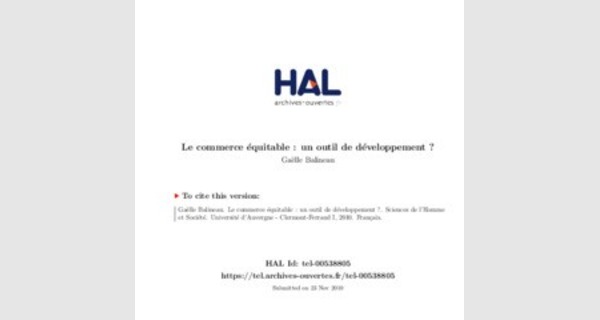
Support de cours d’introduction au commerce équitable
- Histoire du commerce équitable1 Le développement des réseaux de commerce équitable ne s’est pas effectué de manière linéaire. D’un point de vue institutionnel, ils trouvent leurs racines dans de multiples initiatives humanitaires et solidaires de l’après-Seconde Guerre Mondiale (sous-section 1.1). D’un point de vue politique en revanche, ils sont ancrés dans ce que Fridell (2004) appelle plus largement le mouvement « commerce équitable », qui revendique depuis l’entre-deux guerres une régulation des marchés internationaux en faveur des pays les plus pauvres (sous-section 1.2). À partir de ces prémisses institutionnelles et politiques, le développement des organisations de commerce « alternatif » s’est effectué de manière relativement disparate et désordonnée (sous-section 1.3). Ce n’est qu’{ la fin des années 1980 que le mouvement alternatif, alors relativement marginal tant du point de vue de la consommation que de la portée des idées politiques, a commencé à se structurer autour de divers réseaux. C’est également { ce moment l{ que l’idée de la labellisation est née, permettant { la consommation de produits équitables d’augmenter considérablement au cours des décennies 1990 et 2000 (sous-section 1.4).
1.1. Le commerce « solidaire », religieux et humanitaire de l’après-Seconde Guerre Mondiale On a coutume de faire débuter l’histoire du commerce équitable aux États-Unis, avec les initiatives solidaires de deux associations chrétiennes anabaptistes mennonites : SERRV International (Sales Exchange for Refugee Rehabilitation Vocation) et Ten Thousand Villages (Diaz Pedregal, 2007, p.104). Issus de la Réforme protestante du 16ème siècle, les mennonites revendiquent une attitude non violente et un fort engagement pour la paix. Leurs pratiques n’ayant pas toujours été acceptées par les chrétiens, les mennonites ont connu la persécution, l’immigration et de nombreux déplacements2. Ils sont donc particulièrement sensibles aux communautés humaines en souffrance. En 1946, lorsque Ten Thousand Villages entreprend de commercialiser des objets artisanaux issus de Porto Rico, de Palestine et d’Haïti, le commerce direct avec des communautés pauvres des pays du Sud devient une des façons de concrétiser leur engagement religieux d’aide aux plus démunis. L’objectif principal de ces organisations religieuses et solidaires est de générer de l’emploi et de meilleurs revenus grâce au commerce. Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, cette idée selon laquelle le commerce, la solidarité et le développement pouvaient être liés était tout à fait nouvelle (ibid., p.105).
L’Europe n’y est pas restée étrangère. L’organisation qui représente le mieux cette solidarité humanitaire et religieuse est sans doute Oxfam (Oxford Committee for Famine Relief). Oxfam a été créée en Grande-Bretagne en 1942 par des membres du mouvement chrétien Quaker (entre autres). Sa première action fut de militer pour l’envoi de vivres en Grèce, pays alors occupé par l’Allemagne nazie et ravagé par la famine. C’est en 1949 que l’association a commencé à vendre des objets artisanaux fabriqués par des réfugiés chinois de Hong Kong. Cependant, son action s’est très vite démarquée d’un pur soutien caritatif et humanitaire : il s’agissait certes d’aider concrètement les populations défavorisées, mais également d’informer les citoyens sur les causes de ces situations de détresse et de pauvreté. Ainsi Oxfam a-t-elle rapidement associé la consommation de produits issus de communautés défavorisées { l’information sur ces populations, relayant de facto les revendications pour plus de justice et d’équité dans les relations internationales. Cette inflexion dans la stratégie d’Oxfam reflète l’émergence d’un discours politique autour des échanges internationaux, particulièrement influencé par le mouvement tiers-mondiste. La sous-section suivante revient sur les éléments qui ont accompagné le passage progressif du « commerce solidaire » à un commerce aussi et surtout « alternatif ».
1.2. Les années 1960-1970 : la structuration d’un discours politique Dans les années 1960 et 1970, les organisations de commerce solidaire ont commencé à porter un certain nombre de revendications concernant l’organisation des échanges internationaux. Pour Fridell (2004), cette orientation politique est le reflet d’un plus large mouvement qui milite en faveur d’un commerce régulé de manière « équitable », dont les prémisses peuvent être situées dans l’entre-deux-guerres ; et qui a atteint son « apogée » dans les années 1970 (ibid., p.416).

1.2.1. Prémisses et développement du « mouvement » équitable Les premières tentatives de régulation des marchés internationaux ont eu lieu entre 1918 et 1939, alors que les prix de certains produits comme le café, le blé, le sucre et le coton déclinaient fortement par rapport à ceux des produits manufacturés (surtout dans la période 1929-1938, marquée par la crise de 1929 et la baisse subséquente de la demande mondiale, voir Guillaumont, 1985, p.56). Un bon nombre de mesures, basées pour la plupart sur un contrôle de la production, ont donc été mises en place pour tenter de maintenir le cours des matières premières à un niveau satisfaisant. À la suite de la Deuxième Guerre Mondiale, les négociations concernant la régulation des échanges internationaux se sont concentrées sur la lutte contre les politiques protectionnistes, alors perçues comme en partie responsables du chaos économique des années 1930, et de la montée concomitante du fascisme et du nazisme (Fridell, 2004, p.413).
Cependant, la volonté de mettre en place des mécanismes visant à protéger les nations les plus fragiles des fluctuations du marché mondial n’a pas été abandonnée : en 1948, les réflexions menées dans le cadre de la conférence de la Havane1 ont établi les fondements d’une régulation du cours des matières premières. Jusqu’aux années 1960, la baisse du cours des matières premières donna lieu { la signature de toute une série d’accords destinés à contrôler le cours des produits de base (sucre, étain, blé). Cependant, la plupart d’entre eux ne furent pas suivis des effets escomptés, pour des raisons d’économie politique surtout. Fridell (2004, p.414) attribue ainsi l’échec de l’accord sur le sucre dans les années 1960 au boycott des États-Unis sur le sucre cubain, et celui de l’accord sur le café en 1989 au désaccord entre le Brésil et les États-Unis à propos des quotas. L’échec de ces accords conduisit les pays exportateurs de matières premières { formuler deux revendications clés lors de la première Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED) en 1964 : premièrement, ils appelèrent les pays du Nord à mettre fin à leurs politiques protectionnistes, perçues comme néfastes pour les pays du Sud.
Deuxièmement, ils demandèrent que l’aide fournie par le Fonds Monétaire International (FMI) et par les pays du Nord, souvent accusée de ne financer que des « éléphants blancs »2 (voire de ne servir que les intérêts des pays colonisateurs), soit remplacée par des subventions pour les producteurs du Sud. Le slogan « Trade, not aid ! », lancé lors de la CNUCED de 1964, résume la philosophie du mouvement équitable. Depuis, les réseaux de commerce équitable se sont appropriés ce slogan, ainsi que les revendications qu’il symbolise. L’OCE qui reflète le mieux cette prise de position est l’association Fair Trade Original3. Créée en 1959 par de jeunes catholiques aux Pays-Bas, cette association alors tiers-mondiste a très tôt fait le lien entre démarche caritative et dénonciation des règles du commerce international. Cela s’est concrétisé par le lancement d’une campagne contre les mesures protectionnistes européennes envers la betterave à sucre et leurs effets néfastes sur les producteurs de canne à sucre dans les pays du Tiers-monde : « en achetant du sucre de canne, vous faites pression sur les gouvernements des pays riches pour qu’ils laissent aux pays pauvres une place au soleil de la croissance » était alors l’un des mots d’ordre de l’association (Habbard et al., 2002, p.5).
1.2.2. Les fondements des revendications : tiers-mondisme et échange inégal La critique de l’aide au développement d’une part, et celle des règles du commerce international d’autre part, sont ancrées dans le tiers-mondisme. On peut situer la naissance de ce mouvement en 1955 : trois ans après qu’Alfred Sauvy a proposé l’expression « Tiers-monde » pour désigner l’ensemble des pays pauvres, les 29 pays d’Afrique et d’Asie qui participèrent { la conférence de Bandung (en Indonésie) lui donnèrent un sens légèrement différent. Ils définirent le Tiersmonde non pas comme un ensemble de pays pauvres, mais par opposition aux deux autres « mondes » d’alors : le bloc américain d’une part, et le bloc soviétique d’autre part.

La résolution finale de la conférence, qui dénonce notamment le colonialisme et l’impérialisme des grandes puissances, acheva de donner une dimension politique et internationale au tiers-mondisme. Plusieurs influences ont nourri le mouvement tiers-mondiste : selon Diaz Pedregal (2007, p.107), il s’enracine d’abord dans la tradition humaniste chrétienne. Ensuite, d’un point de vue politique, l’idéologie marxiste est très perceptible dans la lutte que le tiers-mondisme propose de mener contre l’impérialisme et la colonisation des peuples. Elle se ressent également dans la remise en cause de la théorie classique du libre-échange qui conduirait à « l’exploitation » des pays du Tiers-monde par les pays industrialisés (ibid.). Dans les années 1950-1960, cette critique de la théorie ricardienne par les tenants du tiers-mondisme est d’autant plus virulente qu’elle trouve un support théorique dans la thèse de la dégradation des termes de l'échange de Prebisch (1950, 1959) et Singer (1950), et dans celle de l’échange inégal (Emmanuel, 1969 ; Amin, 1973).
…
- Le commerce équitable aujourd’hui
2.1. Définitions et principes d’action1
Entre 1999 et 2001, lors de réunions informelles, les quatre réseaux internationaux évoqués dans la section précédente ont mis au point une charte commune sur le commerce équitable. Adopté en décembre 2001, cet accord est communément appelé « le consensus FINE », où FINE est l’acronyme des premières lettres des organisations ayant pris part à sa rédaction : FLO-Int, IFAT (renommée WFTO depuis peu, cf. supra), NEWS et EFTA. Selon ce consensus,

« Le Commerce Équitable est un partenariat commercial, fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, dont l’objectif est de parvenir { une plus grande équité dans le commerce mondial. Il contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales et en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs marginalisés, tout particulièrement au Sud de la planète. Les organisations du Commerce Équitable (soutenues par les consommateurs) s’engagent activement { soutenir les producteurs, { sensibiliser l’opinion et { mener campagne en faveur de changements dans les règles et pratiques du commerce international conventionnel. »
Bien qu’elle énonce très précisément les objectifs du commerce équitable (« parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial [et] contribuer au développement durable ») ainsi que son mode d’action (« en offrant de meilleures conditions commerciales »), cette définition est peu opérationnelle. Elle a donc été complétée par des principes et critères de base du commerce équitable qui doivent guider l’élaboration des normes de production et de commercialisation des différents réseaux. Le premier principe opère une franche distinction entre, d’une part, les OCE (Organisations de Commerce Équitable), et, d’autre part, les organisations commerciales qui ne sont que partiellement engagées dans le commerce équitable (par l’intermédiaire de la labellisation de produits pour la plupart).
(1) « Les OCE font clairement du commerce équitable leur engagement principal et le cœur de leur activité. Elles se distinguent des autres organisations partiellement engagées dans le commerce équitable par : i) la fourniture d’un soutien financier, technique et organisationnel aux producteurs, ii) la sensibilisation de l’opinion publique au Nord et au Sud, iii) l’organisation de campagnes en faveur de changements dans les règles et pratiques commerciales conventionnelles »2.
Les autres principes de base précisent les points clés de la définition1 :

(2) « partenariat commercial » : les partenaires commerciaux s’engagent { i) traiter l’ensemble des parties prenantes avec respect, ii) présenter la structure et les comptes de l’organisation de façon transparente, iii) fournir les informations nécessaires pour accéder au marché, iv) maintenir un dialogue constructif et ouvert, v) avoir recours au dialogue et { l’arbitrage en cas de conflits.
(3) « offrir de meilleures conditions commerciales » passe par i) le paiement d’un prix juste dans le contexte local ou régional, ii) le préfinancement de la production / de la récolte pour éviter l’endettement des organisations de producteurs, iii) la continuité des relations commerciales (engagement à long terme).
(4) « garantir les droits des producteurs et des travailleurs » : les acteurs du commerce équitable s’engagent à i) fournir une rémunération équitable (ce revenu « décent » n’étant pas forcément le revenu minimum en vigueur), ii) respecter les conditions de sécurité, sanitaires et sociales au travail, iii) respecter le droit du travail en vigueur dans le pays et contribuer au respect des droits fondamentaux des travailleurs tels qu’ils sont définis par les Nations Unies, iv) appliquer les normes internationales du travail définies par l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
(5) « contribuer au développement durable » : pour obtenir une amélioration durable des conditions de vie des producteurs et de leurs organisations et promouvoir des pratiques respectueuses de l’environnement, les acteurs du CE s’engagent { i) renforcer les organisations de petits producteurs, ii) au sein de ces organisations, renforcer la participation des producteurs et travailleurs aux prises de décisions, iii) soutenir la formation, l’acquisition de compétences et le développement du capital humain, notamment les femmes, iv) encourager les pratiques respectueuses de l’environnement et les modes de production responsables. Notons que les objectifs de développement et de lutte contre la pauvreté endossés par le commerce équitable le distinguent nettement du commerce solidaire, alternatif ou encore éthique (voir encadré 1.1 ci-après).

…
2.2. Filière intégrée et filière certifiée
En dépit de leur « vision commune », la littérature a coutume de distinguer deux grandes familles institutionnelles du commerce équitable : la filière dite « intégrée » (ou « spécialisée ») et la filière dite « labellisée » (ou « certifiée »). La première est représentée par WFTO. Contrairement aux entreprises (importateurs, industriels, distributeurs) qui ont recours à la certification FLO, les membres de WFTO font tous du commerce équitable leur activité principale. Ils n’ont recours, dans la mesure du possible, qu’{ des partenaires { leur tour pleinement engagés dans la commercialisation de produits équitables (la distribution des produits dans les GMS est sinon proscrite, du moins limitée). Il s’agit de la forme de commerce équitable la plus proche de la forme dite « historique » dans le sens où les acteurs de la filière sont spécialisés dans le commerce équitable grâce { des réseaux d’importation (centrales d’achats) et de distribution (magasins du monde) alternatifs (Diaz Pedregal, 2007, p.118).
Au contraire, les membres de la filière certifiée peuvent n’être que partiellement engagés dans le commerce équitable : en règle générale, seuls quelques-uns de leurs produits sont labellisés, et ils sont pour la plupart distribués dans les GMS. Cette filière reflète le choix stratégique fait par les fondateurs du label Max Havelaar de profiter du savoir-faire et des moyens dont disposent les importateurs, les industriels et les distributeurs conventionnels pour ne pas induire de coûts supplémentaires. Les paragraphes suivants détaillent le fonctionnement des deux principaux représentants de chacune des filières : le réseau WFTO, dont les membres sont spécialisés dans le commerce équitable, et le système de certification FLO, qui peut s’appliquer { des entreprises du secteur conventionnel.

2.2.1. Les acteurs « spécialisés » : l’exemple des membres de WFTO1
2.2.1.1. Présentation
WFTO regroupe plus de 350 OCE (organisations de producteurs au Sud, importateurs, transformateurs du Sud et du Nord, distributeurs) dans 70 pays, toutes spécialisées dans le commerce équitable. Le chiffre d’affaires issu des ventes réalisées par les membres du réseau est estimé à plus de 2 milliards de dollars américains. Proche de la forme historique du commerce équitable, WFTO se définit comme le « gardien des valeurs du commerce équitable » (« The WFTO is the authentic voice of Fair Trade and a guardian of Fair Trade values »). Ce qui distingue WFTO de FLO-Int est donc l’engagement « total » de ses membres envers le commerce équitable. Par ailleurs, l’organisation part du principe que lorsque les consommateurs sont informés, ils effectuent de meilleurs choix et soutiennent l’idée d’un nécessaire changement dans les règles du commerce conventionnel. C’est pourquoi les membres de WFTO font des actions politiques, des plaidoyers et des campagnes d’information une composante importante de leur activité. En 2009, par exemple, l’organisation soutient le boycott du coton Ouzbèk en guise de représailles contre le travail forcé dans ce secteur.
2.2.1.2. Les pratiques

En pratique, WFTO a mis au point son propre code de conduite qui contient une dizaine de principes à respecter pour toute organisation qui souhaiterait adhérer au réseau. Il est à noter que pour WFTO, ces standards2 s’appliquent indifféremment { toute sorte d’organisation : organisations de producteurs (ci-après OP), entreprises d’import/export, industriels ou encore magasins du monde. Toutes les organisations souhaitant adhérer au réseau WFTO doivent donc respecter les 10 critères suivants : «
- Créer des opportunités pour les producteurs économiquement désavantagés.
- Transparence et responsabilité : l’OCE fournit toute l’information nécessaire { ses membres et à ses partenaires commerciaux. Les membres de l’OCE (producteurs, employés) participent activement à la prise de décision.
- Pratiques commerciales : l’OCE se préoccupe du bien-être social, économique et environnemental des petits producteurs marginalisés et ne maximise en aucun cas le profit à leurs dépens. Les acheteurs s’engagent { payer la marchandise dès réception, et si nécessaire avant la récolte (ou la production) sans intérêt supplémentaire. Les OCE s’engagent dans des relations commerciales de long terme.
- Paiement d'un prix juste : un prix juste est un prix qui a été obtenu de manière concertée entre les différentes parties prenantes. Il doit fournir une rémunération décente aux producteurs tout en étant soutenable pour le marché.
- Travail des enfants / travail forcé : l’OCE adhère { la déclaration des Nations Unies pour les droits de l’enfant et respecte la loi nationale concernant le travail des enfants. La participation des enfants à la fabrication de produits équitables est rigoureusement encadrée et ne doit pas avoir d’effets négatifs sur le bien-être, la sécurité ou la scolarisation de l’enfant. L’OCE s’assure que le travail forcé est une pratique inexistante.
- Non discrimination, égalité des sexes et liberté d’association
- Conditions de travail : l’OCE s’assure que le lieu de travail est conforme aux normes sanitaires et de sécurité prévues par l’OIT.
- Acquisition de compétences : l’OCE cherche { promouvoir l’acquisition de connaissances et de compétences par les producteurs (capacités de gestion, de production, de commercialisation).
- Promotion du commerce équitable : l’OCE fournit des informations aux consommateurs { propos des conditions de production de ses produits et explique ses objectifs et convictions. Les techniques de marketing et de communication doivent être « honnêtes ».
- Environnement : les techniques de production utilisées sont respectueuses de l’environnement »1.
…
CHAPITRE 2 Quel est l’impact du commerce équitable au Sud ? Évaluation de l’impact du coton équitable au Mali
Introduction

Comme nous venons de le voir dans le chapitre 1, le commerce équitable est souvent présenté comme un outil de développement durable et de lutte contre la pauvreté. La définition établie par le consensus FINE en 2001, par exemple, spécifie que le commerce équitable « contribue au développement durable, […] tout particulièrement au Sud de la planète ». Mise au point en 2009, la Charte commune à WFTO et FLO-Int accentue l’orientation du commerce équitable en faveur du développement des pays « les plus pauvres de la planète », en affirmant que les opportunités fournies par le commerce équitable représentent un « puissant vecteur de lutte contre la pauvreté ». Les acteurs du mouvement ne sont pas les seuls à voir dans la consommation équitable une nouvelle façon de promouvoir et de financer le développement. Comme indiqué dans l’introduction générale de cette thèse, le gouvernement français a inscrit le commerce équitable « dans la stratégie nationale de développement durable » (article 60 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises). L’inscription du commerce équitable dans les politiques publiques d’aide au développement conduit { s’interroger, en premier lieu, sur l’efficacité de ce nouvel outil : quel est l’impact du commerce équitable ? Importante pour les bailleurs de fonds et pour les acteurs du développement en général, la réponse à cette question est par ailleurs cruciale pour les Organisations de Commerce Équitable (OCE).
En effet, la demande pour les produits qu’elles promeuvent dépend notamment des résultats qu’elles peuvent garantir. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que les recherches sur les effets du commerce équitable se soient multipliées ces dernières années. La première section de ce chapitre en présente les principaux résultats. Ils indiquent que la capacité du commerce équitable à atteindre ses propres objectifs ne fait pas l’unanimité : s’il permet effectivement d’améliorer les revenus et les conditions de vie des producteurs à court terme, l’impact en termes de développement { long terme est loin d’être démontré. Il risquerait par ailleurs de favoriser l’accroissement des inégalités, voire de générer des externalités négatives sur d’autres acteurs (les producteurs non bénéficiaires et les consommateurs des pays du Sud notamment).
Ces doutes sur les effets à long terme et les externalités du commerce équitable sont dus en partie { l’absence d’études empiriques sur ces thèmes. En effet, l’intérêt des chercheurs pour le commerce équitable étant relativement récent, la majeure partie d’entre eux s’est pour l’instant concentrée sur le bien-être à court terme des producteurs bénéficiaires. C’est pourquoi l’étude d’impact réalisée dans le cadre de cette thèse s’est intéressée au projet « commerce équitable de coton au Mali » : soucieux de ne pas restreindre les bénéfices du commerce équitable aux seuls producteurs certifiés, les professionnels de la filière ont mis au point une stratégie qui devait permettre à tous les producteurs de coton de voir leur situation s’améliorer. La deuxième section de ce chapitre présente le contexte et les enjeux de cette stratégie. La troisième détaille le fonctionnement du projet ainsi que la façon dont il a été mis en œuvre pour générer ces externalités positives. Les objectifs de l’analyse d’impact ainsi que la méthode d’évaluation sont exposés dans la quatrième section tandis que les résultats font l’objet des sections 5 et 6.
- Revue de la littérature et enseignements
La Plate-forme Française pour le Commerce Équitable (PFCE) recense plus d’une centaine d’études ayant pour objectif d’évaluer les impacts du commerce équitable au Sud1. La revue de la littérature présentée ici n’entend donc pas être exhaustive2. L’approche adoptée vise { identifier les principaux enseignements (ou, plus précisément, les résultats qui font l’objet d’un consensus) et les questions qui restent en suspens, ceci afin de comprendre pourquoi nous nous sommes intéressés au projet de coton équitable au Mali.

1.1. Un consensus : le commerce équitable améliore les conditions de vie des producteurs bénéficiaires
Le bien-être des producteurs bénéficiaires est le domaine dans lequel les études d’impact sont les plus nombreuses. Quelles que soient la méthodologie adoptée et la filière considérée, la grande majorité d’entre elles concluent que le commerce équitable a un impact positif sur les prix d’achat, les revenus, et donc le bien-être des producteurs bénéficiaires.
1.1.1. Des prix d’achat plus élevés et plus stables que dans le secteur conventionnel
Avec une approche statistique, Bacon (2005) et Pariente (2000) montrent que les prix équitables sont effectivement supérieurs en moyenne aux prix d’achat obtenus sur les marchés conventionnels. En utilisant une méthode essentiellement basée sur des entretiens avec les producteurs certifiés, Murray et al. (2003) et Utting-Chamorro (2005) arrivent à la même conclusion. Ces quatre articles ont pour point commun d’étudier le prix du café équitable en Amérique Latine. Toutefois, l’ensemble des études confirme la capacité du commerce équitable à garantir des prix plus élevés et plus stables que ceux du secteur conventionnel, au moins pour les filières agricoles (voir par exemple la synthèse des six études de cas commanditées par Max Havelaar France en 20093).

Plus élevés et plus stables, les prix garantis par le commerce équitable semblent également suffisamment rémunérateurs : contrairement aux producteurs conventionnels, les producteurs de fruits équitables enquêtés par Becchetti et Costantino (2008) au Kenya se déclarent satisfaits des prix qu’ils obtiennent. Au Mexique en revanche, Jaffee (2008) montre que le prix équitable du café ne suffit pas toujours à couvrir les coûts de production. Il précise par ailleurs qu’en tenant compte de l’inflation, le pouvoir d’achat des producteurs de café équitable a diminué au cours du temps puisque FLO-Int n’a pas revalorisé le prix équitable pour le café depuis dix ans (sur ce point voir également Valkila et Nygren, 2009, et Bacon, 2010). Smith (2007) se montre également moins optimiste à propos du prix équitable : lorsque les prix internationaux sont élevés, la différence entre les prix équitables et conventionnels s’amoindrit. Or, d’après Valkila et Nygren (2009), la réduction de la différence de prix entre le secteur équitable et le secteur conventionnel peut déstabiliser les coopératives certifiées : en effet, lorsque les prix conventionnels dépassent les prix équitables, elles perdent des membres et ne peuvent plus assumer les charges de gestion et de certification.
1.1.2. Augmentation et stabilisation des revenus des producteurs
Tout comme son impact sur les prix, la capacité du commerce équitable à augmenter les revenus des producteurs bénéficiaires fait l’objet d’un consensus : selon les entretiens menés par l’Université du Colorado dans sept pays d’Amérique Latine (Murray et al., 2003, 2006), par l’Université de Liège au Ghana, au Costa Rica, en Tanzanie et au Nicaragua (Paul, 2005) ; et par Utting-Chamorro (2005) au Nicaragua, les revenus des producteurs équitables sont plus élevés (voir également Nelson et Galvez, 2000). Roche (2006) nuance cependant l’ampleur des résultats dans la mesure où il estime à 12 dollars américains (USD) par ménage et par an les bénéfices du commerce équitable de cacao en République Dominicaine. Grâce au prix minimum garanti, les revenus seraient également plus stables. Pour Bacon (2005) cet impact est fondamental dans la mesure où il permet de réduire la vulnérabilité des producteurs et de leurs familles : lorsqu’ils sont soumis { un choc (catastrophe naturelle, crise économique, baisse du prix des matières premières, etc.), les ménages agricoles sont contraints d’adopter rapidement des stratégies de sortie de crise. Or, si ces dernières sont souvent le meilleur (voire le seul) choix à très court terme, elles peuvent également créer les conditions d’une grande pauvreté { moyen ou long terme1.
Par exemple, l’arrêt de la scolarisation des enfants diminue les dépenses des ménages à court terme mais menace leur potentiel de développement à long terme. Autre exemple, le recours à la vente d’actifs (matériel agricole, bœufs de labour) remet en cause les possibilités de production et donc les revenus futurs1. Dans ce contexte, Bacon (2005) voit dans la hausse et surtout dans la stabilisation des prix permises par le commerce équitable un moyen de réduire l’exposition des ménages aux chocs de prix. En plus d’un effet revenu « classique », le commerce équitable permettrait donc aux ménages les plus vulnérables d’éviter de tomber dans le cercle vicieux de la pauvreté. Là encore cependant, certains auteurs nuancent la capacité du commerce équitable à stabiliser les revenus dans la mesure où cela ne dépend pas que des prix, mais également des volumes commercialisés (Zehner, 2002). Or, ceux-ci varient selon les années, remettant de facto en cause le caractère stabilisateur du commerce équitable. L’instabilité de la demande se traduit également par des délais de paiement qui peuvent remettre en question certaines décisions d’investissement (Chohin-Kuper et Kemmoun, 2010 ; Valkila et Nygren, 2009), voire déstabiliser l’ensemble de la filière (cf. section 5, infra).

1.1.3. De meilleures conditions de vie
Dans les filières agricoles, l’amélioration des revenus des producteurs équitables entraîne dans la plupart des cas une hausse des dépenses de consommation, d’éducation, de santé, voire d’investissement. Le commerce équitable semble également procurer un sentiment de sécurité. Les producteurs interrogés par Bacon (2005) se disent ainsi moins vulnérables (« ont moins peur de perdre leur titre de propriété { cause d’une baisse des prix du café », ibid., p.506). Cependant, seule l’analyse contrefactuelle de Becchetti et Costantino (2008) (qui comparent un groupe de producteurs équitables avec un groupe « témoin ») permet de déterminer dans quelle mesure les effets observés sont dus au commerce équitable. Selon cette analyse, le commerce équitable entraîne une amélioration du statut nutritionnel ainsi qu’une diminution des épisodes de mortalité infantile au sein des ménages. L’ensemble des auteurs souligne que l’impact est proportionnel, c’est-à-dire limité, aux volumes vendus sur les marchés équitables (Bacon, 2005 ; Valkila et Nygren, 2009 ; Zehner, 2002 ; Mendoza et Bastiaensen, 2003 ; Murray et al., 2003 et 2006). Dans le secteur artisanal, c’est davantage parce que le commerce équitable fournit des débouchés et donc des emplois qu’il permet d’améliorer la situation économique des producteurs car les prix d’achat ne sont pas significativement plus élevés (Hopkins, 2000 ; Mestre, 2004). Là encore, comme le souligne Hopkins lui-même, il est difficile d’apprécier dans quelle mesure les résultats sont attribuables au commerce équitable puisque les études ne s’appuient pas sur une analyse contrefactuelle.
…
6.5.2. La qualité est-elle un critère de sélection ?

En nous inspirant des travaux de Chay et al. (2005), nous tentons tout d’abord de déterminer graphiquement s’il existe une corrélation entre la qualité produite en t-1 et la certification en t. Si l’encadrement CMDT et les UC ne choisissaient que les OP qui produisent au moins un certain pourcentage de bonne qualité, nous obtiendrions la figure 2.21.a (voir page suivante). Dans ce cas, toutes les OP qui produisent plus de 45% de coton de bonne qualité (qu’il s’agisse de Sarama, de Premium ou de Qualités CE) sont choisies, et uniquement celles-ci. Si la sélection était plus stricte (seule une partie des OP produisant de la bonne qualité sont choisies, les plus proches d’OP certifiées par exemple) nous aurions la figure 2.21.b. Et si elle était plus large (les OP produisant de la bonne qualité sont choisies en priorité, auxquelles sont ajoutées d’autres OP) nous aurions la figure 2.21.c. La superposition des deux derniers graphiques mène à la figure 2.21.d, qui est le signe d’une absence de corrélation entre la qualité produite en t-1 et la probabilité d’être certifié en t.
Les 56 OP certifiées en 2005/06 ont-elles été sélectionnées grâce à une meilleure qualité en 2004/05 ? D’après les figures 2.22.a à 2.22.c (page suivante), seul le pourcentage de Qualités CE atteint en t-1 semble être corrélé avec la certification en t. Si l’on fait abstraction des deux coopératives ayant produit environ 10% de coton de bonne qualité en 2004/05, il semblerait que 29% de Qualités CE soit un seuil en dessous duquel il n’était pas possible d’être certifié. Par ailleurs, la qualité n’est pas le seul déterminant de la sélection puisque toutes les OP ayant produit plus de 29% de qualités équitables n’ont pas été incluses (sélection plus stricte). Cela reflète l’importance du critère de proximité.
