Documentation avance sur l’evolution du commerce equitable enjeux et pratiques
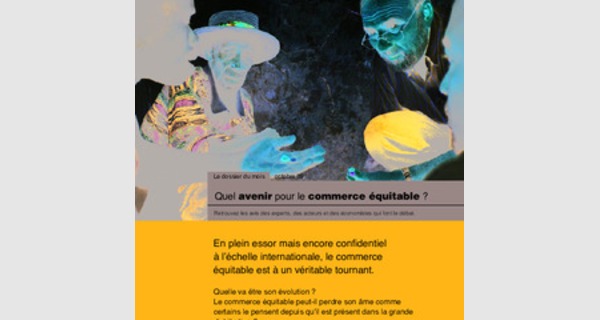
Documentation avancé sur l’évolution du commerce équitable enjeux et pratiques
Quel avenir pour le commerce équitable ?
Le commerce équitable connaît un véritable essor. En France, en 2007, les ventes de produits équitables ont atteint 241 millions d’euros. Une croissance de 157% en 3 ans.
Issu de mouvements de citoyens, le commerce équitable garantit aux petits producteurs du Sud de commercialiser leurs produits à des prix plus rémunérateurs que les cours mondiaux. Un prix équitable couvrant tous les coûts de production, incluant une prime de développement et privilégiant une relation durable entre les différents acteurs. Les produits les plus appréciés sont le café, le thé, le cacao, les bananes, les jus, le riz et les céréales. Le textile et l’artisanat sont proposés dans les boutiques spécialisées mais des accessoires équitables à la mode, chaussures décontractées et sacs, ont fait leur apparition dans certains magasins. Aujourd’hui, un acteur vient bouleverser la donne : les grandes et moyennes surfaces.
Devenues en quelques années le premier lieu d’achat de produits équitables, elles provoquent des tensions. D’un côté, certains militants, comme le réseau Minga ou Artisans du Monde, considèrent cette entrée dans le monde de la grande distribution comme un pacte avec le diable. Pour certains d’entre eux, la grande distribution, qui exploite déjà les producteurs à l’échelle locale, veut juste se racheter une vertu. La grande distribution mettrait des producteurs équitables en concurrence au risque de les faire entrer dans une pure logique de marché et de favoriser les plus gros. De l’autre côté, des sociétés comme Alter Eco, Ethiquable ou Malongo, pensent qu’il est essentiel d’être présent dans les supermarchés. Pour elles, c’est un canal de diffusion incontournable si le commerce équitable veut sortir de la confidentialité et peser à terme sur le marché. En faire un produit comme un autre ne contredit pas ses enjeux mais permet de toucher un public plus large, autre que des personnes déjà sensibilisées.
Enfin, la grande distribution elle-même s’est lancée dans le commerce équitable. Monoprix ou Carrefour vendent désormais leurs produits labellisés « FairTrade-Max Havelaar », premier système international de labellisation de droit privé. Max Havelaar, label géré par l’association FLO, a connu un essor rapide grâce à l’irruption de produits portant sa garantie dans les rayons des supermarchés et grâce à des accords passés avec certaines multinationales comme Nestlé au Royaume-Uni ou McDonald’s en Suisse. Mais au-delà du débat de la grande distribution, c’est la question de l’avenir du commerce équitable dans une économie de marché, qui se pose. La part du commerce équitable dans le commerce mondial est seulement de 0,01%. Comment peser plus? La puissance publique a-t’elle une responsabilité ? Comment mieux se faire reconnaître par la Commission européenne et l’OMC ? Le commerce équitable peut-il évoluer sans perdre son âme ?
Enjeux
Le commerce équitable a le vent en poupe : des taux de croissance à deux chiffres, une notoriété désormais bien établie, une légitimité reconnue par les consommateurs et par les pouvoirs publics. Mais ce succès a son revers : les polémiques entre acteurs, inévitables dans des cercles militants où l’on aime discourir et refaire le monde, ont été relayées par différents ouvrages qui ont instruit le procès des principaux opérateurs.
La Ligue de l’enseignement est membre de la Plate-forme pour le commerce équitable (PFCE), mais elle n’a pas vocation à jouer les arbitres. En revanche il nous est apparu important d’éclairer les enjeux et les tensions qui traversent ces mondes militants, ne serait-ce que pour aider nos propres adhérents à y voir plus clair, à démêler les débats et les tensions qui animent ce monde en pleine évolution. Cette ambition est précisément ce qui nous a conduits à adhérer à la PFCE : le modèle du commerce équitable met en jeu l’idée d’une consommation éclairée, consciente de ses conséquences, qui est très proche de notre conception de la citoyenneté. L’idée d’éduquer les consommateurs rejoint également, sur un mode original mais en prise avec les réalités d’aujourd’hui, le projet d’éducation populaire porté par la Ligue depuis ses origines. Et il ne faut pas s’y tromper : si l’enjeu premier du commerce équitable est le soutien apporté aux producteurs du Sud, l’action menée au Nord n’en est pas moins porteuse de sens. Nos comportements de consommateurs sont aussi structurants que notre travail : c’est aussi en consommant que nous façonnons le monde qui nous entoure, et que nous nous définissons nous-mêmes. Or, ces comportements sont conditionnés par le marketing et la publicité, enfermés dans des choix contraints, isolés de leurs conséquences sociales. Nous consommons à l’aveugle, et c’est tout un pan de notre rapport au monde qui se définit ainsi par cet aveuglement passif.
Est-ce vraiment ce que nous voulons ? Sortir de cette passivité est un enjeu fort. Un enjeu qui ne saurait rester le lot d’élites militantes éprises de pureté, qui ne devrait pas non plus être le geste élégant des plus aisés, amateurs de quinoa. Ce pourrait être au contraire l’une des clés d’une citoyenneté renouvelée. Le libre choix du consommateur peut être éclairé par une meilleure information. Cette information, les garanties qu’elle propose et les modèles pluriels qu’elle dessine peuvent être mis en débat, au sein des collectifs mais aussi dans la sphère publique et pourquoi pas dans l’agenda politique. Les acteurs du commerce équitable rêvent de changer les règles du jeu. C’est un rêve militant qui pourrait se briser sur le roc de la régulation du commerce international : car il n’est rien de plus régulé que ces échanges et plus on les régule, plus on offre d’espace à ceux qui ont les moyens de peser, techniquement et politiquement, sur les instances de régulation. En revanche faire évoluer les pratiques, faire émerger des normes, contribuer à mettre en forme des préférences collectives mal représentées aujourd’hui sont des enjeux qui ont du sens.
Points de vue
Le commerce équitable est un monde complexe, que l’on peut décrire comme un mouvement social, mais aussi comme un secteur économique et enfin comme un ensemble de discours. Différentes tensions traversent ces dimensions. Comment s’y retrouver ? Nous avons choisi de scruter dans un premier temps les modes d’engagement, en nous focalisant sur la figure centrale du consommateur. Une seconde séquence interroge les stratégies des acteurs dans le contexte de la mondialisation.
Quels engagements ?
Longtemps confiné dans des réseaux militants très étroits, le commerce équitable s’est aventuré du côté de la grande consommation. La dimension fortement militante des réseaux initiaux est-elle remise en cause ?
Entre engagement militant et professionnalisation
Le commerce équitable est un espace militant à géométrie variable. Les consommateurs, acteurs essentiels d’un modèle qui cherche à les responsabiliser, sont invités à entrer dans la démarche, peuvent devenir militants, mais aussi relayer l’action des associations. Celles-ci se sont professionnalisées mais restent structurées et animées par des réseaux de bénévoles. Le succès aidant, une part de concurrence sur certains segments de l’activité devrait nécessairement mobiliser des compétences plus pointues à l’avenir
…
Entretien avec Vincent David
Fondateur de Relations d’utilité publique, une agence de relations publiques pour des associations agissant sur les questions sociales et environnementales, Vincent David a été entre 2001 et 2006 responsable des relations extérieures de l’association de commerce équitable Max Havelaar France (2001-2006). Il a notamment publié le Guide de l’économie équitable (Fondation Gabriel Péri, 2007).
Le thème du commerce équitable a réussi à s’imposer dans l’espace public. Est-ce une réussite militante, ou le signe d’une professionnalisation des acteurs ?
L’essor du commerce équitable en France est principalement dû à la conjonction de quatre facteurs : la communication de masse autour de ce thème, grâce à la Quinzaine du commerce équitable initiée par l’association Max Havelaar en 2001, qui a permis de déclencher la notoriété ; l’intérêt commercial et marketing de PME de payer un prix équitable aux producteurs et de grandes surfaces de distribuer ces produits dans leurs rayons, qui a permis la visibilité et la disponibilité à grande échelle de ces produits ; l’intérêt des médias pour cette démarche de solidarité inédite, concrète et innovante, qui a permis la démocratisation de la notion ; et enfin un contexte économique et politique qui a vu l’émergence du mouvement altermondialiste, la critique des règles du commerce international, et la diffusion du concept de développement durable, qui a permis de crédibiliser les fondements et les objectifs du commerce équitable.
S’il n’a pas été déterminant (l’association Artisans du monde existe depuis 1974, mais la notoriété du commerce équitable date des années 2000), le rôle des militants est bien entendu très important. En effet, ils incarnent la dimension associative et bénévole de la démarche ; ils ont permis grâce à une campagne de l’association Agir Ici en 1999 de faire pression sur la grande distribution pour qu’elle référence les produits du commerce équitable ; et ils font des animations sur le commerce équitable et ses enjeux dans les magasins, les boutiques et lors des centaines de manifestations sur ce thème partout en France, appuyés par des militants d’associations étudiantes, d’associations de solidarité internationale, d’associations d’éducation populaire, et de syndicats. C’est en fait la conjonction de l’engagement militant et de la professionnalisation des acteurs, notamment en matière de communication et de commercialisation, qui a permis la diffusion du commerce équitable dans la société.
Un des enjeux du commerce équitable est l’engagement des consommateurs. Au-delà de l’achat d’un paquet de café, quels sont les espaces offerts à cet engagement, et sont-ils investis par une partie des consommateurs ?
Désormais, la gamme des produits équitables est très vaste puisqu’elle couvre une grande partie des produits de grande consommation : alimentaire, habillement, cosmétique, décoration, ameublement, tourisme. Cela permet aux consommateurs de comprendre que leurs achats peuvent avoir des conséquences positives ou négatives sur les droits de l’homme et l’environnement à l’autre bout de la planète. Par ailleurs, la communication et la sensibilisation autour des produits du commerce équitable permet une éducation à la solidarité internationale et au développement durable. L’achat de produits équitables dans les boutiques spécialisées ou sur des marchés est souvent accompagné de la signature de campagnes militantes en faveur d’un rééquilibrage économique et social entre le Nord et le Sud. Une fois sensibilisés, certains consommateurs vont devenir bénévoles dans des associations de commerce équitable ; d’autres pourront s’investir d’une façon différente en incitant leur ville, leur entreprise ou leur comité d’entreprise à s’engager dans ses achats et sa communication en faveur du commerce équitable.
Les acteurs du commerce équitable sont nombreux et divers. Sont-ils entrés dans une concurrence aussi rude que les entreprises « normales » ?
En ce qui concerne les associations de commerce équitable, elles ne sont pas en concurrence. La plupart du temps, elles travaillent ensemble, même si elles peuvent avoir des points de vue divergents sur les manières de concevoir et de promouvoir le commerce équitable. En revanche, les acteurs commerciaux engagés en faveur du commerce équitable sont clairement en concurrence puisque rien que sur le café, il existe une cinquantaine de marques qui proposent du café équitable. Mais on peut considérer qu’il s’agit d’une concurrence vertueuse dans la mesure où elle permet d’augmenter le nombre de produits équitables et donc les débouchés pour les producteurs qui aimeraient vendre beaucoup plus de leur production aux conditions du commerce équitable. Ce qui est plus problématique, c’est la concurrence existante entre les marques distributrices des enseignes de la grande distribution (MDD) labellisées commerce équitable et les PME historiques qui sont garantes d’une éthique tout au long de la filière. En effet, pour ces dernières, il est beaucoup plus difficile de s’aligner sur les prix des MDD.
Polémiques sur la grande distribution
L’essor du commerce équitable ces dernières années s’est accompagné de polémiques récurrentes entre les différents acteurs de la filière, relayées et parfois lancées par des observateurs. La question de la grande distribution a tenu une place centrale dans ces débats : le choix des grandes enseignes de distribuer des produits labellisés était-il une simple question d’image ? Et les associations qui animent le cœur de la filière devaient-elles entrer dans ce jeu ?
Deux livres sont associés à cette polémique : Les Coulisses du commerce équitable de Christian Jacquiau (Éditions Mille et une nuits, 2006) et plus récemment La Face cachée du commerce équitable de Frédéric Karpyta (Bourrin, 2009). L’un et l’autre ont été contestés pour leurs sources ou la partialité de leur approche, mais ils n’en posent pas moins des questions de fond. « La grande distribution ne joue absolument pas le jeu », affirme le journaliste Frédéric Karpyta, expliquant que les chaînes de supermarchés n’utilisent le commerce équitable que pour améliorer leur image. À ses yeux, l’association Max Haavelar porte une part de responsabilité dans cette démarche, en permettant aux enseignes de commercialiser des produits qui ne se conformeraient au label Max Haavelar que d’une façon minimaliste, pour ne pas dire trompeuse.
L’économie générale de la chaîne de production ainsi labellisée ne serait guère différente des autres, la rémunération des producteurs du Sud restant très marginale dans le prix payé par le consommateur (de l’ordre de 2%), au profit d’intermédiaires se contentant de faire des affaires et ne menant aucune action sur le terrain. À ce modèle économique, Frédéric Karpyta oppose celui des réseaux intégrés (Minga ou Artisans du Monde), qui mèneraient une action plus ambitieuse et s’en donneraient les moyens en contrôlant l’ensemble de la chaîne ; une démarche à même de créer des relations durables avec les producteurs du Sud. La grande distribution, au contraire, mettrait ces producteurs en concurrence : logique quand on mène des affaires selon les critères habituels, cette mise en concurrence serait contraire à l’esprit du commerce équitable. Cette critique n’émane pas seulement de journalistes ; elle a été reprise par certains acteurs comme Emmanuel Antoine, président du réseau Minga, qui rappelle que les produits du commerce équitable ne sont pas des produits comme les autres (Emmanuel Antoine et alii : Vers un commerce équitable, Minga, 2007). D’autres acteurs insistent sur les comportements inéquitables des entreprises de la grande distribution à l’égard de leurs propres salariés et ses fournisseurs, qui poseraient un problème de cohérence. Les consommateurs en somme s’achèteraient une bonne conscience en laissant fleurir des injustices sous leur nez
Du côté de Max Havelaar, on répond en expliquant que si les problèmes des salariés européens et des fournisseurs de la grande distribution sont bien réels, il existe d’autres organisations, comme les syndicats de salariés et les organisations d’exploitants agricoles, pour traiter ces problèmes. Max Haavelar insiste aussi sur l’importance d’accroître les volumes de ventes au Nord, seul moyen de changer réellement la situation des producteurs du Sud : dans ces conditions, et pour sortir de la confidentialité, les chaînes de grande distribution sont un partenaire qu’on ne peut ignorer. En prenant un peu de champ, on peut adopter deux points de vue. Tout d’abord, il y a une légitimité dans les questions posées : certains principes comme la durabilité des relations et le travail de formation risquent d’être laissés de côté par des acteurs habitués à traiter des affaires avec une certaine rudesse. S’il n’est pas illégitime d’investir le champ de la grande distribution, une certaine exigence devrait être de mise et il n’est pas certain aujourd’hui que ce soit le cas. Ensuite, on ne peut s’empêcher de percevoir dans ces attaques contre l’acteur dominant du secteur (Max Haavelar) une façon de rejouer la concurrence en la situant dans le domaine idéologique et en faisant primer la pureté. Ce type de démarche, bien connu des sociologues des mouvements sociaux, contribue sans aucun doute à informer les prises de position des acteurs minoritaires Sans être totalement aveugles quant aux enjeux de ces polémiques, on peut, plutôt que de les déplorer, relever que les désaccords persistants sont aussi un signe de vitalité démocratique… et de stimulation de la concurrence !
…
Des acteurs aux cultures différentes
Le commerce équitable fait intervenir divers mondes militants, qui ont développé des visions du monde et des choix stratégiques quelquefois très différents. S’interroger sur les conditions d’une harmonisation suppose de revenir sur les fondements de ces différences.
Entretien avec Virginie Diaz Pedregal
Chargée d’études et de Entretien avec Virginie Diaz Pedregal recherche à la direction scientifique du GRET, une association de solidarité et de coopération internationale.
Les tensions qui traversent le monde du commerce équitable sont-elles selon vous simplement dues à des différences de stratégie, ou renvoient-elles à des clivages idéologiques plus profonds ?
Je pense que ces tensions renvoient à des clivages idéologiques profonds, dans la mesure où chaque acteur (organisation du commerce équitable, groupement de producteur, certificateur, vendeur…) défend sa propre vision du commerce équitable. Ces visions reposent sur des conceptions de la justice différentes. Certains s’attachent à défendre un commerce équitable avant tout axé sur la réponse aux besoins matériels des producteurs du Sud, d’autres veulent un commerce égalitaire pour les producteurs du Nord et du Sud, incluant également les transporteurs et distributeurs, d’autres encore pensent que le commerce équitable doit d’abord être efficace pour espérer être juste. Ces critères de justice (besoin, égalité, efficacité…), définis par le philosophe américain Jon Elster dans d’autres contextes, justifient des pratiques et des discours radicalement divergents, voire antagonistes. C’est pourquoi les tentatives de conciliation entre ces multiples représentations et mises en œuvre du commerce équitable se soldent souvent par un échec.
Qu’en est-il des espaces de discussion entre les différents acteurs de la filière : sont-ils formalisés et structurés ?
Face à la divergence des pratiques et à la multiplication des acteurs, des espaces d’échange et de concertation se sont développés à partir des années 1990 en Europe et en Amérique du Nord. Leur objectif est de parvenir à des accords sur l’harmonisation des critères de certification des produits, de coordonner les mécanismes de soutien et de contrôle aux organisations du Sud, d’orchestrer l’action de chacun auprès des instances politiques... Ces espaces sont aujourd’hui formalisés et structurés.
Au niveau international, on peut par exemple citer la fédération des importateurs européens de commerce équitable EFTA, le réseau des magasins européens de commerce équitable NEWS!, l’organisation de labellisation du commerce équitable FLO et la fédération internationale pour le commerce alternatif IFAT. Ces quatre structures se sont regroupées au sein du réseau FINE (acronyme de ses membres). En France, la plate-forme française pour le commerce équitable (PFCE) et l’association Minga jouent un rôle similaire.
Le succès du thème dans l’espace public pourrait-il conduire à une unification des pratiques et des discours ?
Les divergences de pratiques et de discours entre les acteurs sont réelles. Nous l’avons vu, elles renvoient à des clivages idéologiques profonds. Si le succès du commerce équitable dans l’espace public et la création d’instances de discussion vont dans le sens du dialogue et de la coordination entre les intervenants de la filière, ils me semblent insuffisants pour parvenir à une unification totale des façons de faire et de penser le commerce équitable. Cela peut dérouter le consommateur, confronté lors de son achat à des labels et des appellations de commerce équitable multiples, dont il est peu familier. Pour les praticiens du commerce équitable, l’enjeu est là : comment rester fidèle à sa vision du commerce équitable, tout en rassurant le consommateur sur le sérieux de son approche. Néanmoins, les notions de « bonne certification », « juste prix », « échange équitable » doivent constamment être questionnées. Ce n’est pas forcément un mal. Le commerce équitable est pluriel, fait d’individualités, ouvert à la diversité et à la complexité.
