Support de cours d’introduction a l’histoire du commerce
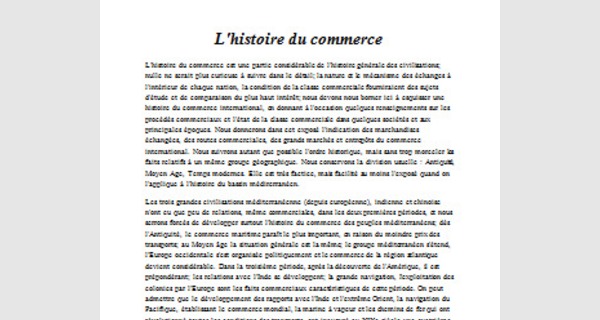
Support de cours d’introduction à l’histoire du commerce
...
Le commerce dans l'Antiquité
Le commerce a existé dès les temps les plus reculés. L'antique Égypte entretenait des relations mercantiles avec l'Éthiopie, l'Arabie et l'Inde, et les principaux objets des échanges étaient l'or, l'ivoire, l'ébène, les parfums, les étoffes, les pierres précieuses. La Phénicie, placée dans les conditions les plus favorables pour devenir le centre du commerce, lui donna un vaste essor : ses marchands allèrent chercher le vin, le blé et l'huile de la Palestine, les chevaux et les aromates de l'Arabie, le lin de l'Égypte, les tapis et les étoffes brodées de la Babylonie, les esclaves de l'Asie Mineure, les mulets et les vases d'airain de la région caucasienne, les soieries de l'Inde; pourvus d'excellents ports, trouvant en abondance dans les montagnes voisines les bois de construction, ses marins sillonnèrent le golfe Arabique, la mer Érythrée, la Méditerranée, et visitèrent le littoral de l'Atlantique, peut-être même celui de la Baltique. Dans cette haute antiquité, le commerce maritime fut souvent mêlé d'actes de piraterie.
Les Phéniciens établirent de nombreux comptoirs, principalement eu Sicile, eu Sardaigne, sur la côte septentrionale de l'Afrique, et en Espagne : afin d'écarter la concurrence, ils enveloppaient d'un grand mystère leurs relations commerciales. Lorsque Tyr, leur principale ville, eut été détruite par Nabuchodonosor (573 av. J.-C.), et que la Phénicie passa de la domination des Babyloniens sous celle des Perses, la Grèce et Carthage se partagèrent la Méditerranée. Athènes et Corinthe sur le continent européen, Milet en Asie Mineure, Dioscurias, Pauticapée, Phanagorie et Olbia sur les bords du Pont-Euxin, furent les places de commerce les plus importantes des Grecs. Il faut mentionner aussi les Lydiens, qui favorisèrent les progrès du négoce, s'il est vrai, comme le dit Hérodote, qu'ils aient inventé les monnaies d'or et d'argent; les Phocéens, fondateurs de Marseille; les Rhodiens, renommés pour la sagesse de leurs règlements maritimes; et les Tyrrhéniens ou Étrusques, gardiens jaloux du commerce sur les côtes de l'Italie.
Carthage hérita des établissements phéniciens dans le bassin occidental de la Méditerranée. La conquête de l'Asie par Alexandre le Grand ouvrit des voies nouvelles au commerce : Alexandrie, fondée près de l'une des bouches du Nil, éclipsa bientôt la seconde Tyr qu'il venait de détruire, et, pendant le règne des Ptolémées en Égypte, devint l'entrepôt du commerce des Indes avec l'Europe; un canal navigable relia le Nil à la mer Bouge.
Corinthe et Carthage disparurent en même temps sous les coups des Romains. Ce peuple ne resta pas aussi étranger qu'on le croit d'ordinaire aux entreprises commerciales. Il est vrai qu'à l'époque des Guerres puniques une loi provoquée par les tribuns défendit aux sénateurs les spéculations mercantiles; mais ce ne fut qu'une ruse du parti populaire pour empêcher l'aristocratie d'augmenter ses richesses. On ne tarda pas à voir les provinces de la République envahies par les citoyens qui voulaient faire fructifier leurs capitaux. En Gaule, dit Cicéron, il ne se fit pas une affaire, il ne se remua pas une pièce de monnaie, sans l'intervention d'un citoyen romain.
En Asie Mineure, le massacre de 80,000 Romains par ordre de Mithridate ne découragea pas le commerce, et bientôt le pays fut couvert de nouveaux établissements, dont le crédit devint considérable. C'étaient, en général, les membres de l'ordre équestre qui s'engageaient dans le haut négoce; les citoyens d'un rang moins élevé trouvaient encore un vaste champ d'opérations dans la propriété et l'affrètement des navires, dans les transports par terre et par eau, et même dans le commerce de détail, auquel on préposait le plus souvent des esclaves. Des sociétés s'étaient formées, soit pour les opérations de banque, soit pour le fermage des impôts ou les fournitures des armées; et elles comptaient dans leur sein des capitalistes assez riches pour prêter, comme Rabirius, aux rois et aux nations. Les sociétés de publicains, comme on les appelait, déclinèrent sous l'Empire, parce que la perception de l'impôt fut confiée à des agents impériaux; elles conservèrent néanmoins jusqu'à la fin la ferme des douanes, des mines et des salines.
Les Romains avaient un grand intérêt à développer le commerce chez les peuples soumis à leur puissance, afin d'en tirer de plus grosses contributions. Auguste rétablit Carthage et Corinthe, mais ces villes ne purent reconquérir leur ancienne importance; les relations avec l'Inde furent, régularisées, et Pline nous apprend qu'une flotte s'y rendait d'Alexandrie tous les ans; les routes furent multipliées dans toutes les parties de l'Empire. Mais les guerres des ambitieux qui se disputèrent la pourpre impériale, les attaques de plus en plus fréquentes des Barbares, portèrent de graves atteintes au commerce, qui a besoin de paix et de sécurité.
Puis la translation du siège de l'Empire à Constantinople fit converger les marchandises vers cette ville, au détririent de l'Italie et des autres contrées de l'Occident.
Le commerce au Moyen Âge
Après la chute de l'Empire romain d'Occident, le commerce reste florissant dans l'Empire d'Orient (Empire byzantin). Placée au point où se touchent l'Orient et l'Occident, Constantinople était le grand entrepôt où affluaient les marchandises de l'Asie, de l'Afrique, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Allemagne et de la Russie. Par la Syrie et par la mer Rouge, l'Empire était en relations commerciales avec l'Extrême Orient. Par la mer Noire et la Caspienne, il tirait de l'Asie centrale les épices, les aromates, les pierres précieuses. Vers le nord, des routes commerciales conduisaient jusque chez les Scandinaves et les Russes. Les marchands byzantins allaient en Afrique, en Italie, en Gaule. Et ce n'était pas seulement Constantinople qui était le centre de ce commerce; Thessalonique avait des foires célèbres : Patras, Corfou, etc., étaient des ports fréquentés. Aussi, malgré les mesures restrictives d'une politique économique assez maladroite, les produits du commerce fournissaient à l'Empire des
ressources financières énormes. Toutefois, à partir du XIe siècle, et surtout avec les Croisades, la décadence devait commencer pour le commerce byzantin; les grandes villes d'Italie, Venise, Gênes, Pise, obtinrent alors dans l'Empire d'importants privilèges et ruinèrent bientôt par leur concurrence la marine de commerce de l'Empire byzantin et les industries qui l'alimentaient.
Plusieurs siècles s'écoulèrent, durant lesquels le commerce fut presque anéanti : pendant les invasions germaniques, au milieu du désordre et de la confusion, il n'y avait aucune place pour les transactions de quelque étendue. Cependant, quand Charlemagne ouvrit à Aix-la-Chapelle une foire annuelle, on y vit accourir des marchands de Saxe, de Slavonie, d'Italie, d'Espagne, d'Égypte et de Syrie. Mais une nuit nouvelle suivit le règne du grand empereur.
Dans les temps féodaux, le peu de sûreté des biens meu bles et la difficulté de les accumuler, la rareté des capi taux, l'ignorance des besoins mutuels, le risque d'être, volé dans le transport des marchandises, la certitude d'être soumis par les seigneurs à toutes sortes d'extorsions, les droits qu'il fallait payer sur les routes et les ponts, la diversité des monnaies et le change qu'on exigeait dans chaque seigneurie, la fabrication des objets de première nécessité dans la demeure même des riches à défaut de grandes manufactures, étaient autant d'obstacles qui entravaient le commerce.
Le monde musulman présentait un contraste frappant avec la société chrétienne : car Bagdad, Bassorah, le Caire, étaient le centre d'un commerce très animé, auquel participaient l'Afrique, la Sicile et l'Espagne, et, dans tout l'Orient, Constantinople était à peu près la seule ville chrétienne qui eût conservé de grandes relations commerciales : on y apportait les produits de l'Inde par l'intérieur de l'Asie et par la mer Noire. Les relations de l'Europe avec l'Inde par le Nil et la mer Rouge étaient interrompues depuis l'occupation de l'Egypte par les Arabes; le commerce des caravanes par Tripoli, Alep, Bagdad et le golfe Persique, y suppléait.
A partir du Xe siècle, plusieurs villes maritimes de l'Italie profitèrent de leur situation entre l'Orient et l'Occident pour s'élever à un haut degré de prospérité commerciale. Amalfi brilla d'un certain éclat jusqu'au moment où elle fut soumise aux rois de Sicile. Pise et Gênes eurent des comptoirs sur les côtes de la Syrie, de l'Égypte, de la mer Noire et de la mer d'Azov. Venise, à qui étaient réservées des destinées plus brillantes encore, devint le marché principal des peuples occidentaux : les navires de la République et ceux des particuliers servirent simultanément aux relations avec le Levant, et les marchandises qu'ils rapportaient étaient ensuite distribuées sur les côtes d'Afrique, du Portugal, d'Espagne, de France, de Flandre et d'Angleterre. La période des Croisades fut l'âge le plus brillant des républiques italiennes, avec lesquelles Marseille et les Catalans participèrent aux bénéfices du commerce, en Occident. Les Vénitiens se montraient peu scrupuleux sur les moyens d'étendre leurs affaires : avec une hardiesse que ne comportait guère. l'esprit de leur temps, ils signaient, avec les soudans d'Egypte, des traités sous la double invocation des deux religions, faisaient le commerce des esclaves, et vendaient aux musulmans des armes et autres munitions de guerre. Vainement, au commencement du XIVe' siècle, le pape Clément V les menaça d'excommunication, s'ils continuaient d'entretenir des relations avec les Musulmans, et prétendit les frapper d'amendes égales à la valeur des marchandises négociées; ils n'en tinrent aucun compte.
...
Pendant les siècles qui se sont écoulés depuis la découverte du Nouveau-Monde jusqu'à l'aube de la Première Guerre mondiale, une foule de circonstances se sont réunies pour donner une prodigieuse extension au commerce général. Nous signalerons principalement l'amélioration et la multiplication des routes et des canaux dans les divers États, l'application de la vapeur à la navigation, l'établissement des chemins de fer, l'abaissement progressif des barrières qui s'élevaient jadis entre les peuples et même entre les provinces d'un même pays, les progrès de l'industrie manufacturière à qui les débouchés extérieurs sont devenus indispensables, l'ouverture de marchés dans des pays jusque-là inexplorés, le développement des connaissances géographiques, l'augmentation très sensible du nombre des objets qui sont entrés dans la consommation et ont fait la matière des échanges, le mécanisme ingénieux des banques d'escompte et de circulation, l'uniformité déjà grande, mais encore incomplète, des poids et mesures et des monnaies, les idées d'association commerciale et de libre-échange, l'invention de la télégraphie électrique, l'application méthodique des données de la science à la fabrication des produits que les marchands ont mission de distribuer. (A19).
L’ 'histoire du commerce
Le commerce au Moyen Âge
La désagrégation de l'Empire romain, et la constitution à l'Ouest de l'Europe d'Etats germaniques (les invasions Barbares) firent succéder à la centralisation romaine un état politique tout autre. Elles eurent aussi pour résultat d'isoler presque l'Occident de l'Orient. L'histoire commerciale du Moyen âge comprend donc, comme l'histoire politique médiévale, deux groupes de faits bien distincts, ceux qui sont relatifs au commerce de l'Orient, et ceux qui sont relatifs au commerce de l'Occident. Nous les exposerons tour à tour dans l'ordre suivant : en premier lieu, nous parlerons de l'Empire byzantin qui prolongeait l'Empire romain en Orient; puis des Arabes qui s'étendirent jusqu'en Occident, mais restèrent un peuple oriental; puis des Italiens dont les grandes villes commerciales servirent d'intermédiaires entre l'Orient et l'Occident; viendront ensuite les nations franchement occidentales; les Pays-Bas qui furent au Moyen âge le centre économique de l'Europe occidentale, la France, l'Allemagne, qui par la Hanse centralisa le commerce de la mer du Nord (Angleterre) et de la Baltique (pays scandinaves).
Commerce des Byzantins.
Après la chute de Rome, l'empire d'Orient conservait, à l'est, les traditions antiques et le commerce (Le commerce dans l'Empire Romain, le commerce des Byzantins). Constantinople, qui, grâce à son admirable situation, avait déjà joui d'une grande prospérité commerciale sous le nom de Byzance, remplaça Rome, comme métropole non seulement politique, mais commerciale. Non que l'activité commerciale animât sa population; sans les étrangers, Constantinople ne fut pas devenue un grand entrepôt. Le commerce des denrées les plus nécessaires à la vie fut déclaré monopole de l'État, et les autres branches du commerce intérieur ne furent pas moins entravées. Mais sur ce grand marché les Italiens et les Arabes, les Allemands et les Slaves, se donnèrent rendez-vous et déterminèrent un mouvement d'affaires considérable. Le commerce byzantin peut se diviser, d'après les routes qu'il suivait, en trois branches : le commerce de l'Orient, celui de l'Occident et celui du Nord. Les relations avec l'Orient offrent un fait de grande importance. Sous le règne de Justinien, deux moines apportèrent de l'Inde à Constantinople des oeufs de ver à soie soigneusement enfermés dans une canne, et introduisirent en Grèce la nouvelle industrie qui ne tarda pas à prospérer. La fabrication de la soie s'établit à Constantinople, à Athènes et à Corinthe, d'où elle allait passer en Italie
Commerce des Arabes.
A cette époque, un peuple, composé d'une grande partie de nomades, mais sur le littoral duquel florissaient depuis longtemps la navigation et le commerce, étendait, avec une rapidité inouïe, sa domination, d'un côté jusqu'à l'océan Atlantique, de l'autre jusqu'aux frontières de la Chine. Il étendit en même temps son commerce sur cet immense espace (Le commerce des Arabes au Moyen Âge). Le Coran recommande le commerce et l'industrie comme des occupations agréables à Dieu. Aussi chacune des conquêtes des Arabes en était une aussi pour le commerce : partout où ils pénétraient, ils portaient la vie et le mouvement. Les caravanes voyageaient sans obstacles au milieu de leurs armées. Un fait qui avait existé pendant l'Antiquité, notamment chez les lndiens et chez les Égyptiens (L'Egypte antique et le monde extérieur), l'association de la religion avec le commerce, se retrouve chez les Arabes sur une plus grande échelle. Dans les chefs-lieux des provinces, on éleva des mosquées, on fonda des écoles. Par là, ces localités virent augmenter leur population, et devinrent des centres religieux et commerciaux. Les pèlerins venaient de loin tant pour remplir leurs devoirs de piété que pour échanger leurs marchandises. Le plus célèbre des pèlerinages était celui de La Mecque. Diverses dispositions pleines de sagesse prêtaient assistance aux caravanes, nécessaire en Asie et en Afrique, principal théâtre du commerce des Arabes. Ainsi le gouvernement affectait des sommes considérables à la construction et à l'amélioration des routes. Il fait creuser des puits, établir des hôtelleries et poser des pierres milliaires pour marquer les distances.
...
Les entraves au commerce.
Le commerce interurbain se heurtait à des obstacles qui avaient été presque infranchissables dans les premiers siècles du Moyen Age et qui restèrent très gênants jusqu'à la fin : les routes étaient fort mal entretenues, les ponts très rares tombaient en ruines.
Il se forma des associations de moines et de laïques charitables pour la construction et l'entretien des ponts (ainsi fut édifié à la fin du douzième siècle le fameux pont d'Avignon). Mais que pouvaient les efforts des « Frères pontifes » contre l'incurie générale des rois et des seigneurs? Les auberges étaient très espacées et les régions montagneuses en étaient totalement dépourvues. L'Église remédia en partie au mal en établissant dans ces contrées déshéritées des hospices, comme celui du Grand-Saint-Bernard et des refuges.
Le banditisme féodal était une entrave plus dangereuse encore. Au XIIIe, le roi de France rendait les seigneurs responsables des vols à main armée commis sur leurs territoires, du moins entre le lever et le coucher du soleil. Mais il ne pouvait complètement empêcher le banditisme (La criminalité au Moyen Âge). Joinville se plaint de la multitude des « malfaiteurs et larrons » qui infestaient Paris. En Allemagne, les Raubritter (chevaliers-brigands) avaient beau jeu. Sur les côtes bretonnes se pratiquait, dit-on, la sinistre industrie des naufrageurs, qui attiraient les vaisseaux sur les rochers en allumant des feux trompeurs.
Les seigneurs faisaient peut-être plus de mal encore en arrêtant à tout moment ceux qui transportaient des denrées pour leur faire payer un droit de passage, appelé péage ou coutume. Même quand ces droits n'étaient pas élevés, la manière dont ils étaient perçus les rendait vexatoires et parfois ruineux. Les péages mettaient le vin en perce ou fouillaient les paniers de marée fraîche pour choisir quelques beaux poissons et détérioraient ainsi la marchandise. La royauté et l'Église elles-mêmes entravaient le commerce, l'une en faisant varier fréquemment la valeur des monnaies, l'autre en interdisant le prêt à intérêt, sauf le prêt en commandite. Le commerce de l'argent fut ainsi abandonné aux juifs, à qui toute autre profession était interdite. De leur côté, les Cahorsins ou gens de Cahors trouvèrent d'ingénieux artifices pour échapper aux prescriptions de l'Eglise et ne montrerent pas moins d'âpreté dans le négoce que les Juifs.
Les progrès du commerce autour de la Méditerranée et des mers du Nord.
Malgré tant de difficultés et d'entraves, le commerce fit de rapides progrès aux XIe XIIe et XIIIe siècles. Il se produisit alors une véritable renaissance de la civilisation dans l'Europe occidentale. Les pèlerinages et les croisades la mirent en contact avec l'Orient, qui était alors plus instruit et plus riche. La Méditerranée devint un grand foyer d'affaires Venise, Gênes, Pise établirent des comptoirs dans les ports de la Méditerranée orientale et de la mer Noire (Le commerce des Italiens Moyen Âge). Marseille, Montpellier, Narbonne, Barcelone suivirent le mouvement. Les marchands européens allèrent chercher à Alexandrie, à Trébizonde, en Syrie, les produits de l'Orient et de l'Extrême-Orient : soieries, mousselines, parfums, médicaments, plantes tinctoriales, ivoire, pierres précieuses, et surtout les épices, clous de girofle, cannelle, muscade, poivre, si recherchées alors pour relever le goût des mets et des boissons. Ils fournissaient aux Orientaux des draps de Flandre, des armes, du vin. Au XIIIe siècle, les Européens se mirent à fabriquer des tissus de luxe, des tapis, des glaces, du sucre, à l'imitation des Orientaux. En même temps l'ordre rétabli par les princes facilitait les progrès de l'activité commerciale (La géographie au Moyen Âge).
Venise : greniers publics et fondaco dei Turchi.
Les anciens greniers publics (deposito del Megio) de Venise et, à droite, la fondaco dei Turchi, qui accueillait la maison de commerce des Turcs dans la Cité des doges.
© Photo : Serge Jodra, 2012.
Tandis que le commerce des marchandises de luxe enrichissait les ports méditerranéens, un autre foyer commercial se formait dans les mers du Nord. Il ne devint important qu'au XIIIe siècle (Le commerce des pays du Nord au Moyen Âge). Les ports de la mer du Nord et de la Baltique, Bruges, Amsterdam, Londres, Lubeck, Brême, Hambourg, Bergen, Riga, échangeaient les lainages de Flandre, la laine et les peaux d'Angleterre, les bois de Norvège, les minerais de Suède, les fourrures et les cuirs de Russie. Les harengs de la Baltique nourrissaient les peuples en carême. Bruges était le grand port du Nord. Elle eut jusqu'à 150.000 habitants, et le luxe de ses bourgeoises humilia une reine de France, la femme de Philippe le Bel.
Les courants commerciaux transcontinentaux.
Entre les deux groupes de mers intérieures, s'établissaient plusieurs courants transcontinentaux : le principal partait de Venise, passait les Alpes au col du Brenner et descendait la vallée du Rhin, un autre suivait la voie naturelle que dessinent à travers la France les vallées du Rhône, de la Saône, de la Seine ou de la Marne. Les marchands suivaient autant que possible les voies fluviales, mais ils prenaient aussi les routes de terre. Ils se formaient en caravanes, pour mieux résister aux brigands, et au besoin achetaient aux seigneurs des sauf-conduits. Des marchés importants se formaient aux croisements des routes, à Lyon, Toulouse, Orléans, Paris, Reims, Bâle, Cologne. Enfin l'Océan Atlantique mettait Bayonne, Bordeaux, Nantes en relations avec Londres et Bruges.
Les guildes.
Au XIVe siècle, les vaisseaux vénitiens allèrent directement y porter les épices. Pour s'entraider et lutter ensemble contre les ennemis du commerce, les marchands formèrent des associations. Dans le Nord c'étaient des corporations appelées ghildes ou guildes et hanses. Elles étaient plus riches, plus libres, plus hardies que les corporations d'artisans ou de petits boutiquiers. C'est d'elles que vint d'ordinaire l'initiative du mouvement communal. Elles se faisaient donner le monopole du commerce dans une certaine région. Ainsi la hanse des marchands de l'eau, à Paris, était seule maîtresse de la navigation de Montereau à Mantes, la hanse des Bourguignons regnait de même sur la haute Seine, et la guilde de Rouen sur le cours inférieur du fleuve. La hanse parisienne tenait dans la vie de la cité une telle place qu'elle constitua la municipalité de Paris; son chef, le prévôt des marchands, acquit sur le peuple parisien l'autorité d'un maire, et l'emblème de la hanse, un vaisseau, figure sur les armoiries de la Ville de Paris. Dans les villes du midi, se formèrent entre les marchands des associations plus étroites de véritables compagnies de commerce.
