Débuter l’analyse et le conception avec la méthode Merise
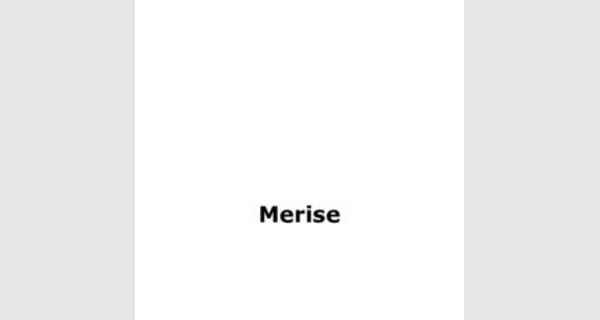
Merise
Sommaire
INTRODUCTION..6
MERISE est une méthode de développement des projets informatiques de gestion.
1 La démarche Merise : 3
découpages sur 4
niveaux..6
1.1 Trois découpages .6
1.2 Quatre niveaux : conceptuel, organisationnel, logique et physique
7 2. L'organisation et les étapes d'un projet informatique.10
CHAPITRE I LE NIVEAU CONCEPTUEL11
1 REPRESENTER L'ACTIVITE.11
2 MODELE CONCEPTUEL DE COMMUNICATION.11
2.1 Intervenant .11
2.2 Flux .15
2.3 Information .17
2.4 Exemple de MCC, messages et informations 19
2.5 Résumé du MCC .20
3 MODELE CONCEPTUEL DE TRAITEMENT...21
3.1 le modèle conceptuel de traitements reflète le pourquoi indépendant de l'organisation. 22
3.2 Opération conceptuelle 22
3.3 Résumé du MCT .25
4 MODELE CONCEPTUEL DE DONNEES.25
4.1 Le concept : l'individu ..26
4.2 L'association de concepts, la relation ..29
4.3 Rappel sur les notions d'occurrences et d'ensemble. ..33
4.4 Contraintes. 34
4.5 Quelques pièges à éviter pour construire les modèles 45
4.6 Modèles équivalents ..57
4.7 Résumé du MCD. ..67
4.8 Exercices 68
5 VALIDATION DES MODELES ENTRE EUX..70
5.1 informations des messages / individus et relations ..70
5.2 Modèles des opérations. 72
6 VALIDATION DE L'UTILISATEUR...747
RESUME GENERAL DU CONCEPTUEL..75
CHAPITRE II : LE NIVEAU ORGANISATIONNEL78
1 POSTE DE TRAVAIL ET ORGANIGRAMME...78
1.1 Poste de travail. .78
1.2 Organigramme. ..79
2 MODELE ORGANISATIONNEL DE TRAITEMENT (MOT)82
2.1 La procédure est composée d'opérations organisées (Quoi ?) par des postes de travail (Qui ?) 83
2.2 Tâche-homme et tâche-machine sont dans l'opération .84
2.3 Exemple de procédure ou MOT ..85
3 MODELE ORGANISATIONNEL DE DONNEES (MOD)86
3.1 L'organisation par site de mémorisation ..87
3.2 Evaluation des volumes des données ..88
3.3 Le modèle de données s'organise : de nouveaux individus apparaissent. .89
3.4 L'étude des documents existants .91
4 MODELE ORGANISATIONNEL DE COMMUNICATION (MOC) : les messages échangés entre sites..91
5 VALIDATION MOD/MOT...93
5.1 Messages organisés/individus et relations organisés ..93
5.2 Modèles en création et en consultation des opérations organisées ..96
6 VALIDATION PAR L'UTILISATEUR...98
7 RESUME DU NIVEAU ORGANISATIONNEL..98
CHAPITRE III LE NIVEAU LOGIQUE..102
1 LE MODELE LOGIQUE DE DONNEES, un exercice intellectuel.103
1.1 Enregistrement. ..103
1.2 Chemin .105
1.3 Construction du Modèle Logique de Données. .105
1.4 Optimisation 111
2 MODELE LOGIQUE DE TRAITEMENT.114
2.1 Opération organisée et outils informatiques ..114
2.2 Outils informatiques 115
2.3 Outil interactif 117
2.4 Outil en traitement différé 122
3 MODELE LOGIQUE DE COMMUNICATION..123
4 VALIDATION DONNEES/TRAITEMENT.124
4.1 Validation MOD / outils. ..124
4.2 Validation MLD / outils .125
4.3 Validation des outils par les actions de mise à jour de données d'enregistrement 125
5 VALIDATION DE L'UTILISATEUR.126
6 RESUME DU NIVEAU LOGIQUE126
CHAPITRE IV LE NIVEAU PHYSIQUE129
1 MODELE PHYSIQUE DE DONNEES..130
1.1 Information ou lien ..130
1.2 SGBD hiérarchique 130
1.3 SGBD navigationnel ou réseau .132
1.4 SGBD relationnel 134
1.5 Eclater ou regrouper les enregistrements physiques. ..144
2 MODELE PHYSIQUE DE TRAITEMENT.145
3 MODELE PHYSIQUE DE COMMUNICATION..146
4 VALIDATION MPT/MPD1465 RESUME DU NIVEAU PHYSIQUE...146
CHAPITRE V RESUME DES MODELES149
1 RESUME DES COMMUNICATIONS...149
2 RESUME DES TRAITEMENTS..149
3 RESUME DES DONNEES...149
CHAPITRE VI L'ORGANISATION D'UN PROJET..151
LES ACTEURS D'UN PROJET.151
SCHEMA DIRECTEUR : le découpage en domaines et la planification.151
3 ETUDE PREALABLE : le choix de l'organisation et des outils informatiques. 154
3.1 L'existant 154
3.2 Micro-informatique ou un seul site ..155
3.3 Plusieurs sites 156
ETUDE DETAILLEE : spécifications externe et interne..157
4.1 Cas d'un seul site. .157
4.2 Cas d'informatique multi-sites. 157 5 REALISATION : le test de la méthode158
6 LES POINTS FORTS DU PROJET...158
CHAPITRE VII LA META-PHYSIQUE : MAINTENANCE, FORMATION ET
DOCUMENTATION.160
1 UN DICTIONNAIRE DE DONNEES, SINON RIEN160
2 LA DOCUMENTATION AUTOMATIQUE EXISTE...160
3 QUI DIRIGE QUI ? Le conceptuel ou le physique..160
CHAPITRE VIII EXEMPLES DE MODELES DE DONNEES.162
1 META-MODELE.162
1.1 MCC ..162
1.2 MCT et MOT .163
1.3 MCD et MOD 164
1.4 MLT ..164
1.5 MLD et MPD .165
1.6 Validations (conceptuel, organisationnel et fin d'étude préalable) ..165
2 COMPTABILITE166
2.1 Représentation des flux externes et internes 166
2.2 Compte ou pôle d'analyse .167 2.3 Les deux comptabilités .169
CHAPITRE IX SOLUTION DES EXERCICES..174
1 CONCEPTUEL.174
1.1 MCC ..174 1.2 MCT ..174
1.3 MCD .174
2 ORGANISATIONNEL.176
3 Logique.177
4 Physique.1785 RESUME178
CHAPITRE X : EXERCICES.180
1 MODELE CONCEPTUEL180
1.1 Modèle conceptuel de communication ..180
1.2 Modèle conceptuel de traitement ..185
1.3 Modèle conceptuel de données 186
1.4 Validation MCD/MCT 188
NIVEAU ORGANISATIONNEL..188
2.1 MODELE ORGANISATIONNEL DE TRAITEMENT 188
2.2 Modèles organisationnels de données ..190
2.3 Modèle organisationnel de communication ..190
NIVEAUX LOGIQUE ET PHYSIQUE191
3.1 Liste des outils informatiques par procédure .191
3.2 Validation liste des outils / MOD et planification 191
3.3 Modèle physique de données .192
3.4 Validation liste des outils / MLD. 193
3.5 Modèle logique de traitement 193
3.6 Modèle logique de communication 195
CHAPITRE XI 10 CRITERES DE CHOIX D'UN OUTIL D'AIDE A LA CONCEPTION 196
Pourquoi choisir un outil d'aide à la conception?.196
- Quels critères doit-il remplir ?..197
CHAPITRE XII EXERCEZ-VOUS (DOCUMENTS AUTORISES).199
Enoncé.199
Informatique et méthode ..199
Les 3 niveaux de MERISE ..200
Gestion de projet ..203
Le méta modèle ..203
5 La génération d'un Modèle relationnel ..204
CORRIGE..205
Informatique et méthode ..205
Les 3 niveaux de MERISE ..205
Gestion de projet ..209
Le méta-modèle .210
- Générer un modèle relationnel
210 Quel est votre résultat ?..211
GLOSSAIRE.212
Correspondance avec Merise 79 et anglais.214
BIBLIOGRAPHIE ..215
INTRODUCTION
Il faut ouvrir des cadenas différents avec des clés différentes.
(Proverbe chinois)
Ce chapitre d'introduction donne une vue globale de la méthode MERISE. Le lecteur pourra aborder dans les chapitres suivants le vocabulaire et les détails de la méthode avec plus de facilité.
MERISE est une méthode de développement des projets informatiques de gestion.
Elle tire son nom du MERISIER qui est un arbre porte-greffe. De façon analogue, MERISE est le résultat de la greffe de plusieurs méthodes. Une deuxième explication vient du fait que le mot MERISE se trouvait en haut à gauche d'un dictionnaire ouvert à la lettre M.
Elle s'adresse à toutes les applications sur micro, mini-ordinateur ou grands systèmes informatiques. Par commodité, l'organisme à informatiser sur lequel s'applique la méthode est appelée ici entreprise.
Merise est actuellement la méthode la plus répandue en France. Historiquement, la première version officielle de Merise date des travaux coordonnés par le Ministère de l’industrie en 1979 ; le groupe de projet comprenait, outre une équipe de recherche dirigée par M. H. TARDIEU, plusieurs sociétés de service. Depuis, plusieurs versions ont été développées. Voici venu le temps des MERISES. L'ouvrage de référence de la méthode est celui de MM H. TARDIEU, ROCHFELD et COLETTI (Référence
1).
1 La démarche Merise : 3 découpages sur 4 niveaux.
1.1 Trois découpages
Pour étudier et développer l'informatique d'une entreprise ou de tout type d'organisme, il est nécessaire de connaître ses échanges internes et avec l'extérieur, comment elle réagit à une sollicitation externe et quelle est la structure des informations qu'elle utilise.
La méthode MERISE décrit cette connaissance sous forme de trois découpages : communication, traitement et données.
Communication
Les échanges ou la communication sont des flux entre systèmes, notamment des flux d'informations ou messages.
Traitement.
Les traitements des messages, flux d'informations, décrivent les tâches à effectuer à la réception ou pour l'émission d'un flux d'informations.
Données.
La structure de mémorisation des informations est représentée sous une forme qui permet un passage aisé vers les "enregistrements informatiques".
1.2 Quatre niveaux : conceptuel, organisationnel, logique et physique.
L'informatique consiste à mettre à disposition de l'utilisateur des moyens ou des outils de gestion informatique. Avant de spécifier les moyens informatiques, il est nécessaire de définir le travail de cet ou de ces utilisateurs finals, de définir l'organisation du travail au sein de l'entreprise. Afin de déterminer cette organisation, l'analyse des objectifs et des fonctions majeures de l'entreprise doit être menée. Ainsi, l'informatisation est conçue en fonction de l'organisation et l'organisation en fonction des objectifs à atteindre.
L'enchaînement de l'informatique, de l'organisation et de la fonction nécessite un découpage en niveaux de la démarche d'informatisation. Ces niveaux sont nommés conceptuel pour l'étude des fonctions et organisationnel pour l'étude de l'organisation. Le niveau définissant l'informatique est séparé en deux : un niveau décrivant l'informatique sans choix de matériel ou de logiciel précis, le niveau logique, et un niveau décrivant le résultat de la méthode ou l'informatisation finale, le niveau physique. Si les choix de matériel ou de logiciel sont effectués, certaines phases du niveau physique sont abordables directement.
L'adoption de la méthode entraîne la définition des fonctions générales de l'entreprise avant la définition de l'organisation et avant la définition des outils informatiques. L'informatique n'est abordée qu'au troisième niveau, si ce type de solution est retenu.
Il suffit, pour remonter ou descendre d'un niveau, de poser les questions :
n Pourquoi ? Alors, je remonte vers l'invariant.
n Comment ? Alors, je descends vers le plus mobile.
FONCTION
ORGANISATION
INFORMATIQUE
Les objectifs de l'entreprise : le niveau conceptuel.
Le plus invariant, le niveau conceptuel, définit les fonctions réalisées dans l'organisme. Il répond à la question QUE FAIT L'ORGANISME ? Il est déterminé par son activité. L'étape précédente, l'interrogation du pourquoi de l'activité, cette remise en question de l'entreprise, n'est pas abordée par Merise.
Les postes de travail de l'entreprise : le niveau organisationnel
Pourquoi une organisation ? Pour réaliser les fonctions de l'entreprise décrites dans la première partie. Cela répond à la question QUI FAIT QUOI ?
Dans le cas de développement sur micro-informatique ou dans le cas où l'application ne concerne qu'une seule personne, le niveau organisationnel se ramène à sa plus simple expression, un seul poste de travail.
Conceptuel et organisationnel représentent toute l'entreprise. Les deux niveaux suivants ne prennent en compte que la solution informatique retenue.
L'informatique universelle : le niveau logique ou externe.
Puis, plus variable, est la forme que doit prendre l'outil informatique pour être adapté à l'utilisateur, à son poste de travail. C'est le niveau logique, la maquette des enchaînements d'écran et la réponse à la question AVEC QUOI ? ou plus exactement AVEC L'AIR DE QUOI ? Le logique est indépendant de l'informatique spécifique, des langages de programmation ou de gestion des données.
L'informatique spécifique : le niveau physique ou interne.
Le dernier niveau, le plus variable, est l'outil informatique lui-même, les fichiers, les programmes. AVEC QUOI ? Ce niveau est appelé niveau physique.
Ce niveau dépend à 100% du système informatique retenu, du type de la base de données et des outils de développement. MERISE est d'un secours précieux dans le cadre des données. La structure "physique" informatique des données tend à être normalisée. Le passage, à l'aide de règles, à ces représentations normalisées est facile. C'est à cet instant que la méthode justifie son utilisation dans le cadre de développement sur microordinateurs. Le modèle conceptuel de données engendre le modèle physique de données.
L'existence des quatre niveaux permet un suivi méthodique. Cette étude se conduit sans retour entre chaque niveau.
Le niveau inférieur peut être modifié sans affecter le niveau supérieur. Par exemple, le niveau organisationnel peut être modifié sans affecter le niveau conceptuel.
Le niveau inférieur doit être étudié après le niveau supérieur. Le niveau logique est abordé après le niveau organisationnel et a fortiori après le niveau conceptuel. Deux validations sont effectuées à chaque niveau avant d'aborder le niveau inférieur. La première concerne la cohérence des modèles entre eux. La deuxième est l'approbation de l'utilisateur.
Les retours sur le niveau précédent sont faibles
Une validation des modèles entre eux est "à cheval" sur plusieurs niveaux.
La fin de l'étude préalable, date importante dans la vie d'un projet, décide de la réalisation du reste de l'étude. Ce choix s'effectue à partir de la liste des outils informatiques. La validation entre données et traitement est effectuée entre chaque outil retenu du niveau logique et les modèles organisationnels de données. Cette validation vérifie l'exhaustivité de la liste des outils informatiques à développer.MERISE se résume à :
A- 3 découpages sur 4 niveaux.
n trois découpages (communications, données et traitements) fois
n les quatre niveaux conceptuel (quoi ?), organisationnel (qui fait quoi ?), logique (avec l'air de quoi ?) et physique (avec quoi ? ou comment ?) donnent douze modèles.
Merise décrit ces modèles sous forme de dessins.
n MCC = Modèle Conceptuel de Communication n MCD = Modèle Conceptuel de Données n MCT = Modèle Conceptuel de Traitements
Les "temps forts" de la méthode sont le Modèle Conceptuel de Communication (MCC), le Modèle Conceptuel de Données (MCD) et le Modèle Organisationnel de Traitement (MOT). Parmi ces trois modèles, le plus important concerne la représentation des modèles conceptuels de données.
- La représentation des modèles conceptuels de données.
Cette représentation des données est une représentation du système d'information analysée à partir de la manière de parler, de "croquis de langage" (référence 2). En effet, la manière de parler reflète la façon dont une personne a mis en mémoire et a structuré ses pensées et ses données. Cette syntaxe est aisément représentée sous forme de dessins.
La forme sous laquelle est réalisée cette représentation de données s'appelle formalisme individu-relation. Elle permettra de déterminer les individus et les relations entre individus. Le choix de ce qui sera individu ou relation est le cœur de la méthode MERISE. Les individus sont indépendants. Les relations ont toujours besoin des individus pour exister et sont toujours perçues comme relation de Ce formalisme est considéré comme la partie essentielle de la méthode.
A partir d'une phrase simple, d'une description en langage naturel telle que "le client passe une commande", la méthode consiste à découvrir des concepts et leurs liens mutuels. Ceux-ci représentent la structure de mémorisation sur laquelle s'appuie la phrase du discours. L'examen du langage sert à retrouver le "non-dit" de la structure. Cette structure de mémorisation est exprimée sous forme de rectangle et d'ellipse. Un nom devient un rectangle, un "individu" et un verbe une ellipse, une "relation".
"Le client passe une commande"
- L'organisation et les étapes d'un projet informatique
Un planning général de développement ou schéma directeur détermine les principaux projets à développer et leur enchaînement.
Les études préalables à la réalisation informatique comprennent les niveaux conceptuels et organisationnels et une partie du logique : la liste des outils informatiques et la validation de ces outils par les modèles organisationnels de données. Le résultat de l'étude préalable est impérativement approuvée par tous les acteurs du projet : utilisateur, informaticien, direction Cette phase entraîne le choix des futurs outils informatiques "utilisateur", des outils de développement informatiques et des futurs investissements.
CHAPITRE I LE NIVEAU CONCEPTUEL
Sans entrer dans la tanière du tigre, comment capturer ses petits ? (Proverbe chinois)
1 REPRESENTER L'ACTIVITE
L'objectif est de représenter l'activité de l'entreprise et de formaliser son "système d'information" indépendamment de son organisation.
Le compte rendu de cette étude est matérialisé sous la forme de dessins normalisés, de modèles complétés par un dossier explicatif. Le but de ce chapitre est d'expliquer comment décrire l'entreprise concernée en respectant les normes de chaque modèle.
Le modèle de communication formalise les échanges d'informations entre systèmes fonctionnels et identifie les systèmes "à mémoire".
Le modèle de traitement formalise, comme son nom l'indique, les traitements effectués par un système fonctionnel, comment l'entreprise réagit à une réception d'informations, ou quand, spontanément, elle décide d'émettre des informations.
Le modèle de données est la référence de l'activité de l'entreprise, la manière dont elle perçoit et mémorise son activité. Il formalise toutes les informations mémorisées. Ces informations sont structurées, regroupées en ensembles appelés individus et en ensembles appelés relations entre les individus : les rectangles et les ellipses de MERISE qui vous seront bientôt familiers.
2 MODELE CONCEPTUEL DE COMMUNICATION.
Une approche théorique est faite avec l'étude des systèmes, la systémique. Celle-ci repose sur les principes suivants :
1 - Une approche du général au particulier. Tout système se décompose en systèmes.
2 - La méthode s'attache à identifier les échanges entre systèmes. 3 - La systémique amène à décomposer l'entreprise en systèmes homogènes d'information appelés domaines.
2.1 Intervenant
Application de ces principes.
- Du général au particulier et décomposition en systèmes.
L'entreprise est considérée comme un système. L'extérieur, avec qui l'entreprise effectue ses échanges est aussi perçu comme un ensemble de systèmes. L'entreprise est découpée en systèmes fonctionnels ou conceptuels. Systèmes externes et internes sont appelés intervenants.
Tout est SYSTEME ou FLUX entre systèmes
L'ENTREPRISE est un système qui peut être découpé en systèmes FONCTIONNELS, les INTERVENANTS
Soit une entreprise de livraison. Ses intervenants sont livrer, facturer et encaisser. Ils sont spécifiques de l'entreprise.
2.1.1 partenaire
Un partenaire est un intervenant extérieur à l'entreprise. Il peut être perçu de manière FONCTIONNELLE et décrit par un verbe : client (qui paye), fournisseur (qui ), courtier (qui sert d'intermédiaire), associé (qui partage les risques ou les profits) ou PHYSIQUE, société, Banque de France, personne morale, personne physique, Etat. La perception fonctionnelle est préférable à la perception physique : ne voir que le payeur dans le client, ce qui n'empêche pas d'avoir tous les égards pour sa personne.
Un partenaire physique est perçu sous plusieurs vues fonctionnelles : si la société EDF est à la fois fournisseur et cliente d'une même entreprise, elle sera vue "fonctionnellement" de cette entreprise de deux manières différentes, fournisseur (d'énergie) et client (payeur).
2.1.2 domaine et sous-domaine
Ils sont l'application du troisième principe de systémique : l'existence de systèmes d'information homogènes.
Un découpage trop fin de l'entreprise entraînerait une perte de cohérence de la fonction. Un niveau de ce découpage est identifié, représentant un "tout homogène".
Un domaine est un système de l'entreprise qui a la caractéristique d'avoir une mémoire, un système d'information. Le système d'information sera construit par domaine.
L'entreprise est décomposée en domaines décomposés en sous-domaines, somme de fonctions élémentaires.
Exemple : l'entreprise est entourée des systèmes tels que Client, Etat les partenaires. Elle est découpée en domaines : vendre, produire, assurer la vie sociale, qui dépendent de son activité. Ces domaines sont décomposés en systèmes appelés sous-domaines. "Produire" peut être découpé en "Maintenir", "Assurer l'approvisionnement des chaînes de production"
Les INTERVENANTS sont EXTERNES (PARTENAIRES) ou INTERNES à l'entreprise
(DOMAINES et SOUS-DOMAINES)
Un sous-domaine est fonctionnel, joue un rôle. Si la vue est physique et le nom donné à un sous-domaine un signe d'organisation (back office ou gestion administrative, front office ou négociateurs, piloter ou chef), il faut en dégager la vue fonctionnelle. Un verbe peut définir un domaine ou un sous-domaine. Il représente une fonction, un nom représente plus une entité physique ou morale (organisation, personne).
Exemples de domaines et de verbes associés : Trésorerie (optimiser les flux financiers), Ventes (vendre, connaître les souhaits des clients), Comptabilité générale (se conformer à la législation, assurer la sortie des documents comptables dans les délais impartis), Pilotage (décider et suivre les budgets, décider et suivre la planification). Toutes les définitions sont sujettes à remaniement suivant le contexte.
A chaque domaine ou sous-domaine, des objectifs ou des critères d'appréciation du résultat peuvent être définis : trésorerie, comparaison avec un taux standard du marché monétaire ; ventes, nombre de clients conservés ou nouveaux, chiffre d'affaires ; comptabilité générale, observations du commissaire aux comptes ou délai de remise des documents.
Dans le cas de petits services où les mêmes personnes effectuent plusieurs fonctions, cette étape de définition des sous-domaines doit être limitée dans le temps. En général, il existe plus de fonctions que de personnes et l'utilisateur a beaucoup de peine à s'affranchir de l'organisation. La définition des différentes fonctions est alors effectuée par rapport à la définition des postes de travail actuels, portant préjudice à une définition correcte des fonctions.
Pour identifier les domaines, deux approches sont possibles :
n soit ne voir directement que les fonctions majeures qui répondent à la question pourquoi ?
n soit, si la première démarche n'aboutit pas à un accord général, énumérer des fonctions élémentaires en réunion de "brain storming" et les regrouper en sous-domaines, puis en domaines. Pour cela, répondre toujours à la question pourquoi ? Pourquoi gérer des stocks, pourquoi tenir une comptabilité, pourquoi enregistrer une commande ? Ainsi sousdomaines et domaines seront découverts.
Exemple : soit les fonctions analyser la production, produire, gérer les stocks, maintenir, gérer les pièces détachées, suivre les pannes et gérer les réparations.
Plusieurs découpages
Nous allons recomposer ces fonctions en les réunissant en ensembles ou systèmes fonctionnels en posant la question pourquoi ?
L'exercice pourrait s'intituler "Manger pour vivre ou vivre pour manger ?" La règle à appliquer est : lorsque ceci explique cela, mettre cela dans le cercle de ceci.
L'entreprise est découpée en domaines, sous-domaines et fonctions élémentaires.
n Pourquoi analyser la production ? Pour produire à moindre coût.
n Pourquoi produire ? Pour vendre.
n Pourquoi gérer les stocks ? Pour approvisionner la production.
n Pourquoi maintenir ? Pour produire.
n Pourquoi gérer les pièces détachées ? Pour approvisionner la maintenance.
n Pourquoi suivre les pannes ? Pour planifier les réparations.
n Pourquoi gérer les réparations ? Pour planifier les réparations.
Si les réponses précédentes sont correctes, nous arrivons à la découpe suivante :
sont possibles.
Les fonctions élémentaires, telles que analyser , gérer , suivre , etc., sont trop fines et n'ont pas de véritable finalité. Elles ne sont pas traitées dans l'analyse de l'entreprise.
2.2 Flux
Les intervenants définis, intéressons-nous aux échanges entre ceux-ci. Suivant la systémique, ces échanges sont plus importants que les intervenants.
Des flux sont échangés entre des émetteurs et des récepteurs, les intervenants. Ils peuvent être réels (produit, énergie, argent) ou d'information, les messages.
Le modèle de communication représente tous les flux et toute l'activité de l'entreprise. Un dessin ne représentant que les messages est un sousensemble du modèle de communication. Seul, ce sous-ensemble est détaillé par la suite. En effet, non seulement les flux physiques sont suivis par des messages porteurs d'informations, mais encore, l'informatique ne traite que des informations.
2.2.1 Construction du MCC.
Pour s'aider, la construction d'un graphe des flux réels (physiques ou financiers) est conseillée.
Bien différencier les flux physiques et d'informations : un catalogue imprimé, vu de l'imprimeur, est un flux physique. Il s'apparente à un produit. Le même catalogue, envoyé au client, est perçu comme un message.
Exemple : produit livré, virement bancaire L'entreprise donne le produit à livrer à un livreur qui livre le même produit au client. Les flux physiques de "produits" sont entre entreprise et livreur et livreur et client. Si le client apporte de l'argent liquide à sa banque, le flux financier "liquidité" existe entre Client et Banque. Enfin l'entreprise est payée par un virement, flux financier, de la Banque.
Voici les flux "réels".
2.2.2 message
Un flux est appelé message quand il est ensemble d'informations.
Le modèle conceptuel de communication MCC représente les échanges de messages entre intervenants. Les messages décrits sont conceptuels et indépendants de l'organisation. Si un document physique est analysé, les questions sont "quels sont les messages conceptuels de ce document ?", "quels sont les messages qui donneront lieu à une réaction ou une action de l'entreprise ?" Pourquoi ce message et non qui traite le message ?
sous un même "DOCUMENT PHYSIQUE"
Exemple : le document "état des équipements" est envoyé par une filiale en plusieurs exemplaires. Il correspond à plusieurs messages conceptuels différents selon chaque récepteur. Pour l'un, le message est une demande de réparation, pour un autre, un flux de trésorerie à prévoir pour payer la réparation et pour un troisième, une demande d'achat des équipements. Le message organisé ou "physique" comprend trois messages conceptuels :
existent plusieurs messages conceptuels.
Une banque de données reçoit des messages avant d'en donner.
Le conceptuel consiste à trouver le pourquoi. Si nous nous intéressons à l'activité d'une entreprise qui est une Banque de données, la question "Pourquoi des abonnés consultent-ils une banque de données ?" doit être posée. Le message conceptuel émis par la personne qui se connecte sur la banque de données est une demande d'information. Il est nécessaire de s'interroger sur le besoin d'information de l'abonné pour comprendre l'activité de l'entreprise. La question se pose pour des motifs de marketing ou d'étude du client. De manière organisée, seule la banque de données émet des informations.
Deux types de messages sont distingués, les messages enclencheurs ou stimulants et les messages informants. Messages enclencheurs et informants servent à séparer les messages moteurs d'une action et les messages moteurs d'une mémorisation.
message enclencheur
Dans ce cas, l'émetteur du message enclencheur attend une réponse ou une réaction du receveur. Il s'agit, la plupart du temps, d'une demande structurée - demande de remboursement dont les données sont répertoriables : montant dû, date de la créance - ou non structurée : conseil ou avis.
message informant
Un message informant renseigne sur une situation donnée sans attendre une réponse immédiate : cours de la bourse, compte rendu synthétique (reporting) vers la direction générale, journal des ventes, statistiques. Les informations contenues dans ces messages serviront à moyen ou à long terme. Elles constitueront le contexte de la réaction à un futur message enclencheur. Au lieu de tourner sept fois ma langue dans ma bouche, je tourne sept fois mes messages informants dans mon système d'information. Quelquefois, le dernier arrivé est le message enclencheur quand il est attendu pour réagir.
Les messages informants "n'existent pas" entre sous-domaines d'un même domaine. Un domaine a un système d'information commun à tous les sousdomaines. Ce que sait un sous-domaine, un autre le sait aussi en consultant le système d'information propre aux deux sous-domaines. Cela découle du troisième principe énoncé de systémique, l'existence de systèmes d'information homogènes, les domaines. Le message transite par le système d'information.
2.3 Information
L'information ou la donnée ou la propriété est l'atome du système d'information et du futur système informatique. L'information est un "renseignement" ou une "connaissance" élémentaire désignée à l'aide d'un mot ou d'un groupe de mots prenant des valeurs.
Exemple : nom de personne, nombre de portes, nom de maison.
2.3.1 Occurrence d'information.
Une information est un ensemble d'occurrences, de valeurs possibles d'information.
Soit l'information nom de personne. M. Martin, M. Doe, M. Smith, M. Svensson, M. Joe six pack, M. Bolomey ou M. Mueller sont des exemples de nom de personne. Une information est donc un ensemble d'éléments dont M. Martin est un exemple. Chaque élément de cet ensemble est appelé occurrence (avec deux r).
Un autre vocabulaire est de déclarer l'ensemble nom de personne comme information-type par rapport aux informations M. Martin, M. Doe, M. Smith. Dans l'ouvrage, la vue information et occurrence d'information est celle retenue. Il en sera de même pour individu et occurrence d'individu et relation et occurrence de relation que nous verrons plus tard. n Information : exemples d'occurrences d'information n Noms : dunepipe, paspossible, àcoucherdehors
n Conseils : yaqua, fautquon, yavaitcas, fallaitquon, faites mieux la prochaine fois, votre taux d'endettement est trop élevé n Type de voiture : R5, R11, AX,
2.3.2 Validation et épuration du vocabulaire
Des informations peuvent avoir le même sens, des sens différents ou être liées entre elles par composition ou une règle de calcul. Il importe d'identifier le sens de chaque information en supprimant les ambiguïtés de signification et les liaisons entre informations afin de manipuler un vocabulaire "épuré" qui sera mémorisé.
Suppression des polysèmes et des synonymes.
Une information dont le nom a plusieurs sens, est un polysème. Montant peut être le montant de la facture, du contrat, de la commande Il importe d'éclater ces informations en informations n'ayant qu'un seul sens pour éviter toute confusion. Renseigner chaque information identifiée par un texte évitant tout quiproquo.
1ère Signification
Un nom d'information
2ème Signification
un POLYSEME a au moins deux SIGNIFICATIONS
Les synonymes, ou les noms d'informations de même signification, sont plus connus.
1er nom d'information
Une Signification 2ème nom d'information
Deux SYNONYMES ont la même SIGNIFICATION.
Néanmoins, un type de synonymie un peu particulier est à expliciter. Soient les informations "numéro de donneur d'ordre" et "numéro de client". Un donneur d'ordre est un client ayant passé une commande. Un client n'ayant pas passé de commande est un prospect. "prospect" ou "client n'ayant pas commandé" sont synonymes. Par contre, la notion de donneur d'ordre apporte une restriction à celle de client. Un donneur d'ordre est un client qui a commandé. Numéro de donneur d'ordre est un sous-ensemble des numéros de client. Une équivalence "non équilibrée" est donc définie entre ces deux informations. L'information la plus générale "numéro de client" est en amont de l'information "numéro de donneur d'ordre". Noter l'équivalence entre les informations.
