Livre complet sur le commerce international
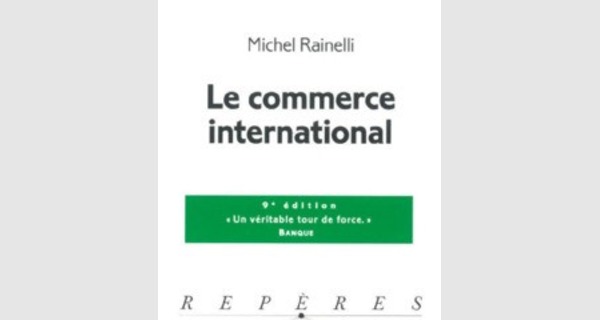
Livre complet sur le commerce international
I / Le commerce international aux XIXe et XXe siècles
Qui échange quoi ? Quelle est la place du commerce international ? Les importations sontelles égales aux exportations ? Ces questions se posent quelles que soient les périodes, et le détour par l’histoire est indispensable pour ne pas confondre des mouvements temporaires, des épiphénomènes, avec des tendances de fond. Avant 1800, le commerce entre les nations peut être expliqué par deux grands motifs, selon que l’on raisonne sur les importations ou sur les exportations. Le premier principe explicatif est celui de l’indisponibilité des biens : un pays importe ce qu’il ne peut produire, en général pour des raisons d’ordre climatique ou bien en l’absence de certains minéraux sur le territoire national (épices d’un côté, métaux précieux de l’autre). Le second est celui de la recherche de débouchés pour les productions nationales. Dans les deux cas, il n’est pas vraiment indispensable de construire une théorie pour expliquer les mouvements internationaux de marchandises.
On présentera les grands traits du commerce mondial, en particulier l’importance des flux et leur composition, entre 1800 et 1913 puis entre 1919 et 1980 ; le rôle du protectionnisme est ensuite envisagé.
Le XIXe siècle et la domination du RoyaumeUni
Le XIXe siècle au sens des historiens prend fin en 1914 ; cette période connaît de nombreux changements que l’on peut saisir autour de deux aspects : la répartition géographique des échanges et leur structure par produits.
La répartition géographique des échanges
Le commerce international a augmenté au XIXe siècle à un rythme très supérieur à celui de la production mondiale. Les données sont certes fragiles et les indicateurs tous critiquables. On peut toutefois convenir d’un ordre de grandeur acceptable en retenant des données par tête : entre 1800 et 1913, le commerce international par tête est multiplié par 25 alors que, dans le même temps, la production mondiale par tête ne l’est que par 2,2 [1]*.
Le taux d’exportation, qui rapporte les exportations au produit national brut, fournit une indication de l’ouverture des pays aux échanges extérieurs. Comme le montre le tableau I, il existe un mouvement général d’ouverture accrue pour l’ensemble des pays européens.
TABLEAU I. — TAUX D’EXPORTATION POUR QUELQUES PAYS EUROPÉENS 18301910 (en pourcentage du PNB)
…
Source : Extrait de P. BAIROCH, Commerce extérieur et développement économique de l’Europe au Xœsiècle, Mouton, Paris, 1976, tabl. 20, p. 79.
* Les chiffres entre crochets renvoient à la bibliographie en fin d’ouvrage.
Ces taux sont peu différents selon les pays mais, en raison du niveau élevé de son PNB, le RoyaumeUni domine largement les échanges. Le tableau II révèle que ce caractère dominant est remis en cause à la fin du XIXe siècle avec l’apparition de nouveaux pays échangistes, le Japon et surtout les États-Unis. (Précisons que ce tableau est construit en ajoutant les exportations et les importations, contrairement au tableau I.)
...
L’apparition du Japon et des États-Unis comme puissances commerçantes n’empêche pas l’Europe de dominer très nettement le commerce mondial. On peut donner, pour 1913, les ordres de grandeur suivants : le commerce intraeuropéen représente 40 % des importations mondiales et les importations européennes (en provenance donc d’autres régions) 22 %. Le reste des échanges mondiaux correspond pour 15 % à des importations de produits européens par les autres régions du monde et au commerce entre pays non européens pour 23 % [1, p. 225]. Plus des trois quarts des importations mondiales concernent donc, sous une forme ou sous une autre, l’Europe.
Les 40 % du commerce mondial correspondant aux échanges intraeuropéens s’effectuent entre des pays dont les niveaux de développement sont proches ; ils ne peuvent donc pas être expliqués par une analyse aussi sommaire que la simple indisponibilité des biens. L’Europe ne constitue pas cependant un ensemble totalement homogène ; les possessions de colonies et leurs localisations différencient le commerce international des grandes puissances. Ainsi, le RoyaumeUni a une originalité due au rôle que joue l’Asie comme zone d’origine des importations et comme lieu de destination des exportations britanniques.
La structure par produits des échanges
La nature des produits échangés par un pays dépend étroitement de celle de ses productions et de ses richesses naturelles. Une première décomposition, grossière, distingue deux secteurs : les produits de l’industrie et les produits primaires (agricoles et miniers). Le réseau du commerce mondial est alors composé d’un bloc de pays industriels, l’Europe, qui achète principalement des produits primaires et vend surtout des produits industriels : selon les estimations de Paul Bairoch, les exportations européennes sont composées de produits manufacturés pour 55 % à 65 % du total, selon les années, alors que les importations comportent 80 % à 90 % de produits primaires.
Même si, globalement, ces chiffres évoluent peu entre 1800 et 1913, la composition des échanges industriels se modifie. La part du textile dans les exportations diminue (de plus, le coton remplace progressivement la laine) alors qu’augmente celle des productions métallurgiques et chimiques. L’évolution est la conséquence du processus d’industrialisation des économies européennes, japonaise et nordaméricaine. Elle illustre un des caractères du commerce international : la nature des biens importés dépend des besoins de la nation, ceux des firmes comme ceux des consommateurs. Les relations entre métropoles et colonies fournissent un cas limite de ce caractère, puisque les territoires ont souvent été conquis pour approvisionner la métropole. Ainsi, dans le cas français, l’empire colonial fournit une part essentielle des matières premières agricoles importées, par exemple pour les secteurs des corps gras ou du sucre [3, p. 5156].
Le XXe siècle et l’émergence de nouvelles nations dominantes
De la fin de la Première Guerre mondiale à 1980, le commerce mondial traverse deux périodes contrastées. Dans l’entredeuxguerres, la crise de 1929 et les politiques économiques qui l’accompagnent ralentissent l’expansion : le commerce mondial par tête ne croît que de 3 % entre 1913 et 1937. En revanche, après la Seconde Guerre mondiale, les taux de croissance sont impressionnants, supérieurs à ceux de la production : environ 6 % par an entre 1948 et 1960, 8,8 % par an entre 1960 et 1973 et 4 % par an entre 1973 et 1980.
L’entredeuxguerres
Le premier aspect qui nous retiendra est la poursuite d’une tendance antérieure : le RoyaumeUni perd progressivement sa place prééminente, les nouvelles puissances montantes étant les États-Unis et, plus modestement, le Japon.
...
Les problèmes de mesure des flux commerciaux
Les données relatives au commerce international sont tout d’abord élaborées par des services nationaux puis homogénéisées par des organismes internationaux qui publient des recueils statistiques. Pour rendre les chiffres comparables, les flux, mesurés initialement en monnaies nationales, sont convertis en dollars. Dans une perspective de moyenne ou longue période, cette pratique pose un problème bien connu. Un chiffre en valeur peut augmenter soit en raison d’une variation des quantités échangées, soit à la suite d’une modification des taux de change des monnaies contre le dollar. Il est donc parfois difficile d’interpréter correctement les évolutions. Bien qu’imparfaites, les données en valeur (en fait en dollars) sont en général les seules disponibles.
Par ailleurs, toute étude de long terme bute sur l’indisponibilité de séries statistiques homogènes. Ce n’est que depuis le début des années soixante, avec des initiatives prises par des organismes internationaux (ONU, FMI), que les méthodes d’estimation des importations et des exportations sont identiques dans la plupart des nations. Les chiffres antérieurs sont donc à la fois difficiles à réunir et peu fiables. Les données du GATT, construites à partir des statistiques de l’ONU, ne sont en général disponibles qu’à partir de 1963 et, pour quelques variables seulement, de 1955. Cela explique le caractère non systématique de l’information présentée entre 1945 et 1963, et plus encore pour les périodes antérieures. Il est impossible d’offrir pour le XIXe siècle et le début du XXe siècle les mêmes indicateurs que ceux utilisés dans le chapitre II pour la période récente.
plus fine permet de voir des bouleversements au sein du groupe des produits industriels. Les travaux de Jacques Mistral, sur lesquels nous reviendrons plus loin, sont fondés sur un découpage des produits manufacturés en trois catégories : les biens de consommation traditionnels (par exemple, le textile), les biens de consommation intermédiaires achetés par les entreprises pour produire et, enfin, les biens d’équipement qui sont destinés soit à l’investissement des firmes, soit à l’équipement des ménages (automobile, électroménager). Or la place occupée par les biens d’équipement dans les exportations de produits manufacturés ne cesse de croître, passant de 22,4 % en 1913 à 29,9 % en 1929 et à 33 % en 1937 [24, tabl. 1, p. 6]. Le rôle spécifique que jouent les biens d’équipement dans le processus de production est à l’origine, selon Mistral, du partage des nations entre dominantes (celles qui produisent ces biens et les exportent) et dominées (celles qui sont contraintes de les importer). Nous aurons l’occasion de voir, plus loin, quelles conclusions Mistral peut tirer de cette évolution et du lien entre la composition par produits du commerce international et sa répartition géographique.
De 1945 à 1980
Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, le commerce international devient une variable décisive dans l’expansion des nations. Deux indicateurs permettent de mesurer la vigueur de ce phénomène. Le premier est tout simplement la croissance des exportations mondiales (voir tableau IV). Entre 1955 et 1980, leur montant est multiplié par plus de 21. (En volume, les exportations augmentent à peu près deux fois plus rapidement que le PIB mondial.)
Mais, contrairement à ce qui a lieu à la fin du XIXe siècle, la croissance des exportations ne passe pas par une ouverture identique des nations aux échanges extérieurs. Le tableau V, qui retrace l’évolution du rapport exportations/PIB pour quelques grands pays, montre que le mouvement général d’augmentation de ce rapport ne gomme pas les particularités du Japon et des États-Unis. Ces deux nations sont en effet, contrairement à une idée reçue, beaucoup moins exportatrices,
... ... ...
Les politiques commerciales
Dans les deux premières sections, nous n’avons pas évoqué l’intervention des pouvoirs publics sur les échanges extérieurs. Les développements ultérieurs permettront de revenir sur les justifications et les analyses du protectionnisme ; le point de vue retenu pour l’instant est simplement l’évaluation de son impact sur les tendances décrites cidessus.
L’intervention des États sur les flux de marchandises au moyen de politiques commerciales ne suit pas une pente générale allant vers un abandon des entraves ou, au contraire, vers leur renforcement. Il existe des cycles dans le protectionnisme, en partie liés à ceux qui affectent le niveau de production des nations. Les périodes d’expansion sont globalement associées au libreéchange alors qu’en période de crise les pressions en faveur du protectionnisme sont très fortes. Cependant, une analyse plus fine révèle l’existence de contreexemples, particulièrement à la fin du XIXe siècle, où une phase de croissance économique ne conduit pas à une diminution de la protection.
Le libreéchange se répand, au XIXe siècle, à partir de 1846, date d’abrogation en Angleterre des célèbres Corn Laws, les lois sur le blé qui protègent les agriculteurs depuis la fin du XVIIIe siècle. Toute l’Europe est touchée progressivement, jusqu’à la fin des années 1870. Il est à remarquer que cette période a connu le plus fort taux de croissance du commerce international de tout le XIXe siècle. En revanche, de 1880 à 1913, le protectionnisme marque des points alors qu’existe la dépression commencée en 1880 et qui s’achève en 1895. Le cas de la France, avec les tarifs Méline de 1892 inspirés essentiellement par les agriculteurs, est l’un des plus connus, mais les autres pays sont également touchés : la Russie est la nation la plus protégée dans cette fin du XIXe siècle. En dépit de pressions nationales très fortes, l’Angleterre, seule parmi les grandes puissances, le Danemark et les PaysBas restent totalement à l’écart de cette vague protectionniste, qui ne reflue pas avec le retour de la prospérité.

La Première Guerre mondiale est à l’origine d’un renforcement de la protection des nations qui doivent financer l’effort de guerre, mais le retour à la paix ne s’accompagne pas d’un désarmement douanier. Au contraire, les États-Unis, la France, l’Angleterre et l’Allemagne renforcent, entre 1920 et 1927, leur dispositif protectionniste. En 1927, la Société des Nations organise une conférence mondiale dont l’objectif est la suppression des barrières aux flux internationaux de marchandises qui constituent un frein à la croissance du commerce mondial. Des effets bénéfiques immédiats en découlent mais le déclenchement de la crise mondiale en 1929 remet en cause cet effort de libéralisation. En effet, dès que la récession se manifeste, les principales nations entreprennent une escalade tarifaire amorcée par les États-Unis en juin 1930 avec le tarif HawleySmooth qui prévoit des droits de douane allant jusqu’à 90 % de la valeur des biens importés. La France suit cet exemple et innove en adoptant en 1931 des quotas, c’estàdire des limitations quantitatives des importations. À la fin de 1932, pas moins de onze nations ont recours à ces contingentements, alors que l’Angleterre établit en avril 1932 un tarif général avec des droits de douane allant jusqu’à 33 %. On assiste donc à une contagion des mesures protectionnistes dictées par une volonté de représailles contre les mesures restrictives prises par les partenaires dans les échanges internationaux : la protection est toujours conçue comme une défense ou une rétorsion.
L’aprèsSeconde Guerre mondiale est marqué au contraire par une volonté d’éliminer le plus rapidement possible les entraves aux échanges héritées du conflit. Les enseignements des politiques des années trente ont été tirés par la communauté internationale. Sous l’influence des États-Unis, un accord particulier est élaboré en 1947 : le General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Comme son nom l’indique, il ne s’agit pas d’une organisation internationale, mais simplement d’un traité dont l’objectif est d’assurer le libreéchange ou du moins de supprimer progressivement les barrières au commerce entre les nations signataires de l’accord (24 en 1947, 83 en 1975, 116 en 1993). Des cycles successifs de négociations internationales — les célèbres rounds, souvent liés au nom de l’endroit où se sont ouvertes les négociations, comme le Tokyo Round ouvert en 1973 et l’Uruguay Round ouvert en 1986 organisés par le GATT conduisent à un abaissement général des droits de douane et à la diminution des barrières non tarifaires. Les restrictions quantitatives aux échanges comme la discrimination à l’égard des importateurs sont en principe interdites, sauf exceptions recensées dans l’accord et qui visent toutes des situations exceptionnelles. Toutefois, comme le chapitre suivant le montre, les tendances protectionnistes sont loin d’avoir disparu dans le monde contemporain. Au contraire, les années quatrevingt voient un renouveau sensible des tensions protectionnistes, notamment dans les relations entre les trois pôles du monde développé, les États-Unis, l’Europe et le Japon.
This page intentionally left blank
II / Le commerce international depuis 1980
Depuis 1980, l’économie mondiale connaît des bouleversements dans les flux internationaux de marchandises et de services liés à l’apparition de nouvelles puissances qui modifie la hiérarchie antérieure. Ces modifications peuvent avoir des effets positifs, par exemple sur certains pays d’Asie dont la forte croissance est tirée par les exportations, ou plus négatifs sur d’autres, en Europe ou en Amérique, où des secteurs traditionnels mais aussi modernes sont concurrencés par des importations en hausse. Ces aspects sont appréciés d’abord en raisonnant sur les exportations, puis sur l’équilibre des balances commerciales ; le protectionnisme contemporain est ensuite considéré.
L’évolution des exportations mondiales
L’examen des tendances du commerce mondial depuis 1980 conduit tout d’abord à mettre en évidence la croissance considérable des échanges comparée à celle de la production. Alors que, entre 1980 et 2001, la production mondiale est multipliée par 1,6, le commerce mondial en valeur est multiplié par 3,3 (voir tableau XI). Les économies nationales sont donc de plus en plus ouvertes aux flux commerciaux internationaux. La deuxième caractéristique de cette croissance est qu’elle se fait avec des variations significatives. En effet, alors qu’entre 1973 et 1980 les exportations mondiales ont crû, en moyenne, au rythme de 4 % par an de manière relativement régulière, la période ultérieure est plus chaotique.
Une première période, de 1980 à 1983, est caractérisée par une baisse sensible des exportations ; 1984 marque une nette reprise, suivie d’une année de stagnation. Ce n’est qu’en 1986 que les exportations dépassent le niveau de 1980 ; cette année marque le début d’une troisième phase, de forte croissance, jusqu’en 1992. 1993 marque une légère dépression, suivie, jusqu’en 1997, d’une croissance significative. 1998 est caractérisée par une légère diminution, alors qu’une forte croissance est enregistrée en 1999 et 2000. Enfin, l’année 2001 connaît une diminution significative.
Ces fluctuations peuvent être mieux comprises en décomposant les mouvements des exportations en évolution de prix et de volume. Les volumes exportés sont stables entre 1980 et 1983, à l’exception de la légère diminution de 1982, puis augmentent sans cesse jusqu’en 2000 et décroissent en 2001. La mise en relation des deux évolutions indique que les prix des biens exportés connaissent des tendances différentes sur l’ensemble de la période : de 1980 à 1990, les exportations en valeur croissent plus vite qu’en volume (69 % contre 47 %), alors qu’entre 1990 et 2001 la hiérarchie s’inverse (75 % contre 83 %).
Comment expliquer une telle divergence entre les séries établies en valeur (dollars courants) et en volume (dollars constants) ? Deux phénomènes distincts entrent en jeu.
Le premier est lié aux fluctuations de la valeur internationale du dollar : les données statistiques au niveau mondial sont une agrégation des exportations nationales, valorisées dans les devises des différents pays puis converties en dollars. Lorsqu’une devise s’apprécie par rapport au dollar, les exportations du pays concerné, converties en dollars, augmentent mécaniquement.
Le second phénomène découle des variations dans les valeurs unitaires des biens exportés : les exportations mondiales sont composées de biens dont les prix, que l’on peut approcher par les valeurs unitaires, évoluent de manière très différente. Ainsi, alors que la valeur unitaire des produits manufacturés évolue à peu près comme celle du total des biens, les produits des industries extractives connaissent des fluctuations considérables, comme le montre le graphique 1.
Ces modifications des prix relatifs des biens échangés ont bien évidemment un impact sur les exportations en valeur, qui se combinent avec les changements dans la composition du commerce international par produit (voir tableau XII). Ainsi, en 2001, environ 75 % des exportations mondiales portent sur des produits manufacturés, contre 54 % en 1980 : c’est donc ce type d’échanges que les théories du commerce international doivent prioritairement expliquer.
Cependant, cette composition mondiale n’est qu’une moyenne qui peut cacher de profondes disparités. L’Afrique, en 2001, a des exportations composées pour 14,7 % de produits agricoles, 57 % de produits des industries extractives, et 25,3 % de produits manufacturés. La même année, l’Amérique du Nord réalise des exportations qui se ventilent pour 10,5 % en produits agricoles, 7,5 % de produits des industries extractives, et 77 % de produits manufacturés. Il existe donc des spécialisations internationales marquées, qui peuvent être repérées pour des grands groupes de produits, ainsi qu’au sein de chaque groupe de produits.
Pour apprécier la place occupée par les groupes de nations dans le commerce mondial, il est intéressant d’utiliser les matrices du commerce international élaborées par l’OMC. Il s’agit de tableaux à double entrée qui représentent simultanément l’origine des exportations (en ligne) et leur destination (en colonne). Le tableau XIII présente une élaboration de ces données, exprimées en ‰ des exportations mondiales en 1986, 1991 et 2000.
Le premier enseignement que l’on peut en tirer est relatif à la dynamique différenciée du commerce international selon les grandes zones géographiques sur la période considérée. Pour cela, il faut raisonner par ligne, en considérant la part de chaque zone dans le total des exportations. Le classement des zones qui s’établit en 2000 est identique sur toute la période : l’Europe occidentale arrive en tête (39,1 % des exportations mondiales), suivie par l’Asie (26,3 %), puis l’Amérique du Nord (17,1 %), l’Amérique latine (5,8 %), l’Europe orientale, centrale, et l’exURSS (4,3 %), le MoyenOrient (4 %) et enfin l’Afrique (2,3 %). En revanche, les régions connaissent des taux de croissance de leurs exportations très variables ; les deux cas polaires sont ceux de l’Amérique du Nord et de l’Afrique : la part de l’Amérique du Nord augmente régulièrement, passant de 14,9 % à 15,7 % pour finir à 17,1 %, alors que l’Afrique est de plus en plus marginalisée : sa part diminue de 2,6 % à 2,4 % puis à 2,3 %. Cette situation de l’Afrique s’explique en particulier par les évolutions défavorables des prix des matières premières et des produits agricoles qu’elle exporte à titre essentiel. L’évolution des performances à l’exportation de l’Europe orientale est très heurtée : l’effondrement des économies a fait passer leur part des exportations mondiales de 7,5 % à 2,6 %, entre 1986 et 1991, mais ce taux est remonté à 4,3 % en 2000, notamment grâce aux implantations de firmes étrangères.
Le deuxième enseignement est relatif à la concentration du commerce international au sein des nations les plus développées : l’Amérique du Nord et l’Europe occidentale sont à l’origine de 58,6 % des exportations mondiales en 1986 et de 56,2 % en 2000, alors que, parallèlement, le total Amérique latine, Afrique, MoyenOrient passe de 10,3 % à 11,1 %.
Le troisième enseignement concerne la destination des exportations réalisées par chaque zone. Il existe une tendance, plus ou moins marquée selon les cas, au développement des échanges entre les nations d’une zone donnée. C’est ainsi que 68 % des exportations de l’Europe occidentale sont intraeuropéennes en 2000. Enfin, l’accroissement de la place occupée par l’Asie dans le commerce mondial s’effectue avec un renforcement de l’intégration régionale : la part des exportations intrazone dans le total est passée de 25,7 % en 1986 à 49,4 % en 2000.
Par ailleurs, la matrice des exportations mondiales permet de repérer les relations privilégiées entre zones. L’Amérique du Nord exporte davantage vers l’Asie que vers l’Europe occidentale ; l’Amérique latine a comme client préférentiel l’Amérique du Nord ; l’Europe occidentale se tourne plus vers l’Amérique du Nord que vers l’Asie.
Le quatrième enseignement est relatif à l’équilibre entre les flux commerciaux reçus et ceux émis par une zone donnée. Il peut être tiré de la comparaison des totaux enregistrés en ligne et de ceux figurant en colonne, pour une zone géographique. Ainsi, en 2000, l’Amérique du Nord est à l’origine de 17,1 % des exportations mondiales et elle en reçoit 22,7 %. Ce souscontinent est déficitaire sur toute la période, alors que l’Asie est toujours excédentaire. Les autres zones connaissent des variations autour de l’équilibre, selon les années en excédent ou en déficit. Toutefois, cette approche est trop approximative : il est nécessaire de passer à un examen par pays de cette question.
Les politiques commerciales
Le commerce international se réalise dans un monde où l’intervention des pouvoirs publics sur les échanges prend de nombreuses formes (voir chap. IV). Le protectionnisme peut avoir un impact certain dans des secteurs que les pouvoirs publics considèrent comme importants, pour une raison ou une autre ; le cas de trois secteurs permet d’illustrer les conséquences de l’intervention publique.
L’automobile et les relations entre les États-Unis et le Japon
Le secteur automobile est dans une situation générale tout à fait différente de l’acier : la récession n’est que passagère entre 1980 et 1986 et les firmes américaines réussissent, au prix d’une politique assez dure, notamment en matière salariale, à redresser leur position. De plus, c’est un secteur employant une main d’œuvre nombreuse et fortement syndiquée. Le syndicat des travailleurs américains de l’automobile exerce une pression se traduisant par un lobbying intensif auprès des hommes politiques en faveur du protectionnisme ; la cible est ici les producteurs japonais.
Contrairement à l’acier, aucune base légale ne peut être trouvée pour établir que les difficultés du secteur sont dues au caractère déloyal de la concurrence étrangère. Or c’est là un point particulièrement important pour les pays signataires du GATT et défenseurs du libreéchange, ce qui est théoriquement le fondement de la position américaine dans toutes les arènes internationales. C’est donc encore sur une base « volontaire » que les firmes japonaises acceptent, depuis 1981, de réduire leurs exportations vers les États-Unis. La menace implicite qui les a poussées à souscrire à ce programme est celle d’une imposition de quotas très restrictifs par le Congrès américain, toujours sensible aux pressions protectionnistes. Il est possible de calculer l’équivalent de cette mesure : on l’assimile à un droit de douane sur le prix des automobiles d’environ 11 % alors que les droits de douane moyens aux États-Unis sont de 5 % [voir 20, p. 8 et 10]. Il faut préciser que les firmes japonaises ont intérêt à accepter de réduire leurs
Du GATT à l’OMC
C’est en septembre 1986 que s’est ouvert à Punta Del Este (Uruguay) un cycle de négociations du GATT prévu pour s’achever en 1990, mais qui n’a trouvé sa conclusion qu’en décembre 1993 (voir [44]). Il s’agit de négociations commerciales multilatérales (NCM) consacrées à un ensemble de questions diverses dont émergent deux thèmes majeurs, source d’affrontements nombreux : la libéralisation du commerce des produits agricoles et l’extension du champ d’application du GATT au commerce international de services.
Les NCM se déroulent sur une toile de fond peu favorable à la libéralisation des échanges, comme en témoignent les affrontements entre les États-Unis, le Japon et l’Europe (voir chap. II, supra), mais aussi l’opposition récurrente entre PVD et pays développés (dans le domaine des services) et encore, pour les produits agricoles, entre les États-Unis, l’Europe et un groupe de nations exportatrices (principalement le Canada, l’Australie et la NouvelleZélande). Cette confrontation entre nations ayant des intérêts opposés est habituelle, même si elle est exacerbée par le contexte actuel. Mais les difficultés qu’elle entraîne sont accrues par la nouveauté de certaines des questions traitées : comment définir les barrières aux échanges de services, comment réglementer les subventions à l’agriculture ? La complexité est beaucoup plus grande que dans les NCM antérieures où il s’agissait pour l’essentiel de réduire les barrières tarifaires et non tarifaires. C’est ainsi que, si l’abaissement des droits de douane sur les marchandises a pu être obtenu sans trop de problèmes (les droits moyens s’établissent, après l’Uruguay Round, à un niveau d’environ 3 % contre 4,7 % à l’issue du Tokyo Round), les autres dossiers ont connu de nombreuses vicissitudes.
Les NCM se sont déroulées autour de quinze dossiers différents ; deux ont connu des négociations particulièrement ardues qui n’ont abouti qu’à la veille de la date ultime retenue (le 15 décembre 1993): il s’agit des produits agricoles et des services. Pour les produits agricoles, l’affrontement central a opposé les États-Unis et l’Europe. Les productions agricoles européennes sont protégées par un système complexe, la PAC (Politique agricole commune) dont les effets sur le commerce international peuvent être ramenés à des subventions à la production et à l’exportation. Lors des NCM, les États-Unis ont cherché à obtenir l’élimination totale de ces subventions dans un délai de dix ans (alors même que depuis 1982 une augmentation sensible des aides versées aux fermiers américains a été constatée). Pour leur part, les représentants de la CEE étaient prêts à modifier la PAC, mais non à la supprimer. La réforme de la PAC, réalisée en mai 1992, met en place un système d’aides au revenu liées à des diminutions de la production. C’est cette réforme qui a permis aux négociateurs européens et américains d’arriver, en novembre 1992 à un préaccord qui, en substance, conduit à diminuer les exportations subventionnées des deux côtés et qui a servi de base à l’accord final.
Le dossier des services a connu deux types d’affrontements. Le premier a opposé les PVD, conduits par l’Inde et le Brésil, à l’ensemble des pays développés et principalement aux États-Unis et à la CEE. La crainte des PVD est que la libéralisation des échanges de services commerciaux ne se traduise, pour eux, par la disparition de leurs activités nationales dans un secteur où ils ne disposent d’aucun avantage comparatif (c’est le cas notamment pour les services financiers, les télécommunications, les grands travaux). L’accord final prévoit une libéralisation progressive des échanges avec des dispositions particulières qui doivent permettre de renforcer les capacités nationales des PVD à fournir des services et de faciliter leur accès aux circuits de distribution. Le second affrontement, très vif pendant l’année 1993, a opposé la CEE et les États-Unis dans le domaine particulier de l’audiovisuel, la CEE et surtout la France, réclamant une « exception culturelle » ayant pour but d’assurer la pérennité d’une production nationale dans ce secteur. Les
États-Unis, jugeant très insuffisantes les propositions européennes, ont préféré, au dernier moment, que l’audiovisuel soit totalement exclu du champ de l’accord général sur les services.
Depuis le 1er janvier 1995, l’OMC remplace le GATT. Son activité a permis de régler des dossiers en suspens, notamment pour la libéralisation des échanges de services. Mais l’état actuel de l’abaissement des barrières aux échanges internationaux est jugé insuffisant, notamment par les États-Unis et l’Union européenne. Après des difficultés considérables (échec de la conférence de Seattle de novembre 1999), il a été décidé, lors de la Conférence de Doha, en novembre 2001, de lancer un nouveau cycle de négociations. Ces négociations s’ouvrent avec des réticences très fortes des pays en développement, qui considèrent que leurs politiques de libéralisation des échanges n’ont pas eu d’impact positif sur leurs économies (voir [44]). Leur aboutissement est prévu pour le 1er janvier 2005.
…
L’aéronautique et la rivalité Europe/États-Unis
L’aéronautique offre une nouvelle configuration de relations conflictuelles entre l’Europe et les États-Unis qui, après plu¬sieurs escarmouches, aboutit en 1987 à un conflit ouvert. L’objet du litige est le lancement par le consortium européen Airbus Industrie des avions A 330 et A 340 qui concurrencent directement les productions de deux firmes américaines, Boeing et McDonnell Douglas. L’attaque nord-américaine est à peu près du même ordre que pour l’acier : Airbus n’aurait pu se développer que grâce à des subventions des gouvernements européens qui faussent le jeu de la concurrence. L’argument est contré par les dirigeants du consortium qui mettent en avant les subventions que perçoivent les deux firmes américaines par le biais des programmes militaires. La situation analysée est celle où des menaces protectionnistes sont brandies pour influencer un gouvernement ou un producteur étranger. Le but visé est soit l’abandon complet de la production, soit la diminution des sub¬ventions versées par les pouvoirs publics.
Les tensions protectionnistes se manifestent également entre l’Europe et le Japon selon une logique quelque peu diffé¬rente. L’accusation essentielle, maintes fois répétée au cours des années quatre-vingt, concerne la fermeture du marché japonais aux produits étrangers à l’aide de procédures multiples relevant pour la plupart de réglementations tatillonnes des¬tinées à protéger le consommateur et appliquées très stric¬tement à l’encontre des importations. La stratégie européenne consiste, en réponse, à mettre en place (ou à menacer de le faire) des limitations aux importations japonaises dans certains secteurs afin d’obtenir des ouvertures significatives du marché japonais aux produits européens. En dépit des engagements répétés des gouvernements japonais, on peut difficilement considérer, au vu des chiffres relatifs aux excédents commer¬ciaux japonais, que cette méthode a produit des résultats satisfaisants.
