Les génériques avec Delphi 2009
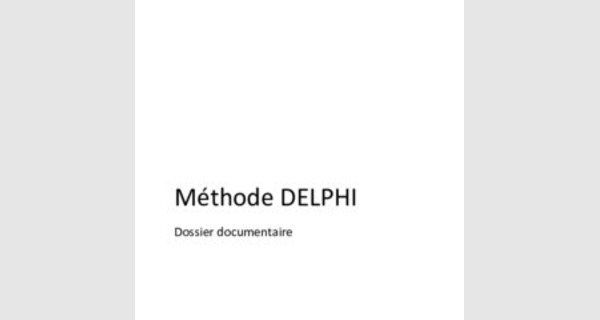
Méthode DELPHI
Dossier documentaire
ORSAS – Lorraine 19 février 2009
SOMMAIRE
Présentation de la méthode Delphi 1
Outils de l’enquête Delphi 2005 pour le PRSP de Lorraine 7
Exemple :
« Les priorités de prévention en santé mentale à Genève :
Une enquête par méthode Delphi » 23
Guide pour l’utilisateur de la méthode Delphi
publié par la Fondation Roi Baudouin 35
Présentation de la méthode Delphi
(Document de synthèse établi à partir de différentes sources)
1. Définition et objectifs
La méthode DELPHI est une méthode visant à organiser la consultation d’experts sur un sujet précis, souvent avec un caractère prospectif important.
Le terme « expert » ne doit pas faire croire que cette méthode est réservée à la consultation d’autorités scientifiques de haut rang. Il faut entendre par « expert » toute personne ayant une bonne connaissance pratique, politique, légale ou administrative d’un sujet précis et ayant une légitimité suffisante pour exprimer un avis représentatif du groupe d’acteurs auquel elle appartient. Dresser la carte des acteurs peut aider à identifier ces experts.
Très utile dans la phase d’analyse et d’étude d’opportunité d’un projet (par exemple, d’un projet de réalisation d’un site web ou d’un logiciel), la méthode DELPHI permet d’affiner le projet de départ via un questionnement sur son opportunité, sur sa faisabilité et sur les différentes contraintes auxquelles le projet sera confronté.
La méthode DELPHI a pour but de rassembler des avis d’experts sur un sujet précis et de mettre en évidence des convergences et des consensus sur les orientations à donner au projet en soumettant ces experts à des vagues successives de questionnements, qui génèrent des avis qui permettent de consolider les orientations à donner à un projet. Cette méthode trouve toute son utilité là où de nombreuses incertitudes pèsent sur la définition précise d’un projet et où de nombreuses questions se posent quant à son opportunité et sa faisabilité. Elle apporte un éclairage des experts sur ces zones d’incertitude en vue d’une aide à la décision et d’une vérification de l’opportunité et de la faisabilité du projet.
2. Contexte d’utilisation de la méthode
La méthode DELPHI aide à lever les incertitudes rencontrées dans le cadre d’un développement d’un projet. En principe, elle peut donc être utilisée à chaque phase du développement, mais elle trouve sans doute son utilité la plus directe lors du démarrage d’un projet, durant la phase d’analyse, là où les incertitudes sont nombreuses. Elle peut en effet contribuer à lever ces incertitudes et à prendre des décisions grâce aux avis autorisés sur le projet, son opportunité, sa faisabilité et les orientations à lui donner.
Dans certains cas, des variantes de la technique peuvent également être appliquées lors des phases ultérieures du développement du projet : lors de la conception de l’application, la méthode DELPHI permet d’organiser les consultations nécessaires pour rassembler des avis et générer des consensus sur les orientations prises par le projet ; lors de l’évaluation de l’application, la méthode DELPHI permet de lever certaines incertitudes révélées par les tests d’utilisabilité en questionnant les « testeurs » sur leurs divergences et en essayant, à travers des questionnements successifs d’arriver à un consensus.
3. Les acteurs
Deux types d’acteurs interviennent dans cette méthode : les analystes et les experts.
Les analystes sont chargés d’organiser le dispositif DELPHI, c’est à dire : de sélectionner les « experts » ; de rédiger les versions successives des questionnaires ; d’analyser et d’exploiter les résultats.
Les experts sont les personnes qui seront consultées durant le processus DELPHI. Le choix de ces experts doit tenir compte de leur :
- connaissance du problème visé ;
- légitimité par rapport au groupe d’acteurs qu’ils pourraient représenter ;
- disponibilité durant le processus DELPHI ;
- indépendance par rapport à des pressions commerciales, politiques ou autres.
Le nombre d’experts n’est pas figé. Il dépend en fait de l’étendue de la carte des acteurs du projet. Plutôt que la quantité, il importe ici de veiller à la représentativité et la légitimité.
4. Mise en œuvre de la méthode
La méthode DELPHI est en apparence relativement simple à mettre en œuvre. Toutefois, elle requiert de la part des analystes des compétences éprouvées en matière de rédaction et de traitement de questionnaires. Elle demande également une excellente connaissance du problème ou du projet visé par le DELPHI, tant pour la rédaction des questionnaires successifs que pour l’interprétation et la consolidation des résultats. L’idéal est de disposer d’une équipe interne disposant de ces deux compétences ou d’externaliser la compétence méthodologique tout en gardant en interne la compétence sur le fond.
La méthode DELPHI demande des ressources de rédaction, de traitement et d’analyse de questionnaires. Ces ressources peuvent être humaines mais supposent l’aide de moyens informatiques quand le nombre d’experts s’élargit et que le traitement manuel n’est plus possible. Différents logiciels peuvent aider à ce traitement : logiciels d’analyse textuelle qualitative, logiciels davantage orientés vers la statistique descriptive (comme Excel) ou vers la statistique analytique (comme SAS ou SPSS). Il importe, à ce niveau, de choisir des outils logiciels parfaitement maîtrisés par les analystes.
Par ailleurs, le questionnement des experts se fait sur base de questionnaires écrits à questions ouvertes et fermées.
Les questionnaires sont envoyés individuellement aux experts et non pas administrés en groupe afin d’éviter les phénomènes d’influence liés au groupe.
5. Les étapes de la méthode Delphi
Il existe de nombreuses variantes à la méthode DELPHI. Voici une variante classique, à 4 étapes.
• L’étape 1 consiste à définir avec rigueur et précision l’objet sur lequel portera le DELPHI. Par objet, on entend le problème que vont devoir examiner les experts et les grands questionnements liés à ce problème. Il importe de passer du temps à cette définition de l’objet sans quoi on risque d’entraîner les experts dans un processus DELPHI dont le thème évolue au fur et à mesure. La définition de l’objet est importante tant pour la rédaction des questionnaires que pour le choix des experts.
• L’étape 2 consiste à procéder au choix des experts, par exemple sur base d’une carte des acteurs établie pour la circonstance. Pour éviter la mise en question future du processus DELPHI, il importe de veiller à :
- la bonne représentativité des experts choisis par rapport à l’objet visé ;
- leur indépendance ;
- leur excellente connaissance de l’objet sur lequel porte le DELPHI.
Il est recommandé que le nombre final d’experts ne soit pas inférieur à 25. Cela veut dire qu’il faut en prévoir un nombre plus importants au départ pour tenir compte des refus et des abandons.
Chaque fois que l’ORSAS a mené une enquête Delphi, les experts sélectionnés ont d’abord été contactés par téléphone pour leur expliquer l’objet de l’enquête, leur indiquer ce que l’on attendait d’eux, leur préciser la charge de travail que représentera leur contribution et pour solliciter leur participation.
• L’étape 3 consiste à élaborer un questionnaire selon un processus rigoureux. Les questions doivent être ciblées, précises et éventuellement quantifiables. Très souvent le questionnaire de départ repose largement sur des questions faites d’items ou d’échelles à choisir par les experts.
• L’étape 4 est celle de l’administration du questionnaire et du traitement des résultats. Le questionnaire de départ est administré par courrier (physique ou électronique) aux experts. Le même questionnaire servira de fil conducteur à tout l’exercice DELPHI, il sera juste enrichi, à chaque tour, des résultats et commentaires générés par le tour précédent.
Au deuxième tour de questionnaire, les experts reçoivent les résultats du premier tour et doivent à nouveau se prononcer sur le questionnaire, en ayant maintenant l’opinion du groupe consulté. Si leur nouvelle réponse dévie fortement de la moyenne du groupe, ils doivent la justifier. Au troisième tour, on informera les experts des résultats du deuxième tour ainsi que des commentaires justifiant les opinions déviantes. Les experts seront à nouveau invités à répondre au questionnaire mais aussi à commenter les opinions déviantes. Le quatrième et dernier tour livrera aux experts toute l’information récoltée au cours des tours précédents et leur demandera de répondre une nouvelle fois au questionnaire. Ce quatrième tour donnera les réponses définitives : les opinions consensuelles médianes et la dispersion des opinions autour de cette médiane, cette dispersion pouvant être interprétée à l’aide des justifications et commentaires recueillis auprès des experts.
A l’issue du DELPHI, les analystes rédigent un rapport synthétique reprenant : les opinions consensuelles médianes qui se sont dégagées au sein du groupe d’experts et la dispersion des opinions autour de cette médiane ; les justifications et commentaires des experts à propos des opinions qui divergent du consensus pour interpréter la dispersion des opinions ; la composition du groupe d’experts ; éventuellement, le questionnaire soumis aux experts.
6. Atouts et limites
ATOUTS
La méthode permet de générer des consensus raisonnés qui pourront servir à légitimer certaines décisions futures à prendre sur un projet. Elle permet de collecter une information riche, notamment au niveau des déviances, qui sont parfois plus intéressantes que la norme. Elle peut être appliquée dans des domaines très variés (gestion, économie, technique, sciences sociales, sciences humaines, etc.). Elle ouvre parfois sur des perspectives ou des hypothèses non envisagées par les analystes.
Mais attention : convergence ne signifie pas cohérence.
LIMITES
La méthode est relativement lourde et fastidieuse tant pour les analystes que pour les experts (4 tours de questionnaire). Elle apparaît, à certains égards, davantage intuitive que rationnelle. Seuls les experts qui sortent de la norme sont amenés à justifier leur position. On peut aussi considérer que l'opinion des déviants est, en termes prospectifs, plus intéressante que celle de ceux qui rentrent dans le rang.
Elle suppose une excellente capacité des analystes au niveau des traitements des réponses et de la conduite maîtrisée de tout l’exercice.
Ces différents inconvénients amènent beaucoup de praticiens à travailler avec des DELPHI allégés ou adaptés en fonction du temps et des ressources dont disposent à la fois les experts et les analystes (utilisation du courrier électronique ou du web), etc.
QUAND OPTER POUR CETTE MÉTHODE?
La méthode DELPHI est très efficace pour lever des incertitudes et prendre des décisions quant au développement et à l’opportunité d’un projet.
Elle s’applique idéalement lors de l’analyse du projet, mais dans certains cas, elle peut également être appliquée lors des phases ultérieures.
La méthode DELPHI requiert des connaissances en rédaction, en traitement et en analyse des questionnaires, et peut apparaître assez lourde et fastidieuse à gérer, tant pour les analystes que pour les experts (contrainte lourde).
7. Exemples d’application de cette méthode
Au Canada, une vaste consultation selon la méthode DELPHI s’est déroulée à l’été et à l’automne 2001 sur la préparation des jeunes canadiens au marché du travail. Plus de 70 experts issus des secteurs des affaires, de l’enseignement, des administrations publiques et des organisations non gouvernementales ont été consultés. La Direction générale de la recherche appliquée du Développement des Ressources Humaines Canada propose un rapport détaillé de cette consultation DELPHI.
Une étude par méthode Delphi a été menée pour identifier les priorités de prévention dans le domaine de la santé mentale, à Genève. Deux étapes d’allers et retours de lettres ont eu lieu entre les organisateurs de l’étude et 58 informateurs-clés concernés à travers leur association ou leur situation professionnelle par la santé mentale.
Le premier tour de l’enquête a permis de faire une liste de problèmes de santé mentale. Il s’agit surtout de problèmes de santé (65 %) et de services (11 %) ; moins fréquemment de problèmes de ressources (< 1%). Un consensus a été trouvé au 2etour et 3 problèmes sont à privilégier dans une perspective d’intervention préventive : la dépression, l’abus d’alcool, la maltraitance et les abus sexuels.
La méthode Delphi, qualitative, qui reflète la perception subjective et consensuelle d’un groupe d’experts, a donc permis d’identifier les problèmes de santé mentale prioritaires pour la prévention à Genève, en 1995.
8. BIBLIOGRAPHIE SUCCINTE
BUIGUES P.A., Prospective et compétitivé, Mac Graw Hill 1985.
GODET M., De l'anticipation à l'action" Dunod, 1991.
HELMER O., Looking forwurd : a guide to futures rescarch, Sage publications, 1983. (Olaf Helmer est l'un des pères de la méthode Delphi)
LINSTONE H. A., TURROF, M., The Delphi method, techniques and applications, Addison wesley publishing, 1975.
MARTINO J.P., Technological forecastingfor decision mafing, Mac Graw Hill, 1993. (ouvrage vendu avec une disquette de programmes permettant notamment de traiter une enquête Delphi)
SAINT-PAUL R., TÉNIÈRE-BUCHOT P.F., Innovation et évaluation technologiques, Entreprise moderne d'édition, 1974.
ORSAS - Lorraine Dossier documentaire sur la méthode Delphi 6
Outilsdel’enquêteDelphi(2005)
pourlapréparationduPRSPenLorraine
Première lettre adressée aux experts après un entretien téléphonique préalable
Madame, Monsieur,
A la suite de notre premier contact téléphonique, je vous adresse les détails du projet d’enquête que nous menons pour la DRASS de Lorraine sur « les priorités de santé en Lorraine » et à laquelle vous avez accepté de participer. Je vous remercie pour l’attention que vous voudrez bien y apporter et pour le temps que vous y consacrerez.
Pour la préparation du Plan Régional de Santé Publique (PRSP), la DRASS et les DDASS ont souhaité enrichir le diagnostic partagé qu’elles ont engagé par le point de vue d’acteurs de terrain. Ce diagnostic régional partagé vise à fournir une base de réflexions et d’orientations commune aux partenaires locaux pour élaborer les actions prioritaires du plan régional de santé publique.
La méthode employée pour réaliser la remontée d’informations qualitatives de terrain est la méthode Delphi qui a été validée depuis plusieurs années, notamment dans le champ de la santé publique.
La procédure est simple. Nous cherchons à recueillir l’opinion d’une trentaine de personnes par département lorrain. Ces personnes ont été sélectionnées en lien avec les DDASS pour l’étendue et la qualité de leur expérience dans le domaine de la santé des populations.
Vous aurez à répondre individuellement à trois questionnaires successifs au maximum qui vous seront transmis par courrier postal ou par courrier électronique si vous le souhaitez.
Nous vous demandons, dès maintenant, de répondre au premier questionnaire (une question) ci-joint. Les deuxième et troisième questionnaires seront construits à partir des réponses obtenues au questionnaire précédent.
Pour chaque questionnaire, nous vous demanderons de respecter un délai maximal de 10 jours de façon à ce que l’ensemble du processus puisse se dérouler en trois mois. Je précise que la méthode Delphi nécessite votre participation à l’ensemble des étapes.
Il est bien entendu que l’ORSAS respectera l’anonymat de vos réponses. Seuls les résultats collectifs par département et pour la Lorraine seront communiqués à la DRASS qui les rendra publics. Le rapport final présentant l’ensemble des résultats vous sera communiqué.
En vous remerciant pour votre contribution, je vous prie d’agréer l’expression de mes salutations distinguées.
Yvon Schléret
Directeur de l’ORSAS-Lorraine
ORSAS-Lorraine Observatoire Régional de la Santé et des Affaires Sociales en Lorraine
2, rue du doyen Parisot 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy Tél. 03 83 67 68 69
Enquête Delphi – Plan Régional de Santé Publique de Lorraine
Date d’envoi : 14 mars 2005
Première question
Compte tenu des objectifs généraux de la politique de santé publique en France:
- diminuer la mortalité prématurée évitable
- diminuer la morbidité
- améliorer la qualité de vie des personnes malades et lutter contre les incapacités
- réduire les inégalités de santé en réduisant les inégalités d’accès à la prévention,
Veuillez faire une liste de 10 problèmes (au maximum) que vous jugez importants à prendre en compte dans le domaine de la santé pour votre département afin d'atteindre ces objectifs.
Classez ces 10 problèmes prioritaires par ordre d’importance décroissante du 1er au 10ème (le 1er étant celui qui vous semble le problème majeur).
Vous pouvez justifier ce choix et ce classement que vous proposez en quelques mots.
N.B. : C’est en fonction de votre compétence personnelle que les responsables de cette enquête font appel à vous. Vos réponses doivent donc refléter votre expérience personnelle et non forcément l’opinion de l’organisme pour lequel vous travaillez.
Merci de nous adresser vos réponses sur papier libre en indiquant votre nom et le numéro de votre département avant le jeudi 24 mars 2005,
- soit par courrier postal à
ORSAS-Lorraine, 2 rue du Doyen Parisot,
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy,
- soit par courrier électronique à
Seconde lettre adressée aux experts
Madame, Monsieur,
Je voudrais, tout d’abord, vous remercier d’avoir pris de votre temps pour nous faire profiter de votre expérience. Votre collaboration à la préparation du PRSP de Lorraine est précieuse.
Nous entamons maintenant la seconde étape de l’identification de priorités dans le domaine de la santé pour les départements lorrains et la région. Comme vous le savez, cette démarche a pour objectif de fournir aux DDASS, à la DRASS et à leurs partenaires des informations destinées à les aider dans leur prise de décision pour la fixation de priorités dans le Plan Régional de Santé Publique. L’enquête mobilise 109 personnes réparties sur les 4 départements lorrains.
L’analyse des réponses au premier questionnaire a permis de recueillir 809 propositions qui ont fait l’objet d’une analyse de contenu qui a abouti à la formulation d’une trentaine de catégories différentes de besoins repérés par les personnes ayant répondu.
L’analyse de contenu a consisté à réunir sous un même énoncé les propositions de même nature. Chaque catégorie proposée obtient une note en fonction du rang auquel la proposition concernée a été cité. Les besoins cités avec le rang 1 ont été notés avec 10 points, celle de rang 2 avec 9 points, etc. Ce qui a permis d’établir un score provisoire pour chaque catégorie de besoins. On obtient ainsi une toute première ébauche de classification.
Le tableau 1 présente les différentes catégories de besoins identifiés par cette enquête. Elles sont indiquées par ordre d’importance décroissant, en fonction de leur score (en premier la catégorie qui a obtenu le score le plus élevé).
Pour cette seconde étape de l’enquête, nous vous demandons de lire attentivement cette liste et de sélectionner, sur le tableau récapitulatif, 10 priorités en les classant (1 pour la plus importante des dix, 10 pour la moins importante des dix, etc.).
Le document 2 détaille les catégories que nous avons établies à partir de l’analyse de contenu. C’est-àdire que sous l’intitulé de chaque catégorie, nous avons indiqué les propositions les plus fréquentes que nous y avons regroupées. La lecture de ce document permet de mieux comprendre le tableau 1 qui est dans une formulation plus synthétique.
Enfin, le questionnaire ci-joint reformule la question à laquelle vous êtes invité(e)s à répondre cette fois-ci. La réponse est attendue pour le 25 avril 2005 au plus tard.
Vous pouvez exprimer un avis divergent sur les regroupements qui ont été opérés. Dans ce cas, je vous remercie de bien vouloir le signaler. A l’inverse, vous pouvez également proposer d’autres regroupements à partir du tableau 1. Par exemple, si vous classez le numéro x en plus important et vous estimez que le n° y est de même nature, vous classez x et y avec le même niveau de priorité ou avec le même rang.
L’ORSAS est à votre disposition pour répondre à toutes les questions que cette seconde étape de l’enquête pourrait susciter auprès de vous.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Yvon Schléret
Directeur de l’ORSAS-Lorraine
ORSAS-Lorraine Observatoire Régional de la Santé et des Affaires Sociales en Lorraine
2, rue du doyen Parisot 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy Tél. 03 83 67 68 69
Enquête Delphi sur les priorités de santé en Lorraine Avril 2005
Maîtrise d’ouvrage : DRASS et DDASS de Lorraine
Maîtrise d’œuvre : ORSAS-Lorraine
Document 1
Présentation détaillée et classement provisoire des intitulés des priorités dégagées à partir des résultats du premier questionnaire
Ce document indique les résultats de l’analyse de contenu des propositions de priorités recueillies auprès des participants de l’enquête Delphi. Chaque intitulé (en gras) est la synthèse reformulée de différentes propositions de même nature et c’est sous cette forme que la catégorie de proposition est reprise dans le questionnaire n° 2.
Pour illustrer et préciser le sens de chacun de ces intitulés, on les a illustrés par des retranscriptions « mot à mot » de propositions qui ont été classées dans la catégorie correspondante. Une telle recopie de formulations a pour objectif de ne pas trahir les réponses reçues.
Toutes les formulations n’ont pas été systématiquement reproduites dans ce document. Lorsque deux ou trois énoncés provenant de sources différentes étaient fortement redondants, on n’en a conservé qu’un seul pour alimenter l’explication. Par contre tous les énoncés ont été pris en compte pour la hiérarchisation des propositions.
La hiérarchisation des propositions a été menée de la manière suivante : Chaque énoncé a obtenu une note en fonction du rang auquel il a été cité (10 points pour l’énoncé classé en première priorité, 9 points pour celui indiqué en seconde priorité, et ainsi de suite jusqu’à la 10ème priorité qui a obtenu 1 point). Le classement proposé ci-contre correspond à l’ordre décroissant des priorités en fonction du nombre de points obtenus. Il s’agit d’un classement provisoire établi à l’échelon régional. La synthèse finale présentera les résultats par département.
Ce classement est présenté comme provisoire car les résultats de la seconde question peuvent encore le modifier.
_________________________________________________________________________________
1 - Réduire la consommation de produits licites (tabac, alcool) ou illicites (drogues) pouvant entraîner une dépendance
« Les dépendances aux produits (tabac, drogues, médicaments, alcool). »
« Lutte contre des conduites addictives (Alcoolisme, Tabagisme, toxicomanie) et pratiques de substitution/sevrage. »
« Prévention et lutte contre les dépendances aux produits licites (notamment médicaments, tabac, alcool) et illicites. »
« Dépendance et consommation de drogues, alcool, tabac pour l’ensemble de la population mais essentiellement chez enfants et adolescents y compris à titre passif ou en raison de l’incidence d’une telle consommation parentale. »
« Consommation de produits stupéfiants, y compris l'alcool et le tabac : la discussion autour de ces sujets dépend beaucoup du produit abordé. Les jeunes peuvent ressentir une gêne de parler de produits comme le cannabis considérant qu'un aveu leur occulterait des chances de se voir proposer des stages de formation professionnelle. »
« La consommation massive d'alcool des jeunes. »
« Le tabagisme »
« L'alcoolisme »
« L'usage du cannabis »
_________________________________________________________________________________
2 - Développer, adapter l’organisation des soins et renforcer les pratiques de coopération
« Développer le maintien à domicile et l’hospitalisation à domicile. »
« Améliorer l’accueil des Urgences dans les hôpitaux. »
« Décloisonner le sanitaire, le médico-social et le social en favorisant la création de réseaux. »
« Favoriser la prise en charge ambulatoire des malades. »
« Insuffisance des moyens pour l'hospitalisation à domicile. »
« Le manque de structures d'accueil et de soins pour la population adolescente. » « Une démarche globale de prise en compte des problèmes des personnes à aider, besoin de coordination des informations médico-sociales obligatoire pour les professionnels, évaluée régulièrement (la continuité des soins par une relation des professionnels"ville-hôpital" de qualité, un retour d'information de la part de tous les acteurs). »
« Un besoin de formation continue des professionnels libéraux (au regard d'une population ciblée), besoin de faire entrer les médecins libéraux en milieu hospitalier pour une meilleure connaissance des besoins et limites des deux secteurs Un besoin impératif de construire une véritable culture gériatrique en milieu hospitalier. »
« Des professionnels (administratifs et paramédicaux) à l'écoute des acteurs de terrain. »
« Revaloriser certaines spécialités comme la pédiatrie, la gynécologie, … »
« Améliorer la coordination entre les professions médicales et paramédicales dans le suivi des patients. »
« Développer le rôle des CCAS pour rapprocher et créer des liens auprès des personnes malades. »
_________________________________________________________________________________
3 - Mieux identifier, prévenir et soigner la souffrance psychique et les problèmes de santé mentale
« Mal-être. Maladies psychologiques. Fragilité psychologique. »
« Le mal être, la dépression (dépistage, information et orientation vers les structures adaptées à la prise en charge). »
« Isolement, mal-être, solitude. (liés à la précarité ou à la maladie, conséquences sur estime de soi, projet de vie, préoccupation santé, etc.). »
« Meilleures formations des personnels soignants pour une prise en compte globale du mal-être de ces publics. »
« Santé mentale : Coordination des soins somatiques et psychiques, groupes de paroles pour proposer des activités de soins complémentaires au face à face thérapeutique, actions pour lutter contre le stress. »
« Prise en charge pluridisciplinaire (sociale, médicale) des personnes en situation de fragilité sociale et présentant des troubles psychiatriques (dépression, troubles du comportement). »
« Un grand nombre de problèmes de santé relevant de la psycho-psychatrie (de la souffrance psychologique à la pathologie sévère) sont à prendre en compte davantage (repérage et accompagnement vers des soins). »
« Dépression (ne cesse d'augmenter: hommes, femmes et jeunes). »
« Prise en charge psychothérapique plus centrée sur le ressenti émotionnel des patients exprimant un mal vivre et non intellectuel. »
« Le mal-être des jeunes : la souffrance psychologique et ses conséquences n'est pas toujours décelables immédiatement lors des entretiens. Souvent seule une relation de confiance établie entre le conseiller et le jeune permet de pouvoir aborder ces sujets de manière sereine. La problématique du mal être est importante, seule la fréquence peut apparaître peu importante. »
« Prévention des suicides. »
« Les tentatives de suicide (notamment chez les jeunes). »
« Le suicide chez les jeunes et les travailleurs du bassin minier de notre secteur mis en préretraite dès l'age de 45 ans. »
_________________________________________________________________________________
4 - Favoriser une saine alimentation et la pratique de l’activité physique
« Obésité : due à un manque d’organisation et de cuisine facile avec des plats préparés, et des féculents. »
« Nutrition et obésité tant sur un plan financier mais aussi culturel et éducatif. »
« Alimentation : surpoids et obésité en augmentation de même que maladies cardio vasculaires et cancers digestifs. »
« Déséquilibre alimentaire. »
« Campagnes pour l’exercice physique et les mesures hygiéno-diététiques. »
« Lutter contre la sédentarité. »
« Manque de pratique sportive régulière. »
_________________________________________________________________________________
5 - Soutenir et accompagner les groupes les plus fragilisées par la pauvreté et la précarité
« Précarité des conditions de vie. »
« Précarité (financière, logement, emploi) qui fait que la santé passe souvent au second plan, d’où la nécessité d’intégrer ces questions dans une approche globale et pas trop médicale. » « Accueil des personnes en difficulté sociale dans les services hospitaliers, explications administratives, du diagnostic, soins adaptés, suivi, accompagnement. » « L'illettrisme, ceci provoque un problème pour connaître leurs droits. »
« Isolement social et culturel : manque, voir absence de liens sociaux d'un nombre important d'habitants
Manque d'écoute, de considération auprès des patients, usagers notamment fragiles (en situation de précarité, âgés). »
« Manque d'infos concrètes pour un public très en difficulté (/prévention Sida, éducation à la sexualité). »
« La santé est parfois la conséquence d'une autre politique comme par exemple améliorer les logements indécents. »
« Lutter contre la pauvreté et l'exclusion en associant les publics concernés à l'élaboration et à la mise en œuvre des actions. »
« Améliorer les conditions d’hygiène sur les aires d’accueil et d’habitat. »
« A partir des aides plus ciblées aux entreprises et collectivités et oblige à mettre en place les moyens pour accueillir les personnes déficientes. Supprimer la TVA sur les appareillages de santé. » « Isolement social de certaines populations. »
_________________________________________________________________________________
6 - Développer des conditions favorables à la santé et à l’intégration sociale des personnes âgées
« Inadéquation des locaux d'accueil des structures de personnes âgées à l'accroissement de la dépendance des personnes. »
« Améliorer les services d’aides à domicile en élargissant les critères d’accessibilité. » « Mettre en place les conditions de prise en charge des personnes non autonomes (âgées et/ou handicapées) cellules aménagées, soins de nursing, aide à domicile. »
« Vieillissement de la population/ dépendance. »
« Mise en place de réseaux pour une meilleure prise en charge des personnes âgées. »
« Problèmes de gestion de la maltraitance des personnes âgées. »
« Traçabilité des actions menées au domicile des personnes âgées. »
« L’habitat rural ancien pose des problèmes d’adaptation du logement aux incapacités des personnes en manque ou en perte d’autonomie. »
« Epuisement de l'entourage proche de la personne âgée dépendante. »
« L'insuffisance de structures d'accueil (à temps partiel, de jour et à temps complet) pour les personnes souffrant de troubles démentiels et alzheimer. »
« Une nécessité d'offrir une prise en compte complète des malades atteints de maladie d'Alzheimer ou apparentée et de leur aidants naturels : consultation gériatrique avancée (évaluation multi-partenariale des situations), des places d'hospitalisation de jour, des unités de vie protégée, une véritable aide aux aidants reconnue et structurée… »
« L'accompagnement des personnes en fin de vie. »
_________________________________________________________________________________
7 - Améliorer l’organisation et le développement des moyens et des méthodes de prévention et d’éducation à la santé
« Éducation/information/prévention (renforcement des moyens, notamment en milieu scolaire) »
« La prévention et l'information, la construction d'outils. »
« Créer des ateliers-santé dans les quartiers et dans les foyers type Sonacotra et/ou CHRS »
« Trop d’actions ponctuelles en matière de santé alors qu’il serait souhaitable d’inscrire les démarches dans la durée. »
« Améliorer la mise en oeuvre des principes de l'éducation pour la santé par les médecins. »
« Problème des financements des actions de santé (appel à projet, financement ponctuel et restreint, etc.).
Réunions sur le terrain (dans les villages…) abordant les thèmes de santé publique (tabac, alimentation, vaccinations, médicaments…). »
« Manque de moyens accordés pour la mise en place d'actions de promotion santé. »
« Manque de moyens pour une approche populationnelle par territoire. »
« Améliorer le ciblage des publics à risque en développement des outils de prévention capables d’être reçus par eux. »
« Difficultés, dans le cadre de financements annuels, de mise en place d'actions à long terme de promotion de la santé. »
« Favoriser le développement de Centres de Ressources d’information et de compétence dans les champs de la prévention. »
« Mauvaises coordinations des campagnes de prévention. »
« Multiplier les antennes de prévention dans les quartiers difficiles. »
« Réduire les inégalités de santé en réduisant les inégalités d'accès à la prévention. »
_________________________________________________________________________________
8 - Renforcer le dépistage et le suivi des cancers
« Amélioration des dépistages des cancers par des campagnes systématiques (Hémocult,
Mammographies, etc.) »
« Elargir le champ d’intervention sur les publics pour le dépistage du cancer colorectal ainsi que les autres cancers des voies digestives et œsophage. »
« Renforcer le dépistage du cancer du sein.»
« Prévention du cancer colorectal »
« Cancers - prévention et accompagnement des malades et de leurs entourages ».
_________________________________________________________________________________
9 - Réduire les inégalités territoriales d’accès aux services de santé, notamment en milieu rural, par des mesures permettant d’augmenter le nombre de professionnels de santé et d’anticiper les perspectives démographiques de ces professions
« Dans les zones rurales, accès difficile aux praticiens spécialistes. »
« Insuffisance du nombre de personnel compétent et qualifié (infirmières, masseurs kinésithérapeutes, psychologues….) dans les zones rurales. »
« Diminution de la démographie médicale. »
« Accessibilité aux services médicaux en milieu rural. »
« Problème de la couverture du territoire rural pour les médecins généralistes, les spécialistes… ce qui complexifie L’accès aux soins (moyen de transport, durée des déplacements, délais d’obtention des rendez-vous…). »
« Prendre de véritables mesures incitatives à l’installation des médecins en zones rurales et en zones urbaines sensibles. »
« Augmenter le numerus clausus de manière importante. »
« Gestion anticipée de la démographie médicale, paramédicale, éducative et sociale. »
« Augmenter le nombre des personnels de santé dans les centres hospitaliers (tous les services), les maisons de retraite, les écoles, collèges, lycées. »
_________________________________________________________________________________
10 - Faciliter l’accès aux soins en réduisant les freins financiers et administratifs
« Les moyens financiers pour se soigner. »
« La solvabilité des familles et l'accès à des spécialistes. »
« L'avance financière pour des soins spécifiques. »
« Coût important de certains traitements ou de certaines aides techniques, non ou très partiellement pris en charge par l’assurance maladie. »
« Les personnes ayant juste la CMU, donc pas de complémentaire, sont les plus démunis (problèmes dentaires, lunettes, impact sur la santé). »
« Difficultés d'ordre financier. »
« Santé et coût pour les publics à revenus faibles ou moyens. »
« Lutter contre la discrimination faite par certains praticiens qui refusent la prise en charge des bénéficiaires de la CMU pour certains soins (ex appareils dentaires) en zone rural cela entraîne des déplacements pour trouver un autre praticien. »
« Maintenir et même élargir la possibilité de la dispense d'avance de frais. »
_________________________________________________________________________________
11 - Prévenir, développer le repérage précoce des maladies cardio-vasculaires
« Lutter contre les maladies cardio-vasculaires. »
« Problèmes d’hypertension artérielle. »
« Mort subite prématurée d'origine cardiaque (manque de prévention et en matière d'éducation à la santé, les réflexes citoyens). »
« Les maladies cardio-vasculaires : conséquences directes de l'obésité et du déséquilibre alimentaire entraînant une sédentarité chez les jeunes. »
_________________________________________________________________________________
12 - Réduire le nombre des accidents de la route et de leurs conséquences mortelles et sanitaires, notamment auprès des jeunes conducteurs
« Réduire les décès et handicaps résultant d'accidents de la circulation : sécurité routière obligatoire. »
« Violence routière, Sécurité routière. »
« Accidents de la route et de la vie quotidienne et incidences fonctionnelles, financières et personnelles. » « Traumatologie routière. »
« Prévention routière pour les enfants, les adolescents. »
_________________________________________________________________________________
13 - Développer des conditions favorables à la santé et à l’intégration sociale des personnes handicapées
« Favoriser l’insertion des personnes handicapées dans le milieu du travail et la vie quotidienne. »
« Adaptation des structures publiques à l'accès aux handicapés. »
« Meilleure information du personnel et des élèves sur les maladies chroniques et les handicaps pour une meilleure intégration. »
« La perte d’autonomie des moins de 60 ans atteints de maladie invalidante n’est toujours reconnue. » « Prise en charge des grands handicaps aux âges extrêmes de la vie (témoignage des familles), enfants handicapés psycho moteurs, maladie d'Alzheimer. »
« La carence de structures d'accueil (médicosociales) adaptées pour patients handicapés souffrant d'handicaps mentaux et psychiques. »
« Accompagnement au quotidien du handicap. »
_________________________________________________________________________________
14 - Prévenir le sida, les hépatites et les maladies sexuellement transmissibles
« Lutte contre le SIDA, les hépatites, les maladies sexuellement transmissibles. »
« Les conduites à risque des personnes dans le domaine des infections sexuellement transmissibles Information et prévention des risques de contamination par le virus du sida en direction de tous les niveaux de population. »
« Prises de risques HIV, Hépatite C. »
« Les hépatites C et le SIDA, des fléaux auxquels on ne pense plus. »
« Prévention et traitement des personnes séropositives au VIH et/ou VHC (l’importance des personnes incarcérées pour des délits de consommation et vente de produits illicites font qu’il y a des niveaux de séropositivité important au VIH (trois fois supérieur à la population générale) et VHC (4 fois supérieur à la population générale. »
_________________________________________________________________________________ 15 - Prévenir les maladies d’origine environnementale, protéger la population et promouvoir un environnement sain
« OGM, pesticides, utilisation de produits traitants, etc. et troubles inhérents. » « Bruit. »
« Pollution (problèmes respiratoires, cancers pulmonaires en augmentation). »
« Améliorer la qualité de l’air. »
« Réduction de la pollution urbaine: émissions des véhicules les plus anciens (y compris transports en commun) et bruit. »
_________________________________________________________________________________
16 - Développer la promotion de la santé en milieu scolaire
« Favoriser l’éducation à la santé dans le cadre scolaire, de la maternelle à la terminale. »
« Attribuer un nombre d'heures annuel obligatoire pour la prévention à chaque niveau scolaire. » « Conserver un suivi médical des élèves pendant toute leur scolarité et faire connaître les lieux et moyens pour accéder à la prévention à tout age et dans tous les domaines. » « Augmenter le personnel de santé dans les établissements scolaires. »
« Inscription d’une véritable politique d’éducation à la santé dans l’école. »
« Prévenir la disparition progressive de la santé scolaire. »
_________________________________________________________________________________
17 - Développer les actions d’éducation, d’information et d’accompagnement des malades et de leur famille
« Problème des personnes qui sont dans le déni, difficulté à les amener à une prise de conscience et à les motiver à une démarche de soin. »
« Informer les malades des aides à l’accès aux soins proposées par les organismes départementaux. » « Manque d'information des malades. »
« Faire connaître par une politique nationale par les médias nationaux les structures d'aides existantes dans les communes, les villes. »
« Informer l'entourage des malades des conséquences de la maladie sur le comportement. »
_________________________________________________________________________________
18 - Améliorer la santé en milieu de travail
« Meilleure prise en compte de la santé au travail. »
« Prévention et gestion du stress, au travail et dans la vie personnelle. »
« Problèmes de santé mentale et physique liés au stress, harcèlement, au travail. »
« Mettre en place des veilles technologiques auprès des médecins du travail afin de réduire certains risques, tel que l'amiante. »
« Renforcer le contrôle technique des conditions de travail: mesures des niveaux d'exposition aux produits chimiques, du niveau de bruit. »
« Inégalités de santé dues aux conditions de travail. »
« Port de charges inadaptées aux situations, à la morphologie, à l’âge et situations de travail inadaptées d’un point de vue ergonomique. »
_________________________________________________________________________________
19 - Poursuivre, voire renforcer, les actions de médecine préventive et les mesures de protection
(vaccinations) pour un meilleur suivi de la santé tout au long de la vie
« Incitation à l'accès au bilan de santé : la plupart des jeunes qui accèdent au bilan de santé le font dans le cadre de leur participation à des actions de formation rémunérées. La démarche semble plutôt contraignante pour les jeunes en demande individuelle (déplacement sur le chef-lieu du département). »
« Améliorer le développement de la médecine préventive surtout auprès des publics très fragilisés accueillis dans les centres d’accueil et d’hébergement. »
« Le suivi après un bilan de santé. Comment s'assurer qu'une suite sera donnée ? »
« L'absence de suivi médical régulier des personnes. »
« Bilan médical complet à 60 ans tous les 2 ans. »
« L'absence de suivi dans les vaccinations des adultes. » _________________________________________________________________________________
20 - Renforcer le dépistage et la prévention du diabète
« Prévention des complications du diabète »
« Dépistage et prévention du diabète »
« Diabète : énorme consommation de produits et de boissons sucrées surtout chez les jeunes. »
_________________________________________________________________________________
21 - Développer la santé bucco-dentaire par des campagnes de dépistage et d’information et par une meilleure prise en charge financière des soins
« Soins dentaires : dédramatisation, prévention, remboursement. »
« Absence de soins dentaires (très, très fréquents). »
« Les problèmes de soins dentaires : la peur du dentiste étant toujours aussi vivace, le problème est encore plus criant pour des soins lourds et coûteux, ce qui freine énormément l'accès pour les jeunes à ce type de soins. »
« Augmenter le dépistage auprès des jeunes enfants et des adolescents des risques bucco-dentaires. »
_________________________________________________________________________________
22 - Accentuer la prévention autour de la naissance
« La nécessité de mise en œuvre, pour la petite enfance, d’un plan d'action périnatalité. » « Prévention de la prématurité. »
_________________________________________________________________________________
23 - Soutenir et renforcer le rôle éducatif des parents
« L'éclatement des familles (en nombre croissant). »
« Nécessité de toucher les parents qui sont les vecteurs des politiques de santé. »
« Pas d'éducation à la parentalité. Etre parents ne va pas de soi, il faudrait développer les structures comme "L'école des Parents".
« Les dérives de la société de consommation : manque de repères, mélange des valeurs. »
« Promotion d’une démarche de santé communautaire permettant aux futurs parents et parents d’être acteurs des choix relatifs à leur santé. »
_________________________________________________________________________________
24 - Améliorer la qualité des relations soignant – soigné
« Les rapports entre les professionnels de la santé et les patients. Comment rendre ce dernier acteur ? »
« Formation à l'écoute et à la compréhension globale des maladies de la part des soignants. »
« Humaniser les relations soignant-soigné. »
« Améliorer la loi Kouchner sur le droit des malades (transparence du dossier médical). »
« Aller vers une responsabilité partagée en matière de santé (entre malade et soignant). » « Le manque respect de l’humain par l’écoute, l’empathie, l’accompagnement au quotidien des personnes malades et/ou âgées. »
_________________________________________________________________________________
25 - Promouvoir le bon usage des médicaments
« Surconsommation médicamenteuse. »
« Automédication chez les filles (prises excessives de comprimés type Advil, Doliprane etc ) » « L'automédication : un danger. Pour économiser, ils se soignent avec des médicaments dont ils ne comprennent pas les effets nocifs. »
« Amélioration de l'observance thérapeutique et lutte contre le mésusage des médicaments. »
_________________________________________________________________________________
26 - Développer l’information sur la sexualité et les moyens de contraception
« La méconnaissance des méthodes de contraception chez les femmes et chez les hommes. » « Pas de réelle prise en compte de l'éducation sexuelle à l'école (un tabou réside encore dans ce domaine tant au niveau des familles qu'au niveau de l'école). »
« Grossesses précoces chez certaines adolescentes et grossesses à risques. »
« Etablir la gratuité des différents moyens de contraception et soutenir les plannings familiaux. »
_________________________________________________________________________________
27 - Réduire les traumatismes liés aux accidents domestiques par la promotion de mesures préventives auprès des personnes les plus exposées à ces risques
« Lutter contre les accidents domestiques. »
« Impact insuffisant des campagnes de sensibilisation sur les accidents domestiques : les campagnes menées à ce sujet sont rarement menées localement, ce qui réduit d’autant leur retentissement. »
« Chutes chez les personnes âgées. »
_________________________________________________________________________________
28 - Prévenir l’abus de conduites à risque des adolescents
« Prévenir l'abus de comportements à risque chez l'adolescent. »
« Conduites à risques chez les adolescents. »
_________________________________________________________________________________
29 - Favoriser les pratiques de soins corporels
« Hygiène »
« Hygiène corporelle insuffisante.»
_________________________________________________________________________________
30 - Développer la participation des citoyens au repérage des besoins de santé et faciliter la connaissance des indicateurs de santé dans la région
« Boites aux lettres santé » dans les mairies
« Pas d'existence de moyens permanents de recueil de la parole des citoyens concernant les problématiques de santé »
« Manque d'indicateurs locaux concernant les problèmes de santé publique afin d'assurer une meilleure prise en compte dans nos projets au sein du Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté par exemple. »
_________________________________________________________________________________ Enquête Delphi sur les priorités de santé en Lorraine Avril 2005
Deuxième questionnaire
Rappel de la première question
Compte tenu des objectifs généraux de la politique de santé publique en France:
- diminuer la mortalité prématurée évitable
- diminuer la morbidité
- améliorer la qualité de vie des personnes malades et lutter contre les incapacités
- réduire les inégalités de santé en réduisant les inégalités d’accès à la prévention,
Veuillez faire une liste de 10 problèmes (au maximum) que vous jugez importants à prendre en compte dans le domaine de la santé pour votre département afin d'atteindre ces objectifs.
Classez ces 10 problèmes prioritaires par ordre d’importance décroissante du 1er au 10ème (le 1er étant celui qui vous semble le problème majeur).
Vous pouvez justifier ce choix et ce classement que vous proposez en quelques mots.
Seconde question
Après une lecture attentive des propositions issues des résultats du premier questionnaire (Document 1), sélectionnez 10 priorités sur cette liste et attribuez leur un ordre de priorité : 1 pour la priorité qui vous paraît la plus importante, 2 pour celle qui, pour vous, arrive en seconde position d’importance, etc.
Pour transcrire vos réponses, utilisez le tableau de synthèse ci-joint (Tableau 1). Inscrivez dans la colonne « rang » l’ordre de priorité comme indiqué ci-dessus.
Commentez si vous le désirez votre choix ou vos regroupements. Vous pouvez utiliser pour cela la colonne de droite et y inscrire également vos remarques.
Merci de nous adresser votre réponse pour le 25 avril 2005
Soit par courrier à
ORSAS-Lorraine, 2 rue du doyen Jacques Parisot, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy
Soit par message électronique à l’adresse suivante :
Enquête Delphi sur les priorités de santé en Lorraine – PRSP
Tableau à remplir pour la seconde question
| Propositions issues du 1er questionnaire | Rang | Commentaire éventuel |
| 1 - Réduire la consommation de produits licites (tabac, alcool) ou illicites (drogues) pouvant entraîner une dépendance | ||
| 2 - Développer, adapter l’organisation des soins et renforcer les pratiques de coopération | ||
| 3 - Mieux identifier, prévenir et soigner la souffrance psychique et les problèmes de santé mentale | ||
| 4 - Favoriser une saine alimentation et la pratique de l’activité physique | ||
| 5 - Soutenir et accompagner les groupes les plus fragilisés par la pauvreté et la précarité | ||
| 6 - Développer des conditions favorables à la santé et à l’intégration sociale des personnes âgées | ||
| 7 - Améliorer l’organisation et le développement des moyens et des méthodes de prévention et d’éducation à la santé | ||
| 8 - Renforcer le dépistage et le suivi des cancers | ||
| 9 - Réduire les inégalités territoriales d’accès aux services de santé, notamment en milieu rural, par des mesures permettant d’augmenter le nombre de professionnels de santé et d’anticiper les perspectives démographiques de ces professions | ||
| 10 - Faciliter l’accès aux soins en réduisant les freins financiers et administratifs | ||
| 11 - Prévenir, développer le repérage précoce des maladies cardio-vasculaires  | ||
| 12 - Réduire le nombre des accidents de la route et de leurs conséquences mortelles et sanitaires, notamment auprès des jeunes conducteurs | ||
| 13 - Développer des conditions favorables à la santé et à l’intégration sociale des personnes handicapées | ||
| 14 - Prévenir le sida, les hépatites et les maladies sexuellement transmissibles | ||
| 15 - Prévenir les maladies d’origine environnementale, protéger la population et promouvoir un environnement sain | ||
| 16 - Développer la promotion de la santé en milieu scolaire | ||
| 17 - Développer les actions d’éducation, d’information et d’accompagnement des malades et de leur famille |
Suite du tableau à remplir pour la seconde question
| Propositions issues du 1er questionnaire | Rang | Commentaire éventuel |
| 18 - Améliorer la santé en milieu de travail | ||
| 19 - Poursuivre, voire renforcer, les actions de médecine préventive et les mesures de protection (vaccinations) pour un meilleur suivi de la santé tout au long de la vie | ||
| 20 - Renforcer le dépistage et la prévention du diabète | ||
| 21 - Développer la santé bucco-dentaire par des campagnes de dépistage et d’information et par une meilleure prise en charge financière des soins | ||
| 22 - Accentuer la prévention autour de la naissance | ||
| 23 - Soutenir et renforcer le rôle éducatif des parents | ||
| 24 - Améliorer la qualité des relations soignant – soigné | ||
| 25 - Promouvoir le bon usage des médicaments | ||
| 26 - Développer l’information sur la sexualité et les moyens de contraception | ||
| 27 - Réduire les traumatismes liés aux accidents domestiques par la promotion de mesures préventives auprès des personnes les plus exposées à ces risques | ||
| 28 - Prévenir l’abus de conduites à risque des adolescents | ||
| 29 - Favoriser les pratiques de soins corporels | ||
| 30 - Développer la participation des citoyens au repérage des besoins de santé et faciliter la connaissance des indicateurs de santé dans la région |
Autres commentaires éventuels sur le classement et les formulations :
Troisième questionnaire possible
Après avoir dégagé un consensus sur une dizaine de priorités, on peut aussi réinterroger les experts sur la maîtrise de ces priorités à un échelon local (départemental ou intercommunal). Dans ce cas, on les interroge sur le degré de maîtrise de chaque problème à l’échelon local en leur demandant d’attribuer une note de 0 à 10 (0 absence de maîtrise à l’échelon local, 10 forte maîtrise à l’échelon local).
En croisant priorité / maîtrise locale, on obtient un diagramme qui permet de hiérarchiser les problèmes au regard de ces deux critères. Et peut-être est-il préférable de privilégier des priorités secondaires mais dont on pense qu’elles pourront être réalisées localement.
ORSAS - Lorraine Dossier documentaire sur la méthode Delphi 24
192 G. SCHALLER - P. FOURNIER
Introduction
La santé mentale a été identifiée comme un axe prioritaire de prévention par la Direction générale de la santé publique de Genève. En effet, des taux de suicide élevés (principale cause de décès avant 40 ans), une consommation importante de psychotropes et de somnifères (12 % des hommes et 17% des femmes), ainsi que la perspective d’une augmentation de la prévalence des démences, corollaire du vieillissement de la population, sont des faits préoccupants [11]. Ces problèmes ne constituent pas un phénomène local puisque le suicide, le stress et l’abus de produits pharmaceutiques font partie des préoccupations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans le cadre de «la santé pour tous en l’an 2000 » [16]. Mais, actuellement, les interventions en termes de promotion de la santé et de prévention comportent des difficultés; en effet, les fondements mêmes des interventions ne sont pas évidents (rôle spécifique des différents facteurs de risques) [25].
Les problèmes de santé mentale mentionnés dans la littérature – le stress, l’anxiété, la dépression ou le suicide – se retrouvent à tout âge. Les enfants ne sont pas épargnés, en particulier quand ils sont maltraités, sanslogis, réfugiés ou souffrant de maladie chronique. Ils réagissent aux situations stressantes par des troubles du sommeil, de l’alimentation ou du comportement [1, 4, 26]. Les adolescents sont soumis à de nombreux stress : l’entrée à l’école secondaire, le développement de la sexualité, les conflits familiaux, l’excès de travail, le service militaire, auxquels s’ajoutent parfois une maladie somatique ou des problèmes de l’enfance. Ils réagissent parfois au stress par l’abus de drogues, d’alcool, de tabac ou de cannabis. Le risque de dépression augmente chez l’adolescent lors d’anxiété. Le suicide est précipité par le stress, une dépression, les séparations ou un support parental affaibli [3, 10, 14, 20, 21, 24]. Chez les adultes, l’anxiété est le problème de santé mentale le plus fréquent aux États-Unis (USA). La dépression s’exprime parfois sous forme de douleur somatique, menant les patients à consulter des médecins généralistes plutôt que des psychiatres. Le suicide est associé à un problème de santé somatique dans un cas sur deux, ou à un abus sexuel dans l’enfance. Les problèmes liés à la détresse mentale de l’adulte sont l’alcoolisme, les troubles de l’alimentation ou du sommeil, et l’automédication [2, 5, 9, 13, 15, 22]. Finalement, les problèmes de santé mentale le plus souvent rapportés chez les personnes âgées sont la démence, la dépression et la maladie de Parkinson [6].
Les résultats mentionnés dans la littérature ne sont pas directement applicables à chaque situation particulière. En effet, la population varie d’une ville à l’autre, en ce qui concerne l’âge et les conditions socioéconomiques, des facteurs influençant la nature et l’importance des problèmes de santé mentale. Une prévention efficace ne peut être mise en œuvre que sur la base des résultats établis localement. Le but de notre étude était donc d’identifier les problèmes de santé mentale prioritaires pour la prévention à Genève, sur la base d’un consensus établi entre les spécialistes et les intervenants du domaine.
Population étudiée et méthodes
Population étudiée
La population cible de l’étude était l’ensemble de la population genevoise.
| ORSAS - Lorraine Dossier documentaire sur la méthode Delphi 25 LES PRIORITÉS DE PRÉVENTION EN SANTÉ MENTALE À GENÈVE: 193 UNE ENQUÊTE PAR MÉTHODE DELPHI |
Méthodes
Choix de la méthode
Une étude par recherche de consensus a été menée entre janvier et juin 1995. La technique de Delphi a été retenue, car elle permet de donner rapidement et à faible coût une image de la réalité perçue du problème, alors qu’une enquête populationnelle, longue et coûteuse, est rarement utilisée pour analyser une catégorie spécifique de problèmes de santé [18]. L’anonymat de la procédure de consultation facilite la mise en commun d’intérêts a priori non conciliables, comme ceux des responsables de haut niveau, d’intervenants de terrain ainsi que d’usagers du système de santé. La technique de Delphi est basée sur une série de questionnaires postaux, anonymes et confidentiels, entre les organisateurs de l’étude et des informateurs-clés qui ne communiquent jamais directement entre eux. Généralement, le premier questionnaire permet d’identifier une large série d’alternatives, le (ou les) questionnaire(s) suivant(s) cherchant à établir un consensus. La technique de Delphi permet aussi d’identifier des pistes d’intervention, mais elle ne vise pas à définir des interventions précises [8, 17]. La méthode Delphi a déjà été utilisée pour identifier rapidement des priorités en médecine, dans le choix des médicaments essentiels ou le choix des domaines de recherche clinique [12, 19] ; elle est aussi couramment utilisée pour établir des consensus dans les domaines de la santé mentale et/ou de l’éducation [7, 23].
Un comité de pilotage a été formé afin de garantir l’éthique et le bon déroulement de l’étude; il s’est réuni à plusieurs reprises pendant l’étude. Il était composé de 4 personnes représentant respectivement l’Association des médecins privés, les Institutions universitaires de psychiatrie, l’Institut de médecine sociale et préventive et la Direction générale de la santé publique. Le comité a pris part à la composition de l’échantillon, s’est réuni avant chaque tour du Delphi pour donner son avis et faire des suggestions, et il a pris connaissance du rapport final. Aucun membre de ce comité ne participait à l’enquête, ni ne devait communiquer avec les participants.
Experts participants à l’enquête
La composition du groupe d’experts a été décidée lors d’un « Brainstorming » entre les 4 membres du comité de pilotage. Une liste d’association et d’institutions a été élaborée, elles ont été contactées par téléphone et sollicitées pour proposer un expert de leur choix. Il a été décidé que chaque participant devait être concerné à travers une association et/ou sa situation professionnelle par la santé mentale. Les milieux public et privé, ainsi que chaque groupe d’âge devaient être représentés. Les médecins, généralistes et psychiatres, ne devaient représenter qu’un tiers des participants. S’y ajouteraient des psychologues, des pharmaciens, des infirmiers et des assistants sociaux.
Premier tour de l’enquête
Chaque participant devait énumérer les problèmes de santé mentale qu’il jugeait importants à Genève, en précisant le groupe d’âge et le sexe concernés. De plus, il devait évoquer les causes des 2 problèmes les plus importants. Les toxicodépendances aux opiacés ont été exclues, car elle font l’objet de programmes déjà en œuvre.
Analyse des réponses reçues
| ORSAS - Lorraine Dossier documentaire sur la méthode Delphi 26 194 G. SCHALLER - P. FOURNIER |
L’analyse des questionnaires était essentiellement qualitative, le regroupement et la synthèse des énoncés a également permis leur quantification. Afin de regrouper les énoncés en problèmes, 2 classifications ont été utilisées, soit celle du DSM-IV, un manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux (USA) et celle du CIM-10, une classification des troubles mentaux et des troubles du comportement (OMS).Les problèmes n’entrant pas dans ces classifications officielles ont été traités séparément comme des problèmes de services, de ressources, surajoutés ou des problèmes psychosociaux, non spécifiques à la santé mentale, mais qui peuvent l’influencer (l’isolement social, le chômage).
Les causes suggérées pour les problèmes les plus importants ont été recensées et regroupées par classes d’âge et par sphère d’appartenance
(individu, travail, famille, société).
Deuxième tour de l’enquête
La liste des problèmes, de santé et de service, établie au premier tour a été envoyée aux 52 participants ayant répondu au premier. Il leur a été demandé de sélectionner les 3 problèmes les plus importants, en les cochant. De plus, 2 des 3 problèmes devaient être choisis comme prioritaires pour une intervention préventive; ce choix se basant sur la capacité à les résoudre, en se référant aux causes.
Analyse des réponses reçues
Les problèmes sélectionnés ont été quantifiés et classés par ordre décroissant. Pour la discussion des problèmes prioritaires, il a été considéré qu’il n’y avait plus consensus quand le nombre de citations diminuait de façon notable (on passait d’une fourchette comprise entre 32 et 10 citations par problème à
5 citations).
Quant aux perspectives d’intervention, elles ont été regroupées selon les milieux dans lesquels elles devraient se matérialiser (écoles par exemple) et selon le type d’intervention possible (information par exemple).
Confidentialité
Les participants n’étaient connus que des organisateurs. Un traitement confidentiel de toutes les données a été garanti grâce à l’anonymat. Chaque questionnaire ne portait qu’un numéro, et la corrélation numéroparticipant n’était connue que par un seul des organisateurs.
Résultats
Experts participants au Delphi
Une liste de 58 experts a été établie. Le tableau I présente la distribution des experts selon leurs compétences professionnelles, ainsi que le groupe d’âge dont ils s’occupent.
Résultats du premier tour de l’enquête
Sur un total de 58 participants contactés par téléphone et qui avaient accepté de participer à l’enquête, 52 ont répondu à la première lettre, après un rappel, soit 90%.
La synthèse et l’analyse des 540 énoncés exprimés au premier tour du Delphi a permis de faire une liste de problèmes de santé mentale à Genève. Les 540 énoncés ont été regroupés en 63 problèmes différents: 44 problèmes spécifiques de santé mentale et 19 problèmes psychosociaux, non spécifiques à la santé mentale, mais qui peuvent l’influencer (l’isolement social, le chômage, le déracinement des migrants). Les problèmes de santé mentale sont surtout des problèmes de santé (65 % des
ORSAS - Lorraine Dossier documentaire sur la méthode Delphi 29
LES PRIORITÉS DE PRÉVENTION EN SANTÉ MENTALE À GENÈVE: 197 UNE ENQUÊTE PAR MÉTHODE DELPHI
Tableau III: Distribution par problèmes des 540 énoncés reçus au premier tour du Delphi
A. Problèmes de santé mentale
1. Problèmes de santé
2. Problèmes de services
3. Problèmes de ressources4. Problèmes surajoutés
B. Problèmes psychosociauxnon spécifiques à la santé mentale Nombre d’énoncés Nombre de problèmes
(n = 540) (n = 63)
447 (83%) 44
351 (65%) 25
69 (13%) 14
17 (0,03%) 4
10 (0,02%) 4
93 (17%) 19
Les 19 problèmes de services (13% des énoncés) cités révèlent une inadéquation entre les services et les besoins. D’une part, la prise en charge extra hospitalière est insuffisante, en particulier les lieux de vie et l’environnement professionnel. D’autre part, l’hospitalisation est trop fréquente, et particulièrement inadaptée pour les bébés et les adolescents. Les problèmes de ressources (0,03 % des énoncés) comprennent la formation et le soutien du personnel soignant. Quelques problèmes ont été classés comme des problèmes surajoutés (0,02 % des énoncés); il ne s’agit pas de problèmes de santé, ni de services, ni de ressources, comme, par exemple, l’exclusion des patients psychiques.
Causes des problèmes de santé
L’analyse par classe d’âge a montré que les causes des problèmes de santé mentale chez les enfants sont peu ou pas détaillées. Sont évoqués, chez l’adolescent, le chômage, l’avenir incertain, le stress, la maltraitance et les abus sexuels (ces deux dernières étant à la fois des problèmes et les causes d’autres problèmes); chez l’adulte des causes d’ordre psychoaffectif, comme une séparation ; et chez la personne âgée, le passage à la retraite ou la solitude. Les causes des problèmes de santé mentale ont également pu être regroupées selon leur sphère d’appartenance: individuelle (abus sexuels et maltraitance dans l’enfance), familiale (violence et ruptures familiales), milieu professionnel (chômage) et sociétale (isolement social).
Résultats du 2e tour de l’enquête
Le taux de réponse s’établit à 98% (51/52). Sur un total de 231 sélections, 138 sont des problèmes de santé et 93 des problèmes de services. Les participants ont sélectionné parfois 3 problèmes de santé et 3 de services, en moyenne 4,5 problèmes, au lieu des 3 demandés. Le deuxième tour a permis confirmer la liste des problèmes de santé mentale les plus importants et de dresser une liste des problèmes prioritaires pour une intervention préventive.
Problèmes de santé les plus importants au 2e tour (tableau IV)
Dans l’ensemble, l’ordre de priorité des problèmes établi lors du premier niveau d’analyse est conforté, avec toutefois quelques exceptions. La dépression, l’abus d’alcool et les suicides apparaissent toujours comme des problèmes majeurs. Par contre, le niveau d’importance accordé à la maltraitance, aux abus sexuels et à la démence apparaît plus grand.
L’introduction de la notion de priorité pour la prévention modifie peu ce
ORSAS - Lorraine Dossier documentaire sur la méthode Delphi 31
LES PRIORITÉS DE PRÉVENTION EN SANTÉ MENTALE À GENÈVE: 199
UNE ENQUÊTE PAR MÉTHODE DELPHI
tion, les milieux dans lesquels elles devraient se matérialiser. Les interventions visant à réduire ces problèmes de santé mentale pourraient se développer dans les milieux suivants: le public en général, la famille, les écoles, la société, les services de professionnels et le réseau communautaire. Différents types d’intervention sont possibles: de l’information, un dépistage précoce, un réseau d’écoute et de conseils dans les écoles, des actions pour infléchir les facteurs sociaux (le chômage ou l’isolement), et la création de réseaux de solidarité dans les quartiers. Pour les problèmes de services, les propositions d’interventions préventives sont peu nombreuses. Pour prévenir les problèmes de prise en charge hospitalière, les participants proposent de décloisonner les services, de les coordonner entre eux et de faire des enquêtes de satisfaction auprès des consommateurs de soins.
Discussion
L’enquête menée par la méthode Delphi pour identifier les besoins en matière de prévention dans le domaine de la santé mentale à Genève, s’est bien déroulée. Plusieurs points positifs sont à relever. La participation des différents experts sollicités a été bonne, avec un taux de réponse de 90% et plus à chaque tour du Delphi. Les positions des participants ont évolué entre les 2 tours du Delphi confirmant la dynamique induite par la méthode ; la connaissance d’autres avis permettant à chacun d’avancer dans sa réflexion. Les choix (des problèmes, des priorités, des interventions) sont basés sur les perceptions de ceux qui sont susceptibles d’intervenir lors d’un programme de prévention. En effet, les participants sont tous intéressés et/ou concernés par la santé mentale, et leur opinion reflète ce qu’ils voient à travers leur situation professionnelle et/ou association. Cette vision est différente de celle qui aurait été produite par une enquête épidémiologique classique. Ces approches doivent être considérées plus complémentaires qu’antagonistes. La technique de Delphi est qualitative, et les résultats correspondent à une perception subjective et consensuelle d’un groupe d’environ 50 experts. Les résultats reflètent leur vision des problèmes à un moment donné, soit l’été 1995.
L’étude a surtout mis en évidence des problèmes de santé et de services, moins fréquemment des problèmes de ressources. Les informations concernant les problèmes sociaux, qui ne sont pas spécifiques à la santé mentale, ont été transmises aux services concernés. Les problèmes de santé mentale identifiés à Genève correspondent à ceux que l’on retrouve le plus souvent dans la littérature, comme le stress, l’anxiété, la dépression, le suicide, la maltraitance et la démence.
Il existe une abondante littérature sur les différents problèmes de santé mentale, mais aucune étude à notre connaissance n’établit des priorités pour la prévention. Les problèmes de santé mentale prioritaires pour la prévention à Genève sont: la dépression, l’abus d’alcool, la maltraitance et les abus sexuels (comme victime), le suicide, l’anxiété et l’agressivité. Il a été donné plus d’importance aux problèmes des victimes de maltraitance, et son corollaire l’agressivité, au 2e tour au détriment des problèmes de stress. La démence est jugée plus importante au 2e tour.
L’étude a fourni quelques pistes pour la prévention, en particulier sur le type et le milieu d’intervention
ORSAS - Lorraine Dossier documentaire sur la méthode Delphi 34
#OLOPHON
jÌ`iÃÊ«>ÀÌV«>ÌÛiðÊ1Ê}Õ`iÊ«ÕÀʽÕÌÃ>ÌiÕÀ
i«
iÊ`VÕiÌÊiÃÌÊÕÊiÝÌÀ>ÌÊ`iÊ>Ê«ÕLV>ÌʼjÌ`iÃÊ«>ÀÌV«>ÌÛiðÊ1Ê}Õ`iÊ«ÕÀʽÕÌÃ>ÌiÕÀ½]ÊÕiÊVj`ÌÊ`iÊÊ
>Ê`>ÌÊ,Ê >Õ`ÕÊiÌÊ`ÕÊ6>>ÃÊÃÌÌÕÕÌÊÛÀÊ7iÌiÃV>««iÊiÊ/iV}ÃVÊëiVÌi`iÀâiÊÛ7/®°ÊÊ
ÊiÝÃÌiÊ>ÕÃÃÊiÊjiÀ>`>ÃÊiÌÊiÊ>}>ð
>ÊÛiÀÃÊV«mÌiÊ`ÕÊ}Õ`iÊV«Ài`\ pÊ ÕiÊÌÀ`ÕVÌÊ}jjÀ>iÊ>ÕÝÊjÌ`iÃÊ«>ÀÌV«>ÌÛià pÊ `iÃÊ`ÀiVÌÛiÃÊ}jjÀ>iÃÊiÌÊ`iÃÊVÃiÃÊ«À>̵Õià pÊ ÕiÊ`iÃVÀ«ÌÊ`jÌ>jiÊ`iÊ£ÎÊjÌ`iÃÊ«>ÀÌV«>ÌÛiÃ\ʼӣÃÌÊ iÌÕÀÞÊ/ÜÊiiÌ}½ÆÊ >ÀÀiÌÌiÆÊÕÀÞÊ`iÊVÌÞiÃÆÊ
vjÀiViÊ`iÊVÃiÃÕÃÆÊiLiÀ>ÌÛiÊ*}ÁÆÊi«ÆÊ*>iÊ`½iÝ«iÀÌÃÆÊVÕÃÊ}ÀÕ«iÆÊ-ÕÛÊiÌÊjÛ>Õ>ÌÊ«>ÀÌV«>ÌvÃÆÊ
iÕiÊ`iÊ«>wV>ÌÆÊ ÝiÀVViÊ`iÊVÃÌÀÕVÌÊ`iÊÃVj>ÀÃÆÊiÃÌÛ>ÊÌiV}µÕiÆʼ7À`Ê >vj½ pÊ ÕiÊÃÌiÊ`iÊxäÊjÌ`iÃÊiÌÊÌiVµÕiÃÊ«>ÀÌV«>ÌÛiÃÊLÀmÛiiÌÊ`jVÀÌið
/ÕÌiÃÊiÃÊÛiÀÃÃÊÃÌÊÌjjV>À}i>LiÃÊ}À>ÌÕÌiiÌÊÃÕÀÊÜÜÜ°LÃvÀL°LiÊiÌÊÜÜÜ°ÛÜÌ>°Li°
ÕÌiÕÀ
Ê-VÕÊ1Ìi`Ê >ÌÃÊ1ÛiÀÃÌÞÊqÊ «>À>ÌÛiÊ,i}>ÊÌi}À>ÌÊ-ÌÕ`iî
/À>`ÕVÌ
ÕÀÀiÊØâv>ÊÀiÊ/>Ê7À`î
,iiVÌÕÀiÊw>iÊ
Ì>Ê>ÞiÀÊÀÕÊ`iÃÊ*̵ÕiÃÊ*ÕLµÕiÃ]Ê >>`>®
ViÊ/iiÀÊ ÞÀ>®
À`>ÌÊ«ÕÀÊ>Ê`>ÌÊ,Ê >Õ`Õ
À}ÌÌiÊÕÛiÕÃ>ÀÌ]ÊiÀÛjÊÃÀ]ÊiÀÀÌÊ,>ÕÜÃ]ÊÊ6>Ê >«iÕÌ
>ÞÕÌÊiÌÊÃiÊiÊ«>}i
i>*iÀÀiÊ>ÀÃÞ
«ÀiÃÃ *iiÌiÀÃÊÛ
j«ÌÊj}>\ÊÉÓääÈÉÓn{nÉäÓ
- £ä\ÊÓnÇÓ£Ó{nÇ8
- £Î\ÊÇnÓnÇÓ£Ó{nÇ \ÊÇnÓnÇÓ£Ó{nÇ
>ÀÃÊÓääÈ
ÛiVÊiÊÃÕÌiÊ`iÊ>ÊÌiÀiÊ >Ì>iÊLi}i
| $ELPHI | ||
| ) $³&).)4)/. >ÊjÌ`iÊi«Ê«µÕiÊÕiÊVÃÕÌ>ÌÊÌjÀ>ÌÛiÊ`½iÝ«iÀÌÃ°Ê >µÕiÊ«>ÀÌV«>ÌÊV«mÌiÊÕʵÕiÃÌ>ÀiÊiÌÊÀiXÌÊ iÃÕÌiÊÕÊvii`L>VÊÃÕÀÊÌÕÌiÃÊÃiÃÊÀj«ÃiðÊÊ>ÊÕmÀiÊ`iÊViÃÊvÀ>ÌÃ]ÊÊÀi«ÌÊÕiÊÕÛiiÊvÃÊiʵÕiÃÌ> ÀiÆÊViÌÌiÊvÃ]ÊiÊiÝ«µÕ>ÌÊV>VÕiÊ`iÊÃiÃÊ«ÃʵÕÊ`ÛiÀ}iÌÊvÀÌiiÌÊ`iÊViiÃÊ`iÃÊ>ÕÌÀiÃÊ«>ÀÌV«>ÌÃ°Ê iÃÊiÝ« V>ÌÃÊý>ÛjÀiÀÌÊÌÀmÃÊÕÌiÃÊ«ÕÀÊiÃÊ>ÕÌÀiÃ°Ê ÊÕÌÀi]ÊÊ«iÕÌÊV>}iÀÊ`½>ÛÃ]ÊiÊvVÌÊ`iÊÃ>Ê«À«ÀiÊjÛ>Õ>ÌÊ`iÃÊ ÕÛiiÃÊvÀ>ÌÃÊvÕÀiÃÊ«>ÀÊiÃÊ>ÕÌÀiÃÊ«>ÀÌV«>ÌÃ°Ê iÊ«ÀViÃÃÕÃÊiÃÌÊÀj«jÌjÊ>ÕÌ>ÌÊ`iÊvÃʵսÊiÊv>ÕÌ]ʽ`jiÊjÌ>ÌÊ µÕiʽiÃiLiÊ`ÕÊ}ÀÕ«iÊ«ÕÃÃiÊiÝ>iÀÊ`iÃÊ«ÃÊ`ÃÃ`iÌiÃÊL>ÃjiÃÊÃÕÀÊ`iÃÊvÀ>ÌÃÊ«ÀÛj}jiÃÊÕÊÀ>ÀiÃ°Ê *>ÀÊVÃjµÕiÌ]Ê`>ÃÊ>Ê«Õ«>ÀÌÊ`iÃÊ«ÀViÃÃÕÃÊi«]ÊiÊ`i}ÀjÊ`iÊVÃiÃÕÃÊý>VVÀÌÊDÊV>µÕiÊÌÕÀ° /À>`ÌiiiÌÊÀ}>ÃjiÃÊ«>ÀÊVÕÀÀiÀ]Ê`½>ÕÌÀiÃÊÛ>À>ÌiÃÊ`iÊjÌ`iÃÊi«Ê«iÕÛiÌÊ>ÛÀÊiÕÊiÊ}iÊÕÊiÊv>ViÊ DÊv>Vi°Ê>ÃÊiÊ«ÀViÃÃÕÃÊi«ÊÀ}>]ÊiÃÊ«ÀV«>iÃÊV>À>VÌjÀÃ̵ÕiÃÊ`iÊViÌÌiÊjÌ`iÊjÌ>iÌÊ£®Ê>ÊÃÌÀÕVÌÕÀ>ÌÊ`ÕÊ yÕÝÊ`½vÀ>ÌÃ]ÊÓ®ÊiÊvii`L>VÊ`jÊ>ÕÝÊ«>ÀÌV«>ÌÃÊiÌÊήʽ>Þ>ÌÊ`iÃÊ«>ÀÌV«>ÌðÊ>ÃÊÕʼi«ÊiÊv>ViÊ DÊv>Vi½]ʽ>Þ>ÌÊ`ë>À>Ì°ÊÕÌÀiÊÛ>À>Ìi\Êiʼi«Ê«ÌµÕi½ÊÕʼ*VÞÊi«½ÊiÊ>}>î]Ê`ÌÊiÊ«ÀV«>ÊLiV ÌvÊVÃÃÌiÊDÊiÝ«ÃiÀÊÌÕÌiÃÊiÃÊ«ÌÃÊiÌÊ«ÃÊVViÀ>ÌÊÕÊÌmiÊiÌÊiÃÊ«ÀV«>ÕÝÊ>À}ÕiÌÃÊ«ÕÀÊiÌÊVÌÀiÊDÊ ½j}>À`Ê`iÊViÃʫð )) 15!.$ ,54),)3%2 *ÀViÃÃÕÃÊ`>iV̵Õi]ÊiÊi«Ê>ÊjÌjÊVXÕÊ`>ÃÊiÊLÕÌÊ`½vvÀÀÊiÃÊ>Û>Ì>}iÃÊ`½ÕiÊÃiÊiÊVÕÊiÌÊ`½ÕÊjV>}iÊ `½«Ã]Ê`iÊ>mÀiÊDÊViʵÕiÊiÃÊ«iÀÃiÃÊÌiÀÀ}jiÃÊ«ÕÃÃiÌÊ`jVÕÛÀÀÊiÃÊ«ÃÊ`iÃÊ>ÕÌÀiÃ]ÊÃ>ÃÊViÌÌiÊyÕi ViÊiÝViÃÃÛiʵÕiʽÊÀiVÌÀiÊ«>ÀvÃÊ`>ÃÊiÃÊv>ViÊDÊv>ViÊVÛiÌiÃʵÕÊÃÌÊ}jjÀ>iiÌÊ`jÃÊ«>ÀÊViÕÝÊ µÕÊ«>ÀiÌÊiÊ«ÕÃÊvÀÌÊÕÊÌÊiÊ«ÕÃÊ`iÊ«ÀiÃÌ}i®°Ê>ÊÌiVµÕiÊ«iÀiÌÊ>ÕÝÊiÝ«iÀÌÃÊ`iÊÌÀ>ÌiÀÊ`½ÕÊ«ÀLmiÊV«iÝiÊ`iÊ >mÀiÊÃÞÃÌj>̵Õi°ÊÀÃÊ`iÊV>µÕiÊÌÕÀ]ÊiÃÊvÀ>ÌÃÊ«iÀÌiÌiÃÊÃÌÊ«>ÀÌ>}jiÃÊiÌÊiÀVÃÃiÌÊiÃÊV>ÃÃ> ViÃÊ`iÃÊiLÀiÃÊ`ÕÊ«>i°Ê iÕÝVÊÃÌÊ>ÀÃÊDÊkiÊ`iÊv>ÀiÊ`iÃÊÀiV>`>ÌÃʵÕÊÃiÊv`iÌÊÃÕÀÊ`iÃÊvÀ> ÌÃÊ«ÕÃÊV«mÌið >LÌÕiiiÌ]ÊÕiÊÕÊ«ÕÃiÕÀÃÊ`iÃÊViÃÊV>À>VÌjÀÃ̵ÕiÃÊiÌÀ>iÌÊiÊLiÃÊ`iÊv>ÀiÊ>««iÊDÊ>ÊjÌ`iÊi«\ ÊiÊ«ÀLmiÊiÊÃiÊ«ÀkÌiÊ«>ÃÊDÊ`iÃÊÌiVµÕiÃÊ`½>>ÞÃiÊ«ÀjVÃiÃÊ>ÃÊ«iÕÌÊÌÀiÀÊ«ÀwÌÊ`iÊÕ}iiÌÃÊÃÕLiVÌvÃÊ ÃÕÀÊÕiÊL>ÃiÊViVÌÛi° ÊiÃÊ«iÀÃiÃÊÀiµÕÃiÃÊ«ÕÀÊ«>ÀÌV«iÀÊDʽiÝ>iÊ`½ÕÊ«ÀLmiÊÛ>ÃÌiÊÕÊV«iÝiÊiÊ`ëÃiÌÊ`½>ÕVÕiÊ iÝ«jÀiViÊiÊVÕV>ÌÊiÌÊ«iÕÛiÌÊ«ÀjÃiÌiÀÊ`vvjÀiÌÃÊ«>ÀVÕÀÃÊ«ÀviÃÃiÃÊ>ÛiVÊiÕÀÃÊiÝ«iÀÌÃiÃÊiÌÊ V«jÌiVið ÊiÊLÀiÊ`iÊ«iÀÃiÃÊÀiµÕÃiÃÊiÃÌÊÌÀ«ÊjiÛjÊ«ÕÀÊÌiÀ>}ÀÊivwV>ViiÌÊ`>ÃÊiÊV>`ÀiÊ`½ÕÊjV>}iÊiÊv>ViÊ DÊv>ViÊÃ>ÕvÊiÊV>ÃÊ`iʼi«ÊiÊv>ViÊDÊv>Vi½ÊiÌÀiÊ`iÃÊÃj>ViÃÊ«jmÀiÃÊiÌÊ`iÃÊÃÕÃ}ÀÕ«iî° ÊiÃÊ`j>ÃÊiÌÊiÃÊV×ÌÃÊiÊ«iÀiÌÌiÌÊ«>ÃÊ`iÃÊÀjÕÃÊvÀjµÕiÌið ʽivwV>VÌjÊ`iÃÊÀjÕÃÊiÊv>ViÊDÊv>ViÊ«iÕÌÊkÌÀiÊ>VVÀÕiÊ«>ÀÊÕÊ«ÀViÃÃÕÃÊ`iÊVÕV>ÌÊViVÌÛiÊÃÕ««j iÌ>Ài° £®Ê >ÊjÌ`iÊi«Ê>ÊjÌjÊVXÕiÊ«>ÀÊ">vÊiiÀÊiÌÊ À>Ê>iÞÊ`iʽÀ}>Ã>ÌÊ, Ê À«À>Ì° | ||
| ÊiÃÊ`jÃ>VVÀ`ÃÊÃÌÊÌiiiÌÊ«ÀÌ>ÌÃÊÕʫ̵ÕiiÌÊ>VVi«Ì>LiÃʵÕiÊiÊ«ÀViÃÃÕÃÊ`iÊVÕV>ÌÊ `ÌÊkÌÀiÊ>ÀLÌÀjÊiÌÉÕʽ>Þ>ÌÊ`ÌÊkÌÀiÊ}>À>Ì° ʽjÌjÀ}jjÌjÊ`iÃÊ«>ÀÌV«>ÌÃÊ`ÌÊkÌÀiÊ«ÀjÃiÀÛjiÊ>wÊ`iÊ}>À>ÌÀÊ>ÊÛ>`ÌjÊ`iÃÊÀjÃÕÌ>ÌÃ]ÊV½iÃÌD`ÀiÊ>wÊÊ `½jÛÌiÀÊÌÕÌiÊ`>ÌÊ«ÃjiÊ«>ÀÊiÊLÀiÊÕÊ«>ÀÊÕiÊvÀÌiÊ«iÀÃ>Ìj° iʼi«Ê«ÌµÕi½ÊÀi«ÌʽÕÊ`iÃÊLiVÌvÃÊÃÕÛ>ÌÃÊÕÊÕiÊVL>ÃÊ`iÊViÕÝV\ Êý>ÃÃÕÀiÀʵÕiÊÌÕÌiÃÊiÃÊ«ÌÃÊ«ÃÃLiÃÊÌÊjÌjÊÃiÃÊÃÕÀÊ>ÊÌ>Li ÊiÃÌiÀʽ«>VÌÊiÌÊiÃÊVÃjµÕiViÃÊ`½ÕiÊ«ÌÊ`ji ÊiÝ>iÀÊiÌÊiÃÌiÀʽ>VVi«Ì>LÌjÊ`½ÕiÊ«ÌÊ`ji° ÊÀm}iÊ}jjÀ>i]Ê>ÊjÌ`iÊi«ÊÛÃiÊDÊÀiiÛiÀÊ`ÛiÀÃÊ`jwÃÊÃV«ÃÞV}µÕiÃÊ>ÃÃVjÃÊ>ÕÝÊ«ÀViÃÃÕÃÊ`iÊÌÀ>Û>ÊiÊ VÃðÊ*>ÀÊiÝi«iÃ\ Ê>Ê«iÀÃ>ÌjÊ`>ÌÀViÊÕʽ`Û`Õ>ÌjÊvÀÌiʵÕÊý>««À«ÀiÊiÊ«ÀViÃÃÕà ÊiÊv>ÌʵÕiÊiÃÊ«iÀÃiÃÊiÊÃiÌÊ«>ÃÊ`ëÃjiÃÊDÊ«Ài`ÀiÊ«ÃÌÊÃÕÀÊÕÊÃÕiÌÊÌ>ÌʵÕiÊÌÕÃÊiÃÊv>ÌÃÊiÊÃÌÊ «>ÃÊVÕÃÊÕÊÌ>ÌʵսiiÃÊ}ÀiÌÊ>Ê`ÀiVÌʵÕiÊ«Ài`À>Ê>Ê>ÀÌj Ê>Ê`vwVÕÌjÊ`iÊVÌÀi`ÀiÊ«ÕLµÕiiÌÊ`iÃÊ`Û`ÕÃʵÕÊVVÕ«iÌÊ`iÃÊ«ÃÌiÃÊ«ÕÃÊjiÛjà ÊiÊv>ÌʵÕiÊiÃÊ«iÀÃiÃÊiÊÃiÌÊ«>ÃÊ`ëÃjiÃÊDÊ>L>`iÀÊÕiÊ«ÊÕiÊvÃʵսiiÊ>ÊjÌjÊiÝ«ÀjiÊÊ «ÕLµÕiiÌ Ê>ÊVÀ>ÌiÊ`iÊÃÕiÛiÀÊÕiÊ`jiÊViÀÌ>iʵÕÊ«ÕÀÀ>ÌÊý>ÛjÀiÀÊ«iÕÊÃÕ>Ì>LiÊiÌʵÕÊ«ÕÀÀ>ÌÊv>ÀiÊ«iÀ`ÀiÊ>Êv>Vi° )))02/#³$52% ! !PER U ,i«ÀÌiâÛÕÃÊ>ÕÊ`>}À>iÊ`ÕÊÌÀ>iÌÊ`iÊ>ÊjÌ`iÊi«ÊVVÌÀiÊ«ÕÀÊÕÊ>«iÀXÕÊ}À>«µÕi° iÃÊjÌ`iÃÊi«ÊµÕ½iiÃÊÃiÌÊVÛiÌiiÃ]ÊiÊÌi«ÃÊÀjiÊÃÕÀÊÀ`>ÌiÕÀÊÕÊiÊv>ViÊDÊv>Vi®ÊV«ÌiÌÊ}jj À>iiÌʵÕ>ÌÀiÊjÌ>«iðÊÕÀ>ÌÊ>Ê«ÀimÀiÊjÌ>«i]ÊiÊÃÕiÌÊ`ÃVÕÌjÊv>ÌʽLiÌÊ`½ÕÊiÝ>iÊiÌÊV>µÕiÊ«iÀÃiÊvÕÀÌÊ iÃÊvÀ>ÌÃʵÕÊÕÊÃiLiÌÊ«iÀÌiÌiðÊÀÃÊ`iÊ>Ê`iÕÝmiÊjÌ>«i]ÊÌÕÃÊÌÊÕÊ>«iÀXÕÊ`iÃÊ`vvjÀiÌiÃÊ«ÃÊ `ÕÊ}ÀÕ«i]Ê«>ÀÊiÝi«i\ÊÀõÕiÊ`iÃÊÌiÀiÃÊÀi>ÌvÃ]ÊÌiÃʵÕiÊv>Ã>Li]Ê«ÀÌ>Ì]ÊÃÕ>Ì>Li]ÊiÌV°ÊvÌʽLiÌÊ `½>VVÀ`ÃÊÕÊ`iÊ`jÃ>VVÀ`ÃÊiÌÀiÊiÃÊiLÀiÃÊ`ÕÊ}ÀÕ«i°ÊiÃÊ`jÃ>VVÀ`ÃÊ>iÕÀÃÊÃÌÊiÝ>jÃÊÀÃÊ`iÊ>ÊÌÀÃmiÊ «>Ãi]Ê>wÊ`iÊ`j}>}iÀÊiÃÊÀ>ÃÃÊ`iÊViÃÊ`vvjÀiViÃÊiÌÊ`iÊiÃÊjÛ>ÕiÀ°Ê>ʵÕ>ÌÀmiÊjÌ>«iÊV«ÀÌiÊÕiÊjÛ>Õ>ÌÊ w>iʵÕÊ>ÊiÕÊÀõÕiÊÌÕÌiÃÊiÃÊvÀ>ÌÃÊ«ÀjVj`iiÌÊÀjÕiÃÊÌÊjÌjÊ>>ÞÃjiÃÊiÌʵÕiÊiÃÊjÛ>Õ>ÌÃÊÌÊjÌjÊ ÃÕÃiÃÊDÊÕÊÕÛiÊiÝ>i° iÃÊÃiVÌÃÊÃÕÛ>ÌiÃÊvÕÀÃÃiÌÊÕiÊ`iÃVÀ«ÌÊ`jÌ>jiÊ`½ÕÊi«ÊVÛiÌiÊ>ÃʵÕiÊ`iʽÕiÊ`iÊÃiÃÊÛ>À>ÌiÃ\Ê iʼi«Ê«ÌµÕi½°Ê w]ÊiÃÊ`vvjÀiÌiÃÊjÌ>«iÃÊ`iÊ>Ê vjÀiViÊi«ÊÃÌÊ«ÀjÃiÌjið Ê |
| "-ISEENUVRE £°ÊÊ*iÀÃiÊiÌÊÌ@Vià >®ÊʵիiÊÀ}>Ã>Ìii ½jµÕ«iÊÀ}>Ã>ÌiiÊ>Ê«ÕÀÊÃÃ\ Ê`iÊÀj`}iÀÊiÃʵÕiÃÌ>Àià Ê`½`iÌwiÀÊiÌÊ`iÊÀiVÀÕÌiÀÊiÃÊiÝ«iÀÌà Ê`iÊ`ÃÌÀLÕiÀÊiÃʵÕiÃÌ>Àià Ê`½>>ÞÃiÀÊiÃÊViÌ>ÀiÃÊiÌÊ`iÊ`iÀÊÕÊvii`L>VÊ>ÕÝÊiÝ«iÀÌÃÊ>«ÀmÃÊV>µÕiÊÌÕÀ Ê`iÊÀj`}iÀÊiÊÀ>««ÀÌÊw>° L®ÊÊ Ý«iÀÌÃ Ê «mÌiÌÊiÃʵÕiÃÌ>Àið ÊÃÃÃÌiÌÊ>ÕÝÊjÛjiiÌÃÊ«>wjÃ]Ê`>ÃÊiÊV>ÃÊ`½ÕÊi«ÊiÊv>ViÊDÊv>Vi V®ÊÊ`jÀ>ÌiÕÀà ÊV>ÃÊ`iÊi«ÊiÊv>ViÊDÊv>Vi]ÊÕÊÕÊ`iÕÝÊ`jÀ>ÌiÕÀÃÊÃÌÊÀiµÕÃÊ«ÕÀÊv>VÌiÀÊiÊ«ÀViÃÃÕð Ó°ÊÊi«ÊVÛiÌiÊ«>«iÀVÀ>Þ®Ê >Ê«ÀVj`ÕÀiÊÀ}>iÊ`ÕÊi«ÊV«Ài`ÊiÃÊjÌ>«iÃÊÃÕÛ>ÌiÃÊ«ÕÀÊÕÊ>«iÀXÕÊ}À>«µÕi]ÊVÃÕÌiâÊiÊ`>}À>iÊ`ÕÊ ÌÀ>iÌÊ`iÊ>ÊjÌ`iÊi«°® >®ÊÊÀiÀÊÕiÊjµÕ«iÊV>À}jiÊ`½À}>ÃiÀÊiÌÊ`iÊÃÕ«iÀÛÃiÀÊÕÊi«ÊÃÕÀÊÕÊÃÕiÌÊ`j L®ÊÊ-jiVÌiÀÊiÌÊÀiVÀÕÌiÀÊÕÊÕÊ`iÃÊ«>iÃʵÕÊ«>ÀÌV«iÀÌÊDʽiÝiÀVVi >LÌÕiiiÌ]ÊiÃÊiLÀiÃÊ`ÕÊ«>iÊÃÌÊ`iÃÊiÝ«iÀÌÃÊ`>ÃÊiÊ`>iÊVViÀj°Ê iÀÌ>iÃÊÃÕÀViÃÊ`µÕiÌʵսÕÊ Ûi>ÕÊ`½iÝ«iÀÌÃiÊjiÛjʽiÃÌÊ«>ÃÊÀiµÕÃÊÀõÕiÊiÃÊ«>jÃÌiÃÊÃÌÊÃÕvwÃ>iÌÊLiÊvÀjÃÊÃÕÀÊ>ʵÕiÃÌ°Ê iÊÃ×À]Ê iÊÛi>ÕÊ`½iÝ«iÀÌÃiÊÀiµÕÃÊ`j«i`À>Ê`ÕÊÃÕiÌÊVÃÊiÌÊ`iÃʵÕiÃÌÃÊ«ÃjiðÊiÊLÀiÊ`iÊiLÀiÃÊÛ>ÀiÊvÀÌiiÌÊ >ÃÊ`ÌÊVÕÀiÊ>ÕÊÕʵÕ>ÌÀiÊ«iÀÃiÃÊ«>ÀÊ«>i°
V®ÊÊ ViÛÀÊiÊ«ÀiiÀʵÕiÃÌ>ÀiÊi« Êv>ÕÌÊ>ÕÊÃÊÕÊÃÊ«ÕÀÊÀj`}iÀÊiʵÕiÃÌ>ÀiÊ`ÕÊ«ÀiiÀÊÌÕÀ°Ê`j>iiÌ]ÊiÃʵÕiÃÌÃÊ«ÃjiÃÊ`ÛiÌÊkÌÀiÊÃÕv wÃ>iÌÊëjVwµÕiÃÊ«ÕÀÊjiÀÊ>Ê«Õ«>ÀÌÊ`iÃÊvÀ>ÌÃÊÊ«iÀÌiÌiÃ]ÊÌÕÌÊiÊ«>X>ÌÊiÊÃÊ`iÊVÌÀ>ÌiÃÊ «ÃÃLiÊÃÕÀÊiÃÊvÀ>ÌÃ°Ê Ê«ÕÃÊ`ÕʵÕiÃÌ>Ài]ÊÕÊÀjÃÕjÊv>VÌÕiÊ`iÊ`VÕiÌ>ÌÊ}jjÀ>iÊiÃÌÊ>LÌÕiiiÌÊ vÕÀ°Ê>ÃÊViÀÌ>ÃÊV>Ã]ÊiÃÊ«>ÀÌV«>ÌÃÊÀiXÛiÌÊÕÊÕÊ«ÕÃiÕÀÃÊÃVj>ÀÃʵÕÊ«ÀjVÃiÌÊÕiÊÃjÀiÊ`½jjiÌÃʵÕÊ` |
| ÛiÌÊkÌÀiÊVÃ`jÀjÃÊViÊ`iÃÊ«ÀjÃÕ««ÃjÃÊ«ÕÀʽjÛ>Õ>ÌÊ`iÃÊÃÕiÌÃÊ}jjÀ>iiÌ]ÊViÃÊÃVj>ÀÃÊÌÀ>ÌiÌÊÊ `½>ëiVÌÃÊÌiÃʵÕiÊ>ÊÃÌÕ>ÌÊjVµÕiÊvÕÌÕÀiÆÊ«>ÀÊiÝi«i\ÊiÊÌ>ÕÝÊ`½y>Ì® -ÕÛiÌ]Ê«ÕÃiÕÀÃÊ«ÃÃLÌjÃÊÃÌÊ«À«ÃjiÃ]Ê>ÛiVÊ`iÃÊjViiÃÊ`½jÛ>Õ>Ì]Ê>wÊ`iÊ«iÀiÌÌÀiÊDÊ>Ê«iÀÃiÊÌiÀÀ}jiÊ `iʵÕ>ÌwiÀÊÃiÃÊ«ÀjvjÀiViÃ°Ê Ýi«iÊ`½jViiÊvÀjµÕiiÌÊÕÌÃji\
>ÃÊiÊV>ÃÊ`½ÕiÊ«ÀVj`ÕÀiÊ`iÊV>ÃÃwV>Ì]ÊÛiiâÊDÊiÊ«>ÃÊÕÌÃiÀÊ`iÃÊvÀÕ>ÌÃÊÌiiÃʵÕi\Ê*iÃiâÛÕÃʵÕiÊÞ°°°]Ê ÃÊÝ°°°°Ê-V`iâÊ«ÕÌÌÊViÃʵÕiÃÌÃÊiÊ`iÕÝÊvÀÕ>ÌÃÊëiÃ\Ê*iÃiâÛÕÃʵÕiÊÝ°°°¶ÊiÌÊ*iÃiâÛÕÃʵÕiÊÞ°°°¶°
`®ÊÊ/iÃÌiÀÊ>ÊvÀÕ>ÌÊ`ÕʵÕiÃÌ>ÀiÊ>L}ÕÌjÃ]Ê>µÕiÊ`iÊ«ÀjVî >µÕiʵÕiÃÌ>ÀiÊ`ÌÊkÌÀiÊ«Àj>>LiiÌÊÌiÃÌjÊ>Õ«ÀmÃÊ`iÊ«iÀÃiÃʵÕʽÌÊ«>ÃÊ«ÀÃÊ«>ÀÌÊDÊÃÊj>LÀ>Ì°Ê `iÌwiâÊÌÕÃÊiÃÊ«ÌÃÊ>ÊvÀÕjÃÊiÌÊVÀÀ}iâið i®ÊÊÃÌÀLÕiÀÊiÃÊ«ÀiiÀÃʵÕiÃÌ>ÀiÃÊ>ÕÝÊiLÀiÃÊ`ÕÊ«>i v®ÊÊ >ÞÃiÀÊiÃÊÀj«ÃiÃÊ`ÕÊ«ÀiiÀÊÌÕÀ }®ÊÊ*Àj«>ÀiÀÊiÃʵÕiÃÌ>ÀiÃÊ`ÕÊÃiV`ÊÌÕÀÊiÌÊiÃÊÌiÃÌiÀÊjÛiÌÕiiiÌ® ÀÃÊ`iÊViÊÃiV`ÊÌÕÀ]ÊiÃÊ`ÛiÀ}iViÃÊiÌÀiÊiÃÊ«ÃÊ`iÃÊ«>ÀÌV«>ÌÃÊÃÌÊÃiÃÊiÊjÛ`iViÊ>ÃÊÀiÃÌiÌÊ>Þ iî°ÊiÃÊ«>ÀÌV«>ÌÃÊ`ÛiÌÊiÃÃ>ÞiÀÊ`½iÝ«µÕiÀÊiÃÊ`vvjÀiViÃÊiÌÀiÊiÕÀÃÊ«ÃÊiÌÊViiÃÊ`iÃÊ>ÕÌÀiÃ]ÊiÊiÌ >ÌÊiÕÀÊÀ>ÃiiÌÊiÌÊÌÕÌiÃÊiÃÊvÀ>ÌÃÊiÃÃiÌiiÃÊ`ÌÊiÃÊ>ÕÌÀiÃÊ`ÛiÌÊ>LÃÕiÌÊ>ÛÀÊV>ÃÃ>Vi°Ê ÀÃÊ`iÊV>µÕiÊÌÕÀ]ÊViÃÊvÀ>ÌÃÊiÌÊÀ>ÃiiÌÃÊÃÌÊ«>ÀÌ>}jÃÊ>ÛiVÊiÃÊ>ÕÌÀiÃÊ«>ÀÌV«>ÌÃÊÌÕÌÊiÊVÃiÀÛ>ÌÊ ½>Þ>Ì®° |
| ®ÊÊ,iiÌÌÀiÊiÃʵÕiÃÌ>ÀiÃÊ`ÕÊÃiV`ÊÌÕÀÊ>ÕÝÊiLÀiÃÊ`ÕÊ«>i
®ÊÊ >ÞÃiÀÊiÃÊÀj«ÃiÃÊ`ÕÊÃiV`ÊÌÕÀ iÃÊjÌ>«iÃÊ}®ÊDÊ®ÊÃÌÊÀj«jÌjiÃÊ>ÕÃÃÊ}Ìi«ÃʵÕiÊÃÕ>ÌjÊÕÊjViÃÃ>ÀiÊ«ÕÀʽLÌiÌÊ`iÊÀjÃÕÌ>ÌÃÊÃÌ>Lið ®ÊÊ *Àj«>ÀiÀÊÕÊÀ>««ÀÌÊqÊ«>ÀʽjµÕ«iÊ`½>>ÞÃiÊqʵÕÊ«ÀjÃiÌiÊiÃÊVVÕÃÃÊ`iʽiÝiÀVVi
ΰÊÊi«Ê«ÌµÕiÊÎ®Ê /iiʵսÌ>iiÌÊ«ÀjÃiÌjiÊiÌÊÃiÊiÊ ÕÛÀi]Ê>ÊjÌ`iÊi«Ê>Û>ÌÊÌi`>ViÊDÊÌÀ>ÌiÀÊ`iÊÌmiÃÊÌiVµÕiÃÊiÌÊDÊ ViÀViÀÊÕÊVÃiÃÕÃÊ«>ÀÊÕÊ}ÀÕ«iÊ}miÊ`½iÝ«iÀÌÃ°Ê ÊÀiÛ>Vi]Êiʼi«Ê«ÌµÕi½ÊiÃÌÊÕÌÃjÊ«ÕÀÊ}jjÀiÀÊ iÃÊ`ÛiÀ}iViÃÊiÃÊ«ÕÃÊvÀÌiÃÊDÊ«À«ÃÊ`iÃÊÃÕÌÃÊ«ÌiÌiiÃÊDÊÕiʵÕiÃÌʫ̵ÕiÊ>iÕÀi°ÊÊ«iÕÌÊÌ>iÌÊ Ã½>}ÀÊ`½ÕiʵÕiÃÌÊ«ÕÀÊ>µÕiiÊʽiÝÃÌiÊ>ÕVÕʼiÝ«iÀ̽Ê>ÃÊÃiÕiiÌÊ`iÃÊ`jviÃiÕÀÃÊjV>ÀjÃÊiÌÊ`iÃÊ>ÀLÌÀiÃ°Ê 1ÊiÝ«iÀÌÊÕÊ>>ÞÃÌiÊ«iÕÌÊ«ÀjÃiÌiÀÊÕiÊiÃÌ>ÌʵÕ>Ìw>LiÊÕÊ>>Þ̵ÕiÊ`iÊViÀÌ>ÃÊivviÌÃʵÕÊ`jVÕiÌÊ`½ÕiÊ ÃÕÌÊ`ji°Ê/ÕÌivÃ]ÊÊiÃÌÊ«iÕÊ«ÀL>LiʵսÕiÊÃÕÌÊV>ÀiÊ«ÕÀÊÌÕÌiÃÊiÃÊ«iÀÃiÃÊVViÀjiîÊ`½ÕiʵÕià Ìʫ̵ÕiÊ`iÊiÕÊDÊÕiÊÌiiÊ>>ÞÃi°Ê½iÝ«iÀÌÊ«ÀiÊ>ÀÃʽivwV>VÌjÊiÌÊ`ÌÊ>vvÀÌiÀÊiÃÊ`jviÃiÕÀÃÊ`iÃÊ}ÀÕ«iÃÊ `½ÌjÀkÌÃÊVViÀjÃÊ`>ÃÊ>ÊÃVjÌj° iʼi«Ê«ÌµÕi½Ê«>ÀÌÊ`ÕÊ«ÀV«iʵÕiÊiÊ`jV`iÕÀÊiÊÃÕ>ÌiÊ«>ÃʵսÕÊ}ÀÕ«iÊ}jmÀiÊÃ>Ê`jVÃ]Ê>ÃÊ>iÀ>ÌÊ µÕ½ÕÊ}ÀÕ«iÊjV>ÀjÊ«ÀjÃiÌiÊÌÕÌiÃÊiÃÊ«ÌÃÊiÌÊ«ÀiÕÛiÃÊDʽ>««ÕÊ`iÊÃÊ«°Ê*>ÀÊVÃjµÕiÌ]Êiʼi«Ê«ÌµÕi½Ê iÃÌÊÕÊÕÌÊ`½>>ÞÃiÊ`iÃʵÕiÃÌÃʫ̵ÕiÃ]ÊiÌÊÊÕÊjV>ÃiÊ`iÊ«ÀÃiÊ`iÊ`jVðʽLÌiÌÊ`½ÕÊVÃiÃÕÃÊ ½iÃÌÊ«>ÃʽLiVÌvÊ«ÀiiÀ°Ê>ÊÃÌÀÕVÌÕÀiÊ`ÕÊ«ÀViÃÃÕÃÊ`iÊVÕV>ÌÊiÌÊiÊVÝÊ`ÕÊ}ÀÕ«iÊ`iÊ«>ÀÌV«>ÌÃÊ«iÕÛiÌÊ V«ÀiÌÌÀiÊvÀÌiiÌʽLÌiÌÊ`½ÕÊVÃiÃÕÃÊÃÕÀÊÕiÊÃÕÌÊëjVwµÕi°Ê Êv>Ì]Ê`>ÃÊViÀÌ>ÃÊV>Ã]ÊiÊV>` Ì>ÀiÊ«iÕÌÊkiÊ`i>`iÀÊÕiÊ«ÀVj`ÕÀiʵÕÊÀi`Ê«ÃÃLiÊÌÕÌÊVÃiÃÕð >Ê«ÀVj`ÕÀiÊ`Õʼi«Ê«ÌµÕi½ÊiÃÌÊ`i̵ÕiÊDÊViiÊ`½ÕÊi«ÊÌÀ>`Ìi]ÊÃÊViʽiÃÌʵÕiÊiÃʵÕiÃÌÃÊ«ÃjiÃÊ>ÕÝÊ iLÀiÃÊ`ÕÊ«>iÊ>ÕÀÌÊ`>Û>Ì>}iÊ«ÕÀÊLÕÌÊ`½iÝ>iÀÊÌÕÌiÃÊiÃÊ«ÃÃLÌjÃ]Ê«ÃÊiÌÊÀ>ÃÃʵÕiÊ`½>ÌÌi`ÀiÊÕÊ VÃiÃÕð Î®Ê ÝÌÀ>ÌÊ`iÊ/ÕÀvv]°ÊÌiÀiÌ®°Ê/iÊ*VÞÊi«°ÊÊ/iÊi«ÊiÌ`\/iVµÕiÃÊ>`Ê««V>ÌÃ]Ê««°ÊnäÊqÊÈ°ÊÊ ÌÌ«\ÉÉÜÜܰð̰i`ÕÉ«ÕLÃÉ`i«LÉÊ |
| iÃʵÕiÃÌÃÊÃÕÛ>ÌiÃÊ`iÛÀ>iÌÊÛÕÃÊ}Õ`iÀÊ`>ÃÊ>Ê«>wV>ÌÊiÌÊ>ÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ`½Õʼi«Ê«ÌµÕi½° ÊÀÕ>ÌÊ`iÃÊÃÕiÌÃ\Ê+ÕiÊÃÕiÌÊ`ÌÊÀjiiiÌÊkÌÀiÊiÝ>j¶Ê iÌÊ`ÌÊkÌÀiÊvÀÕj¶ Ê*ÀjÃiÌ>ÌÊ`iÃÊ«ÌÃ\ÊÌ>ÌÊ`jÊiÊÃÕiÌ]ʵÕiiÃÊÃÌÊiÃÊ«ÌÃʫ̵ÕiÃÊ`ëLiö ÊjwÌÊ`iÃÊ«ÃÌÃÊÌ>iÃÊÃÕÀÊiÃÊÃÕiÌÃ\Ê+ÕiiÃÊÃÌÊViiÃÊDÊ«À«ÃÊ`iõÕiiÃÊÌÕÌÊiÊ`iÊiÃÌÊ`jDÊ `½>VVÀ`ÊiÌʵÕiiÃÊÃÌÊViiÃÊÃ>ÃÊ«ÀÌ>ViÊDÊÃÕ««ÀiÀ¶Ê+ÕiiÃÊÃÌÊViiÃʵÕÊÌÀiÌÊiÃÊ`ÛiÀ}iViÃÊ iÌÀiÊiÃÊ«>jÃÌiö Ê Ý>iÊiÌÊ`iÌwV>ÌÊ`iÃÊÀ>ÃÃÊ`iÊViÃÊ`ÛiÀ}iViÃ\Ê+ÕiÃÊÃÌÊiÃÊ«ÀjÃÕ««ÃjÃ]Ê«ÃÊÕÊv>ÌÃÊÃÕà >ViÌÃÊ>Û>VjÃÊ«>ÀÊiÃÊiLÀiÃÊ`ÕÊ«>iÊ«ÕÀÊjÌ>ÞiÀÊiÕÀÃÊ«ÃÌÃÊÀiëiVÌÛiö ÊÛ>Õ>ÌÊ`iÃÊÀ>ÃÃÊÃÕÃ>ViÌiÃ\Ê iÌÊiÊ}ÀÕ«iÊVÃ`mÀiÌÊiÃÊ>À}ÕiÌÃÊÛµÕjÃÊ«ÕÀÊ`jvi`ÀiÊ iÃÊ`vvjÀiÌiÃÊ«ÃÌÃ¶Ê ÌÊViÌÊiÃÊV«>ÀiÌÃÊiÌÀiÊiÕݶ Ê,jjÛ>Õ>ÌÊ`iÃÊ«ÌÃ\Ê>ÊÀjjÛ>Õ>ÌÊÃiÊv`iÊÃÕÀÊiÃÊ«ÃÊÀi>ÌÛiÃÊ>ÕÝʼ«ÀiÕÛiýÊÃÕÃ>ViÌiÃÊiÌÊÃÕÀÊ ½jÛ>Õ>ÌÊ`iÊ>Ê«iÀÌiViÊ`iÊV>µÕiÊ«ÃÌ° Ê«ÀV«i]ÊÕiÊ«ÀVj`ÕÀiʼi«Ê«>«iÀVÀ>Þ½ÊÀiµÕiÀÌÊVµÊÌÕÀðÊ>ÃÊ>Ê«À>̵Õi]Ê>Ê«Õ«>ÀÌÊ`iÃʼi«Ê«ÌµÕiÃ½Ê ÌiÌiÌÊÌÕÌivÃÊ`iÊÃiÊÌiÀÊDÊÌÀÃÊÕʵÕ>ÌÀiÊÌÕÀÃ]ÊiÊÌi>ÌÊV«ÌiÊ`iÃÊ«ÌÃÊÃÕÛ>ÌÃ\ ʽjµÕ«iÊ`iÊVÌÀiÊVÃ>VÀiÊLi>ÕVÕ«Ê`iÊÌi«ÃÊ«ÕÀÊ«ÀjvÀÕiÀÊÕÌiÕÃiiÌÊiÃÊÃÕiÌð ÊiÃʵÕiÃÌ>ÀiÃÊvÕÀÃÃiÌÊÕiÊÕÊ`iÃÊÃÌiÃÊ«ÀÛÃÀiÃÊ`½«ÌÃʵÕiÊiÃÊ«>jÃÌiÃÊ«iÕÛiÌÊiÀVÀ° ÊiÃÊ«>jÃÌiÃÊÃÌÊ«ÀjÃÊ`iÊ`iÀÊiÕÀÊ>ÛÃÊÃÕÀÊÕÊ«ÌÊiÌÊÃÕÀÊiÃÊÞ«ÌmÃiÃÊÃÕÃ>ViÌiÃÊ`j}>}jiÃÊÀÃÊ`ÕÊ «ÀiiÀÊÌÕÀ°
>ÃÊÕʼi«Ê«ÌµÕi½]ÊÊVÛiÌÊ`iÊVÃÀÊViÊ«>ÀÌV«>ÌÃÊ`iÃÊ«iÀÃiÃÊvÀjiÃʵÕÊÀi«ÀjÃiÌiÌÊiÃÊÊ `vvjÀiÌÃÊ>ëiVÌÃÊ`iÊ>ʵÕiÃÌÊÌÀ>Ìji°Ê>ÊVVi«ÌÊÌ>iÊ`ÌÊ}>À>ÌÀʵÕiÊÌÕÌiÃÊiÃʵÕiÃÌÃÊiÌÊÃÕõÕiÃÌÃÊ ¼jÛ`iÌiýÊÌÊjÌjÊÌj}ÀjiÃÊiÌʵÕiÊiÃÊ«>ÀÌV«>ÌÃÊÃÌÊÛÌjÃÊDÊ`µÕiÀÊiÃÊ>ëiVÌÃÊiÃÊ«ÕÃÊÃÕLÌÃÊ`ÕÊ«ÀLmi°ÊÊ mÃÊÀÃ]ÊiÃÊÃÕ«iÀÛÃiÕÀÃÊ`ÛiÌÊ>ÌÀÃiÀÊÃÕvwÃ>iÌÊiÊÃÕiÌÊ«ÕÀÊV«Ài`ÀiÊiÃÊ«V>ÌÃʵÕiÊVÌiiÌÊiÃÊ Ài>ÀµÕiÃÊ`iÃÊ«>ÀÌV«>ÌðÊ
|
| {°ÊÊ vjÀiViÊi«Ê>ÕÃÃʼi«ÊiÊv>ViÊDÊv>Vi½ÊÕÊi«ÊViVÌv® iÌÌiÊÛiÀÃÊViVÌÛiÊiÊv>ViÊDÊv>ViÊ>ÃÃiÊ«ÕÃÊ`iÊ«>ViÊDÊ>Ê`ÃVÕÃÃÊiÌÊ>ÕÝÊ`jL>ÌÃÊiÌÊ«Ài`ÊÃÊ`iÊÌi«ÃʵÕiÊ>Ê ÛiÀÃÊÌÀ>`Ìii°Ê i«i`>Ì]ÊiÃÊ«>ÀÌV«>ÌÃÊ`ÛiÌÊÀiViÀÊDÊÌÕÌÊ>Þ>Ì° Ê,iVÀÕÌiâÊÕiÊjµÕ«iÊV>À}jiÊ`iÊ>ÊVVi«ÌÊiÌÊ`iÊ>ÊÃÕ«iÀÛÃ]ÊÕÊv>VÌ>ÌiÕÀÊiÌÊÕÊ>ÃÃÃÌ>ÌÊV>À}jÃÊ`iÊ iÌÌÀiÊiÊ ÕÛÀiÊiÌÊ`iÊ`À}iÀÊiÊi«ÊViVÌv°Ê iÌÌiÊjµÕ«iÊ`ÌÊV«ÌiÀÊ>ÕÊÃÊ`iÕÝÊ«ÀviÃÃiÃ]Ê`iÊÌiiÊ ÃÀÌiʵÕiʽÕÊ«ÕÃÃiÊVÌÀiÀÊiÊÌÀ>Û>Ê`iʽ>ÕÌÀi°Ê`j>iiÌ]ÊÕÊ`iÃÊ`iÕÝÊ`ÌÊV>ÌÀiÊiÊÌmiÊ>LÀ`jÊÌ>`ÃÊ µÕiʽ>ÕÌÀiÊ`ÌÊ>ÛÀÊ`iÃÊÌ>iÌÃÊÀj`>VÌið Ê1iÊjµÕ«iÊ`iÊ}iÃÌÊ`ÌÊVÃÀÊiÌÊ}jjÀ>iiÌ]Ê`jÌiÀ®ÊiÊÕÊiÃÊÌmiÃÊ>ÃʵÕiÊiÊLÀiÊ`iÊ«>iÃÊ i«° ÊjV`iâÊ>Ê`>ÌiÊDÊ>µÕiiÊÃiÊÌi`À>ÊiÊ«>i°Ê1iÊÕÀjiÊV«mÌiÊÛÕÃÊ«iÀiÌÌÀ>Ê`½jÌ>iÀÊiÊ«ÀViÃÃÕÃÊÃÕÀÊ «ÕÃiÕÀÃÊÌÕÀÃ]Ê`>ÃÊiÊV>ÃÊ`½ÕÊÃiÕÊÌmi°Ê-ÊÛÕÃÊ>ÛiâÊVÃÊ`iÃÊ«ÀLj>̵ÕiÃÊÌÀmÃÊV«iÝiÃÊÕÊ«ÕÃiÕÀÃÊ µÕiÃÌÃÊ>iÕÀiÃ]ÊÛÕÃÊ`iÛÀiâÊ«ÀjÛÀÊ«ÕÃÊ`iÊÌi«Ã° Ê,jÃiÀÛiâÊÕÊiÕÊ«ÕÀÊ>ÊVvjÀiVi°ÊÊÛÕÃÊv>ÕÌÊÕiÊ}À>`iÊ«mViÊ«ÕÀÊ>VVÕiÀÊÌÕÃÊiÃÊiLÀiÃÊ`ÕÊ«>i°Ê ½`j>ÊjÌ>ÌÊ`½>ÛÀÊ>VVmÃÊDÊ«ÕÃiÕÀÃÊ«iÌÌiÃÊÃ>iÃÊ`>ÃÊiõÕiiÃÊiÃÊÃÕÃ}ÀÕ«iÃÊ«iÕÛiÌÊÌÀ>Û>iÀ° Ê-jiVÌiâÊiÌÊÀiVÀÕÌiâÊ`iÃÊ«>ÀÌV«>ÌÃÊ«ÕÀÊV>µÕiÊ«>i°Ê>LÌÕiiiÌ]ÊiÃÊiLÀiÃÊ`ÕÊ«>iÊÃÌÊ`iÃÊ iÝ«iÀÌÃÊ`>ÃÊiÊ`>iÊÌÀ>Ìj° Ê,jÃiÀÛiâÊ`iÃÊ}iiÌÃÊiÊV>ÃÊjVj>ÌÊiÌÊ«ÀjÛÞiâÊiÃÊÀi«>ð Ê>LÀiâÊiʵÕiÃÌ>ÀiÊi«° Ê,j«ÃiÃÊ`Û`ÕiiÃÊ>ÕÝʵÕiÃÌÃ Ê >µÕiÊ«>ÀÌV«>ÌÊÀj«`Ê>ÕÝʵÕiÃÌÃ]ÊÃiÕÊiÌÊÃ>ÃÊVÃÕÌ>Ì° Ê*iÌÌÃÊ}ÀÕ«iÃ Ê iÃÊ«>ÀÌV«>ÌÃÊÃiÊÃÕL`ÛÃiÌÊiÊÃÕÃ}ÀÕ«iÃÊ`iÊ«iÀÃiÃʼÃ>ÀiýÊiÌÊ«Àj«>ÀiÌÊÕiÊÃÌiÊ`½vÀ>ÌÃ]Ê ÌÀjiÃÊ«>ÀÊÀ`ÀiÊ`½«ÀÌ>Vi°Ê iÊÃÌÊiÊv>ÌÊiÕÀÃÊ«ÃÊÃÕÀÊ>ʵÕiÃÌʵÕÊ`ÛiÌÊkÌÀiʼÃ>Àiý°Ê>ÊVÃÌ ÌÕÌÊ`iÊÃÕÃ}ÀÕ«iÃÊ}miÃÊ>Ê«ÕÀÊLÕÌÊ`iÊý>ÃÃÕÀiÀʵÕiÊÌÕÌiÃÊiÃÊvÀ>ÌÃÊ«ÀÌ>ÌiÃÊ«ÕÀÊÕÊ«ÌÊ `iÊÛÕiÊÕÊÕÊ}ÀÕ«iÊ`½ÌjÀkÌÃÊ«>ÀÌVÕiÀÊ>ÌÌi}iÌÊ>ÊÃÌiÊ«jmÀi° Ê-j>ViÊ«jmÀi Ê ,>ÃÃiLiâÊiÃÊjjiÌÃÊ«ÀÌ>ÌÃÊ`>ÃÊV>µÕiÊ}ÀÕ«iÊiÌÊ>vwViâiÃÊDÊÕÊi`ÀÌÊÛÃLiÊ«ÕÀÊÌÕÃÊÌ>Li>ÕÝ]Ê y«V>ÀÌÃ]ÊiÌV°®°Ê*ÕÀÊVi>]Ê`i>`iâÊDÊV>µÕiÊ}ÀÕ«iÊ`½`µÕiÀʽjjiÌÊiÊ«ÕÃÊ«ÀÌ>ÌÊÃiÊiÕÝÊ`>ÃÊ>Ê ÃÌiÊiÌʵÕʽ>Ê«>ÃÊiVÀiÊjÌjÊ>ÕÌjÊDÊ>ÊÃÌiÊ`ÕÊ}ÀÕ«iÊ«jiÀ°Ê Ê6ÌiÊiÊ«jmÀi Ê 1iÊ«ÀVj`ÕÀiÊDÊÛÌiÊÕÌ«iÊiÃÌÊÕÌÃjiÊ«ÕÀÊV>ÃÃiÀÊiÃÊjjiÌÃÊ«>ÀÊÀ`ÀiÊ`jVÀÃÃ>ÌÊ`½«ÀÌ>Vi°Ê ÃÃÃiâÊÕÊÃÞÃÌmiÊ`iÊ«ÌÃʵÕÊ}>À`iÊiÃÊjjiÌÃÊ>Þ>ÌÊiÊÃVÀiÊiÊ«ÕÃÊjiÛjÊiÌÊiÝVÕiÊViÕÝÊ>ÕÊÃVÀiÊiÊ «ÕÃÊL>ðÊ*ÕÀÊ>Ê«Õ«>ÀÌÊ`iÃÊÌmiÃ]ÊiÌÀiÊÃÝÊiÌÊiÕvÊjjiÌÃÊÃÕvwÃiÌ° Ê`wV>ÌÃÊ«iÀÃiiÃ Ê >µÕiÊ«>ÀÌV«>ÌÊiÝ>iÊiÃÊ`wV>ÌÃʵսÊÃÕ>ÌiÊ>««ÀÌiÀÊDÊ>ÊÃÌiÊ`iÊÃÊ}ÀÕ«iÊ>«ÀmÃÊ>ÛÀÊÛÕÊ>ÊÃÌiÊ «jmÀi° Ê*iÌÌÃÊ}ÀÕ«iÃ Ê iÃÊiLÀiÃÊV«>ÀiÌÊiÃÊ«ÀiiÀÃÊjjiÌÃÊ`iÊ>ÊÃÌiÊ`iÊiÕÀÊ}ÀÕ«iÊDÊViÕÝÊ`iÊ>ÊÃÌiÊ«jmÀi°Ê ÊV>ÃÊ`iÊ `vvjÀiViÃ]ÊiÃÊ«iÌÌÃÊ}ÀÕ«iÃÊÌÊ`iÕÝÊ«ÃÃLÌjðÊ-ÌÊÃÊ`wiÌÊiÕÀÊÃÌiÊ«ÕÀÊý>««ÀViÀÊ`>Û>Ì>}iÊ`iÊ>Ê «jmÀi]ÊÃÌÊÃÊvÕÀÃÃiÌÊ`iÃÊ>À}ÕiÌÃÊiÊv>ÛiÕÀÊ`½ÕiÊ`wV>ÌÊ`iÊ>ÊÃÌiÊ«jmÀiÊ«ÕÀʵսiiÊÃÌÊ«ÕÃÊ «ÀViÊ`iÊ>ÊiÕÀ°Ê*ÕÀÊVi>]ÊÃÊ«ÀVm`iÌÊViÊÃÕÌ\ÊÃÊ>ÕÌiÌÊDÊiÕÀÊÃÌiÊiÃÊjjiÌÃÊ`iÊ>ÊÃÌiÊ«jmÀiÊ µÕ½ÃÊ>Û>iÌÊÃÊ>ÃʵսÃÊÃÌÊ«ÀkÌÃÊDÊ>VVi«ÌiÀ°ÊÃÊ«Àj«>ÀiÌÊÕÊLÀivÊÀ>««ÀÌÊ>wÊ`½jÌ>ÞiÀÊiÃÊ«ÀiiÀÃÊjj iÌÃÊ`iÊiÕÀÊÃÌiʵÕ]ÊÃiÊiÕÝ]Ê`ÛiÌÊkÌÀiÊ>ÕÌjÃÊDÊ>ÊÃÌiÊ«jmÀi°Ê |
| Ê , ,+1 \Ê>ÊÀj`>VÌÊ`iÊViÊÀ>««ÀÌÊ`ÌÊÃiÊ`jÀÕiÀÊ`>ÃÊÕÊViÀÌ>Ê>«ÃÊ`iÊÌi«ÃÊÕiÊÕÌi]Ê«>ÀÊiÝi «i®°Ê iÊÀ>««ÀÌʽ>Ê«>ÃÊ«ÕÀÊLÕÌÊ`iÊVÛ>VÀiÊiÃÊ>ÕÌÀiÃÊ`iÊ`wiÀÊiÕÀÃÊ«ÌÃÊ`iÊÛÕi]Ê>ÃÊ`iÊ«ÀjÃiÌiÀÊ`iÃÊ ¼jÛ`iViýʵÕiÊiÃÊ>ÕÌÀiÃÊ>ÕÀ>iÌÊj}}jiÃÊÃiÊiÊ}ÀÕ«i°Ê >µÕiÊ«iÌÌÊ}ÀÕ«iÊ`jVÀÌÊÃ>ÊÃÌiÊ`wjiÊÃÕÀÊÕiÊ viÕiÊ`iÊÕÀ>ÊiÌÊÃiÃʼjÛ`iViýÊÃÕÃÊ>ÊvÀiÊ`iÊÌiîÊÃÕÀÊÕiÊ>ÕÌÀi° Ê*ÀjÃiÌ>ÌÊ`iÃÊÀ>««ÀÌÃÊ`iÃÊ«iÌÌÃÊ}ÀÕ«iÃÊDʽ>ÃÃiLjiÊ«jmÀi Ê iÃÊÃÌiÃÊ`wjiÃÊ`iÃÊ«iÌÌÃÊ}ÀÕ«iÃÊÃÌÊ>vwVjiÃÊÃ>ÃÊViÌ>Ài°Ê >µÕiÊ}ÀÕ«iÊ>vwVi]ÊÌÕÀÊDÊÌÕÀ]ÊÃiÃÊ >À}ÕiÌÃÊiÌÊiÃÊiÝ«µÕiÊLÀmÛiiÌ°Ê >µÕiÊÀ>««ÀÌÊiÃÌÊÃÕÛÊ`½ÕiÊLÀmÛiÊÃj>ViÊ`iʵÕiÃÌÃÉÀj«ÃiÃÊDÊ`iÃÊ wÃÊ`iÊV>ÀwV>ÌÊÕµÕiiÌ°ÊiÃÊÌiÃÊ`iÊÌi«ÃÊÃÌÀVÌiÃÊÃÌÊ«Ãjið ÊÌ>LÃÃiiÌÊ`½ÕÊVÃiÃÕÃÊiÊ«jmÀi\ÊÀiÛiiâÊDʽjÌ>«iʼ6ÌiÊiÊ«jmÀi½ÊiÌÊÀj«jÌiâÊ>Ê«ÀVj`ÕÀiÊÕõսDÊ LÌiÌÊ`½ÕÊVÃiÃÕðÊiÃÊVÌÀ>ÌiÃÊ`iÊÌi«ÃÊ«iÕÛiÌÊjViÃÃÌiÀÊÕÊLÀiÊwÝiÊ`iÊVÞViðÊiÊVÃiÃÕÃÊ «iÕÌÊkÌÀiÊÀivÀVjÊ«>ÀʽÌÀ`ÕVÌÊ`iÊ`iÕÝÊVÞViÃÊ`iÊÛÌi]Ê>ÕÊiÕÊ`½ÕÊÃiÕ]ÊÀÃÊ`iʽjÌ>«iʼ6ÌiÊiÊ«jmÀi½° *ÕÀÊ`iÃÊvÀ>ÌÃÊ`jÌ>jiÃÊÃÕÀÊ>ʫëiÊÃÕÃ>ViÌiÊDÊ>ÊjÌ`iÊi«]Ê>ÃʵÕiÊ`ÛiÀÃiÃÊ>««V>ÌÃ]Ê VÃÕÌiâÊiÊÃÌiÊÜÜܰð̰i`ÕÉ«ÕLÃÉ`i«LÊ |
| )6 2%33/52#%3 #!,%.$2)%2 "5$'%4 ! #ALENDRIER iÊÌ>Li>ÕÊÃÕÛ>ÌÊ«ÀjÃiÌiÊiÊ«À}À>iÊiL`>`>ÀiÊ}jjÀ>Ê`½ÕiÊÛiÀÃÊiÊ}iÊ`ÕÊi«°ÊÊÛÕÃÊiÃÌÊÌÕÌivÃÊ vÕÀÊDÊÌÌÀiÊvÀ>Ìv°Ê ÌiâʵÕiÊiÃÊ«>}ÃÊÛ>ÀiÌÊvÀÌiiÌÊiÌʵÕiÊiÃʼi«ÊiÊv>ViÊDÊv>Vi½ÊjViÃÃÌiÌÊLi>ÕVÕ«Ê «ÕÃÊ`iÊÌi«ÃʵÕiÊViÕÝÊÀ}>ÃjÃÊiÊ}i°
|
| " "UDGET -ÌÊÀj«iÀÌÀjÃÊV`iÃÃÕÃÊiÃÊ«ÀV«>ÕÝÊ«ÃÌiÃÊLÕ`}jÌ>ÀiÃÊ`½ÕÊi«\ Ê*iÀÃi Ê pÊjµÕ«iÊÀ}>Ã>Ìii Ê pÊ`jvÀ>iiÌÃÊ`iÃÊiÝ«iÀÌÃ Ê pÊ`jÀ>ÌiÕÀî Ê6Þ>}i Ê pÊÕµÕiiÌÊ«ÕÀÊiÃʼi«ÊiÊv>ViÊDÊv>Vi½\ÊvÀ>ÃÊ`iÊÛÞ>}iÊ«ÕÀÊiÃÊiÝ«iÀÌÃÊiÌÊ`jÀ>ÌiÕÀî Ê}iiÌ Ê pÊÕµÕiiÌÊ«ÕÀÊiÃʼi«ÊiÊv>ViÊDÊv>Vi½\Ê}iiÌÊ«ÕÀÊiÃÊiÝ«iÀÌÃÊiÌÊ`jÀ>ÌiÕÀî Ê ÕÀÀÌÕÀi Ê pÊÕµÕiiÌÊ«ÕÀÊiÃʼi«ÊiÊv>ViÊDÊv>Vi½\ÊÀi«>ÃÊ«ÕÀÊiÃÊiÝ«iÀÌÃÊiÌÊ`jÀ>ÌiÕÀî Ê,iVÀÕÌiiÌÊiÌÊ«ÀÌ Ê pÊÀiVÀÕÌiiÌÊ`iÃÊiÝ«iÀÌÃ Ê ÕV>ÌÃ Ê pÊvÀ>ÃÊ`½«ÀiÃÃÊiÌÊ`½>vvÀ>VÃÃiiÌÊ`iÃÊiµÕkÌiÃÊÃÊ«>ÀÊVÕÀÀiÀÊÌÀ>`Ìi® Ê pÊ«ÀiÃÃÊ`iʽ>Û>Ì«ÀiÌÊiÌÊ`ÕÊÀ>««ÀÌÊw>]ÊiÌÊ`ÃÌÀLÕÌ ÊvÀ>ÃÌÀÕVÌÕÀi Ê pÊÕµÕiiÌÊ«ÕÀÊiÃʼi«ÊiÊv>ViÊDÊv>Vi½\ÊiÕÊ«ÕÀʽjÛjiiÌ Ê>ÌjÀiÊiÌÊvÕÀÌÕÀiÃÊÃiÊiÊÌÞ«iÊ`iÊi«ÊVî 6 !542%3 "/..%3 02!4)15%3 %4 0)¶'%3 ³6%.45%,3 *>ÀÊiÃÊÀ>ÃÃÊvÀjµÕiÌiÃÊ`iʽjViVÊ`½ÕÊi«]ÊVÌÃ\ ÊiÊÃÕ«iÀÛÃiÕÀÊ«ÃiÊ>ÕÝÊ«>jÃÌiÃÊÃiÃÊÛÕiÃÊiÌÊ`jiÃÊ«ÀjVXÕiÃÊDʽj}>À`Ê`½ÕÊ«ÀLmiÊiÊ`jÌ>>ÌÊiÝViÃà ÛiiÌÊ>ÊÃÌÀÕVÌÕÀiÊ`ÕÊi«ÊiÌÊ`VÊiÊiÊ>ÃÃ>ÌÊ«>ÃÊ`iÊ«>ViÊDÊ`½>ÕÌÀiÃÊ«ÌÃÊ`iÊÛÕi° ʽޫÌmÃiʵÕiÊiÊi«Ê«iÕÌÊÃÕLÃÌÌÕiÀÊÌÕÌiÃÊiÃÊ>ÕÌÀiÃÊvÀiÃÊ`iÊVÕV>ÌÊÕ>iÊ`>ÃÊÕiÊÃÌÕ>ÌÊ `ji° ÊiÃÊÌiVµÕiÃÊivwV>ViÃÊ«ÕÀÊ>ÊÃÞÌmÃiÊiÌÊ>Ê«ÀjÃiÌ>ÌÊ`iÃÊÀj«ÃiÃÊ`iÃÊ}ÀÕ«iÃÊiÌʵÕÊiÊ«iÀiÌÌiÌÊ `VÊ«>ÃÊ`iÊ}>À>ÌÀÊiÃÊÌiÀ«ÀjÌ>ÌÃÊ>LÌÕiiÃÊ`iÃÊjViiÃÊ`½jÛ>Õ>ÌÊÕÌÃjiÃÊ`>ÃʽiÝiÀVVi° Ê}ÀiÀÊ>ÕÊiÕÊ`½iÝ>iÀ®ÊiÃÊ`ÛiÀ}iViÃÊ`iÊÌiiÊÃÀÌiʵÕiÊiÃÊ`ÃÃ`iÌÃÊ`jVÕÀ>}jÃÊ>L>`iÌÊiÌʵսÕÊ VÃiÃÕÃÊ>ÀÌwViÊiÃÌÊLÌiÕ° Ê-ÕÃiÃÌiÀÊiÊV>À>VÌmÀiÊiÝ}i>ÌÊ`½ÕÊi«ÆÊiÊ«>ÃÊÀiV>ÌÀiÊiÃÊ«>ÀÌV«>ÌÃÊiÊÌ>ÌʵÕiÊVÃÕÌ>ÌÃÊiÌÊiÊ «>ÃÊiÃÊÀjÌÀLÕiÀÊVÀÀiVÌiiÌÊ«ÕÀÊiÊÌi«ÃʵսÃÊÞÊÌÊVÃ>VÀj]ÊÃÊiÊi«ÊiÊv>ÌÊ«>ÃÊ«>ÀÌiÊÌj}À>ÌiÊ`iÊiÕÀÊ ÌÀ>Û>° *ÕÀÊÀjÕÃÃÀÊÕÊi«]ÊÊiÃÌÊ«ÀÌ>Ì\ Ê`iÊÃjiVÌiÀÊ>ÌÌiÌÛiiÌÊiÊ}ÀÕ«iÊ`iÊÀj«`>ÌÃÉ«>jÃÌiÃÊ Ê`½>`>«ÌiÀÊ>ÊVVi«ÌÊ`ÕÊi«ÊDʽ>««V>ÌÊVÃiÊ Ê`iÊ}>À>ÌÀʽkÌiÌjÊiÌʽ«>ÀÌ>ÌjÊ`iʽjµÕ«iÊ`iÊÃÕ«iÀÛÃÊ Ê`iÊ}>À>ÌÀÊÕÊ>}>}iÊiÌÊÕiÊ}µÕiÊVÕÃ]ÊÃÕÀÌÕÌÊÃÊiÃÊ«>ÀÌV«>ÌÃÊ«ÀÛiiÌÊ`½À}iÃÊVÕÌÕÀiiÃÊ `ÛiÀÃið |
| 2ÏFÏRENCESETRESSOURCES 6ÕÃÊÌÀÕÛiÀiâÊ`iÊLÀiÕÃiÃÊ«ÕLV>ÌÃÊÃÕÀÊ>ÊjÌ`iÊi«ÊiÌÊÃiÃÊ>««V>ÌÃÊ`ÌÊÃiÕiiÌʵÕiµÕiÃÕiÃÊ ÃÌÊiÌjiÃÊV`iÃÃÕîÊÃÕÀÊiÊÃÌiÊ`iʽÀ}>Ã>ÌÊ,>`Ê À«À>Ì\ÊÜÜÜ°À>`°À} ÀÜÊ °]Ê/iÊi«Ê*ÀViÃÃ\ÊÊiÌ`}ÞÊ1Ãi`ÊvÀÊÌiÊ VÌ>ÌÊvÊ"«ÃÊvÊ Ý«iÀÌÃ]Ê,>`ÊVÕiÌ]Ê£Èn]Ê °Ê*ÎÓxÊÜÜÜ°À>`°À}®Ê >iÞÊ °ÊiÌÊiiÀÀÃVLiÀ}Ê"°]ÊÊ Ý«iÀiÌ>Ê««V>ÌÊvÊÌiÊi«ÊiÌ`ÊÌÊÌiÊ1ÃiÊvÊ Ý«iÀÌÃ]Ê£ÈÓ]Ê ,ÇÓÇ*,°ÊÜÜÜ°À>`°À}®Ê VÊ °]Êi«Êv>ViÊÌÊv>Vi]ÊÓäääÊ`ëLiÊÃÕÀÊÜÜÜ°ÃVÕ°i`Õ°>ÕÉÃVÃÉ}VÉ>ÀÉ>À«É`i«°Ì®Ê ÀiÃ}ÌÊvÀÊ,i}>ÊiÛi«iÌÊ iÌÜÀ]Ê*À>VÌV>ÊÕ`iÊÌÊ,i}>ÊÀiÃ}ÌÊÊÌiÊ1Ìi`Ê}`]ÊÊ jViLÀiÊÓää£ÊÌÌ«\ÉÉvÀi°ÀV°iÃÉVÃÉiÕÀÓä£Óni°«`v® iÊ°Ê`°®]ÊÕÌÕÀiÃÊ,iÃi>ÀVÊiÌ`}Þ]Ê6iÀÃÊ£°ä°]Ê É1 1Ê/iÊiÕÊ*ÀiVÌ ÃÌiÊ°ÊiÌÊ/ÕÀvvÊ°]ÊÌÀ`ÕVÌ]Ê`>ÃÊ°ÊÃÌiÊiÌÊ°Ê/ÕÀvvÊ `ð®]Ê/iÊi«ÊiÌ`\Ê/iVµÕiÃÊ>`Ê ««V>ÌÃ]ÊÓääÓ]Ê«°ÊΣÓÊÜÜܰð̰i`ÕÉ«ÕLÃÉ`i«L®Ê ->V>Ê°]Êi«ÊÃÃiÃÃiÌ\Ê Ý«iÀÌÊ"«]ÊÀiV>ÃÌ}]Ê>`ÊÀÕ«Ê*ÀViÃÃ]Ê,>`ÊVÕiÌ]Ê£Ç{]ÊÊ °Ê,£ÓnÎ*,ÊÜÜÜ°À>`°À}®Ê /ÕÀvvÊ°]Ê/iÊ*VÞÊi«]Ê`>ÃÊ/iÊi«ÊiÌ`\Ê/iVµÕiÃÊ>`Ê««V>ÌÃ]Ê«°ÊnäÈÊ ÜÜܰð̰i`ÕÉ«ÕLÃÉ`i«L® |
