Cours generale sur le marketing strategique
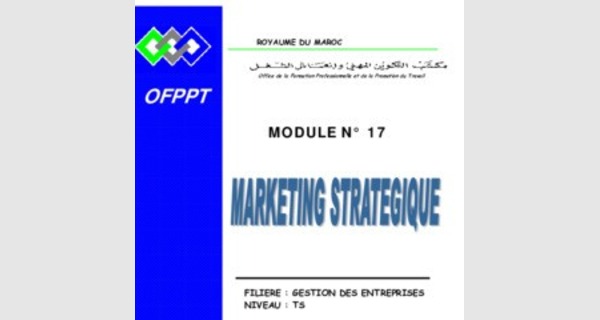
Cours générale sur le marketing stratégique
1 – GENERALITES :
Le marketing propose une démarche logique du développement de l’entreprise fondé sur la satisfaction de sa clientèle. La fonction commerciale constitue une interface informationnelle, stratégique et opérationnelle entre l’entreprise et son environnement. Le marketing propose une démarche logique du développement de l’entreprise fondé sur la satisfaction de sa clientèle. Les moyens d’investigation pour répondre au mieux aux attentes de la clientèle sont :
* L’étude du marché pour révéler ce que font les personnes de la zone étudiée.
* Le sondage d’opinion est l’étude d’une partie d’une population représentative de la population totale.
* L’étude de motivation est une recherche utilisant des techniques tendant à déterminer le pourquoi du comportement d’une population donnée.
2 - DEFINITION DU CONCEPT DE MARKETING :
La définition proposée ci-dessus est axée sur deux aspects fondamentaux du marketing : la cohérence et l’intégration. Cohérence de toutes les actions à mener. Intégration de ces actions dans le fonctionnement de l’entreprise.
1/ Définition : Le marketing est l’art de faire converger les actions de l’entreprise en vue de satisfaire aux mieux les besoins de sa clientèle, dans le cadre de politiques cohérentes visant à optimiser l’efficacité globale de l’entreprise face à son marché.
2/ Commentaires :
- L’art : Le marketing nécessite un élargissement de son champ culturel vers d’autres branches de la gestion ainsi que vers de nouveaux outils.
- Faire converger : Localiser la clientèle susceptible d’acheter le produit fabriquer ou le service rendu par l’entreprise.
- Les actions : Tenant compte du marketing mix qui prend on considération : Produit, Prix, Distribution et Communication. Le marketing mix fera l’objet du fascicule Stratégie et marketing mix de la leçon
3. Satisfaire au mieux les besoins : De combler les attentes de sa clientèle.
Clientèle : le client (individu, entreprise, etc.) est le point d’aboutissement des efforts.
Le client est celui pour qui l’entreprise travaille, qui a un besoin à servir et qui est le bénéficiaire final.
Politiques cohérentes : le marketing implique la mise en place d’un enchaînement d’actions cohérentes les unes par rapport aux autres prévu dans le temps (planification rationnelle et harmonieuse). Ces actions seront menées pour atteindre l’objectif que le chef d’entreprise s’est fixé.
Optimiser l’efficacité globale : la fonction commerciale doit être intégrée dans une approche englobant l’ensemble des autres fonctions de l’entreprise (finances, produits, ressources humaines, logistique).
Face à son marché : l’analyse du marché dans toutes ses composantes est déterminante dans le succès de l’entreprise.
1-Le point de départ est le marché.
2- La connaissance du marché permet de localiser les besoins (clairement définis ou seulement pressentis).
3-Après avoir préciser la nature du besoin constaté ou pressenti, l’entreprise définira le produit capable de satisfaire ce besoin.
4- A partir de critères pertinents, elle segmentera le marché en sous-ensembles homogènes.
5- En fonction de ses objectifs, de son potentiel et des opportunités qui lui sont offertes, l’entreprise choisit les consommateurs auxquels elle va proposer son produit.
6- En fonction du client choisit, elle affinera la définition du produit et choisira son positionnement, c’est à dire la place qu’il occupera sur le marché par rapport à la concurrence.
7-Elle fixera le prix de vente de son produit en tenant compte du comportement du consommateur, du coût du produit, de l’attitude de ses concurrents.
8-Elle choisira le canal de distribution le plus adapté aux consommateurs (la cible) et au produit.
9-Elle organisera sa force de vente en fonction du ou des canaux de distribution choisi(s).
10-Elle fera connaître son produit par des actions de communication (publicité, promotion de lancement, etc.)
11-Elle suivra et développera les ventes de son produit tout au long de la vie de celui-ci par des actions adaptées et cohérentes.
12- Sans cesse, elle étudiera le marché pour déceler de nouveaux besoins et être à même de proposer de nouveaux produits, pour remplacer les produits en perte de vitesse.
…
Avant de mettre en place des actions commerciales et de proposer ses produits ou services aux clients, il est bon de réfléchir au but que l’on veut atteindre avec son entreprise.
Par exemple :
Un maçon veut s’installer et travailler sur sa commune. Il devra prendre en compte le type d’habitation, les revenus moyens, la concurrence, la taille de sa commune, les projets de développements communaux... et toutes les particularités liées à sa commune. Il prendra aussi en compte ce qu’il sait faire, ce qu’il peut faire et ce qu’il veut faire de son entreprise et de son avenir. Alors, il pourra mettre en œuvre les moyens et les actions nécessaires à son projet.
Il suffit qu’un seul des paramètres change pour que les moyens et les actions soient différents (disparition d’un concurrent, nouvelle route qui traverse la commune, événement familial important... etc. )
CHAPITRE : 1 ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT
Séquence n°1 : LE MACRO ENVIRONNEMENT
1 – GENERALITES :
• L’entreprise est soumise à des contraintes et des influences d’origine diverses.
• Ces facteurs de contrainte et d’influence composent l’environnement de l’entreprise et, par extension, celui de son marché.
• L’environnement est à la fois une source de menaces et d’opportunités pour l’entreprise.
2-MICRO ENVIRONNEMENT ET MACRO ENVIRONNEMENT :
• L’environnement de l’entreprise peut se définir comme un ensemble d’éléments externes influençant le comportement de l’entreprise.
• On distingue :
• - Le micro environnement, qui est formé par l’ensemble des agents économiques ayant une influence plus ou moins directe sur l’entreprise (fournisseurs, banques, intermédiaires, administrations, concurrents, clients, médias, etc.)
• Remarque:
• Les clients et les fournisseurs de l’entreprise constituent bien sûr les éléments fondamentaux du micro environnement.
• - Le macro environnement qui représente pour l’entreprise un ensemble de facteurs de contrainte et d’influence beaucoup plus généraux que ceux du micro environnement et souvent impossibles à modifier.
4 - L’ENVIRONNEMENT NATUREL :
• Les problèmes de pollution, de déchets, de pénurie de certaines matières premières sont des éléments dont l’entreprise doit tenir compte :
- Soit parce que la réglementation (environnement institutionnel) les y oblige,
- Soit parce qu’elles veulent donner d’elles une image favorable à une opinion de plus en plus sensibles aux problèmes écologiques (environnement socioculturel)
• D’autre part, l’environnement naturel englobe les aspects climatiques et météorologiques qui exercent une influence sur les modes de vie, les habitudes de consommation, les quantités achetées de certains produits (boissons par exemple), etc.
5 - MENACES ET OPPORTUNITES :
• Pour l’entreprise, l’environnement représente une source de menaces et d’opportunités.
• Les menaces correspondent à des modifications de l’environnement dont les caractéristiques sont les suivantes :
- elles sont éventuelles : la probabilité de leur manifestation est variable selon les cas,
- elles peuvent être passagères ou durables : elles concernent aussi bien des éléments d’ordre conjoncturel que structurel
- elles sont défavorables à l’entreprise, ce qui veut dire que sans réaction adéquate de la part de ses dirigeants, l’entreprise risque de voir sa situation se détériorer.
Exemple : - l’augmentation du prix du pétrole pour les transporteurs routiers.
- la dévaluation d’une monnaie qui renchérie le prix du matériel à l’exportation
- l’arrivé d’un très gros concurrent venu de l’étranger sur son marché.
• Les opportunités représentent des possibilités d’actions offertes par l’environnement à l’entreprise, s’inscrivant dans un développement harmonieux de son activité. L’intérêt d’une opportunité dépend principalement de trois facteurs :
- l’avantage retiré par l’entreprise, défini en termes de rentabilité, de part de marché, de sécurité, de notoriété, etc.
- la probabilité de succès déterminé en fonction de la réaction prévisible de marché et de l’environnement général,
- le savoir-faire de l’entreprise évalué à partir de ses capacités spécifiques par rapport à la concurrence de réaliser avec succès le projet envisagé.
Exemple : Création d’une buvette par une chaîne hôtelière.
Avantages pour l’entreprise : rentabilité.
Probabilité de succès : très forte (concentration de la population estudiantine, proximité de l’université, lieu de rencontre).
Savoir-faire : en adéquation (activité proche de l’hôtellerie).
Séquence n°2 : LE MICRO ENVIRONNEMENT
1 - GENERALITES :
• Le micro environnement correspond à l’ensemble des éléments proches de l’entreprise susceptibles d’influencer son comportement.
• On distingue :
- les composantes situées directement en amont (les ressources) de l’entreprise : elles représentent les individus ou organisations qui procurent à l’entreprise les ressources nécessaires à son activité ;
• Exemples: actionnaires, fournisseurs, etc.,
• - les composantes situées directement en aval (le marché ) de l’entreprise : elles représentent les acteurs intervenant sur le marché
• Exemples : Clients, prescripteurs, etc.
• - les composantes n’appartenant ni aux ressources ni au marché mais qui peuvent avoir une influence plus ou moins directe sur la gestion de l’entreprise.
Exemples : association de consommateurs, médias, etc.
2-RELATION ENTRE MICRO ET MACRO ENVIRONNEMENT :
• Le micro environnement constitue pour l’entreprise le filtre des influences du macro environnement. En d’autres termes, le micro environnement est une sorte de révélateur des modifications du macro-environnement qui concernent effectivement l’entreprise. C’est la raison pour laquelle dans une optique opérationnelle, il faut s’attacher à relier systématiquement les différents facteurs d’évolution du macroenvironnement avec les composantes spécifiques du micro-environnement de l’entreprise étudiée.
Exemples :
• - Une augmentation des taux d’intérêt aura une influence négative sur les décisions d’achat de la clientèle d’un concessionnaire de véhicule automobile.
• - Un décret interdisant l’usage d’un colorant alimentaire donné peut amener une entreprise fabriquant des yaourts à revoir le choix de ses fournisseurs.
…
4 - LES COMPOSANTES AMONT (RESSOURCES) :
1) Les apporteurs de capitaux :
• Cette rubrique décrit l’origine des ressources financières. On y trouve notamment les actionnaires (capitaux propres), les banques, les organismes de financement, les obligataires (capitaux empruntés), les Pouvoirs Publics (subventions, aides, etc.)
• La structure du groupe d’actionnaires établit le rapport de force existant entre possédants et dirigeants. Or, c’est en fonction de celui-ci que se détermineront les buts de l’entreprise (implicitement ou explicitement). Par exemple, si l’actionnariat est concentré, le but poursuivi sera celui des actionnaires, c’est la rentabilité. Dans le cas contraire (actionnariat dilué), le but privilégié sera celui des dirigeants, c’est à dire la croissance.
• Bien évidemment, le développement de l’entreprise est lié aux ressources financières disponibles ou susceptibles de l’être.
2) Les apporteurs de biens :
• Cette rubrique décrit l’origine des biens utilisés par l’entreprise et recouvre les fournisseurs (qui vendent des biens d’investissement, des matières premières, des produits intermédiaires, de produits finis, etc.), les sous-traitants (qui fabriquent des produits en fonction de la demande spécifique de l’entreprise) les bailleurs (qui louent à l’entreprise des biens tels que locaux, véhicules, etc.).
• Le rapport de force existant entre l’entreprise et ses fournisseurs est un critère très important dans l’évaluation des capacités et des contraintes de l’entreprise.
3) Les prestataires de services :
• Cette rubrique décrit l’origine des services utilisés par l’entreprise. Elle comprend des éléments très divers tels que sociétés d’assurance, cabinets-conseils (expertscomptables, conseils en brevet, conseiller juridique, etc.), La Poste, agences de publicité, etc.
4) les apporteurs de travail et de savoir-faire :
• La situation du marché de l’emploi est un élément important du microenvironnement.
Elle doit être étudiée au niveau de la demande d’emploi en termes de qualification offertes, de rémunérations demandées, d’expériences proposées, etc.
• Parallèlement aux salariés qui apportent leur force de travail et leur savoir-faire, les titulaires de brevets peuvent céder à l’entreprise des droits incorporels lui permettant d’utiliser un procédé de fabrication exclusif pour améliorer sa productivité ou réaliser un produit nouveau. (Noter que les marques et les modèles sont du même domaine que les brevets).
5 - LES COMPOSANTES AVAL (MARCHE) :
• Dans toute approche marketing, l’étude du marché aval de l’entreprise est d’une importance fondamentale.
• Le marché aval est composé de l’ensemble des clients de l’entreprise qui sont les acheteurs du produit ou du service proposé par l’entreprise.
• Les distributeurs font parti du marché aval. Ils sont le moyen pour l’entreprise de rentrer en contact avec le client.
• Les prescripteurs enfin font parti du marché aval en tant qu’initiateur de l’achat du produit par le client final.
Exemple : Le médecin prescrit un médicament et le patient achète ce médicament chez le pharmacien.
6 - LES AUTRES COMPOSANTES :
• Les facteurs situés en amont ou en aval de l’entreprise ne sont pas les seuls à prendre en compte. D’autres composantes du micro-environnement sont à étudier.
Celles-ci comprennent principalement les administrations, les groupes d’intérêts, les médias et le grand public.
1) Les administrations :
• Les administrations représentent le lien patent entre le macro-environnement institutionnel et l’entreprise. Celle-ci est soumise à une réglementation incontournable dans des domaines très variés (normes de sécurité, pollution, consommation, prix, publicité, etc.) si bien que de nombreuses décisions de gestion sont dépendantes des choix effectués par les pouvoirs publics.
2) Les groupes d’intérêt :
• Les groupes d’intérêt correspondent à des associations plus ou moins structurées ayant pour but de défendre les intérêts des personnes (physiques ou morales) qu’elles représentent.
• Parmi les groupes d’intérêt qui peuvent jouer un rôle très important au niveau de l’image d’une entreprise, se trouvant en première ligne les associations de consommateurs. Leurs principales actions consistent à diffuser des publications contenant notamment des tests comparatifs de produits et à intenter des actions en justice lorsqu’elles considèrent que les intérêts des consommateurs sont lésés. De plus, actuellement, elles agissent auprès des pouvoirs publics pour que soit élaboré un code de la consommation fondé sur des principes tels que le droit à l’information, le droit à la sécurité, le droit à la loyauté des transactions, le droit d’obtenir librement réparation, etc.
• A coté des associations de consommateurs, il faut citer les associations
d’utilisateurs (spécifiques à un service ou à un produit) et les groupes de pressions
(«lobbies »).
Exemple:

- Union Fédérale des Consommateurs
- Association des Utilisateurs du Téléphone et des Télécommunications
- Ligue antialcoolique
3) Les médias :
Les médias représentent l’ensemble des vecteurs susceptibles de transmettre des informations ou des opinions. La presse, la télévision en sont deux exemples. Cette forme de communication présente la caractéristique d’être gratuite, ce qui est un avantage si l’information véhiculée est globalement favorable à l’entreprise. Par contre, ces canaux peuvent s’avérer très pénalisants si pour une raison ou pour une autre ils constituent à l’insu de l’entreprise une image négative de ses produits.
4) Le grand public :
Le grand public correspond à un ensemble vague et non structuré d’individus supposés avoir globalement des attitudes ou des opinions plus ou moins homogènes vis-à-vis des entreprises, des produits et des services et d’une manière générale vis-à-vis des évolutions du macro environnement.
Exemple : «Le grand public n’est pas encore mûr pour le vidéodisque» (citation d’article de presse).
SOMMAIRE :
Généralités : le marketing : définition et démarche
Partie I : le diagnostic marketing
Chapitre 1 : analyse de l’environnement
Séquence n°1: le macro environnement
Généralité
Micro environnement et macro environnement
Présentation synthétique du macro environnement de
l’entreprise
L’environnement naturel
Menaces et opportunités
Séquence n°2: le micro environnement
Généralités
Relation entre micro et macro environnement
Représentation schématique du micro environnement
Les composantes amont (ressources)
*les apporteurs de capitaux
*les apporteurs de biens
*les prestataires de services
*les apporteurs de travail et de savoir-faire
Les composantes aval (marché)
Les autres composantes
*les administrateurs
*les groupes d’intérêt
*les medias
*le grand public
Chapitre n°3 : analyse du marché
Séquence n° 1 : approche d’un marché par l’offre
Typologie des marchés
Séquence n°2 : approche du marché par la demande
Typologie des clients
Typologie d’agent d’influence
Classification des besoins
Séquence n°3 : les motivations
Séquence n°4 : le comportement du consommateurs
Les variables explicatifs du comportement d’achat
• La décision d’achat
• Les participants à la décision
• Les différentes situations d’achat possible
• Les étapes du processus de la décision d’achat
Chapitre n°4 : la politique de produit
Définition d’un produit
Classification du produit
L’identification du produit
L’action sur le produit
Chapitre n°5 : l’analyse concurrentielle
L’analyse classique
*l’école de Havard (LCAG)
L’analyse industrielle
*la première analyse de Michael PORTER
*les apporteurs récents de PORTER
*les analyses des comportements stratégiques fondés
sur l’étude de la technologie
L’analyse d’Arthur D. Little (ADL)
L’analyse de SRI (Stanford research institute)
L’analyse de PORTER
* Technologie ET avantage concurrentiel
* les conditions de l’action de progression technologie
Sur l’avantage concurrentiel
* l’action du progrès technologique sur les 5 forces de la concurrence
* la stratégie technologique de PORTER
L’analyse de FOSTER ; la prise en compte de l’évolution technologique
L’analyse de processus et des procédés (Michael MARCHENSAY)
Chapitre n °6 : la politique de distribution
Les fonctions de la distribution
Stratégies de distribution du producteur
Stratégie de distribution et du distributeur
Evolution de la fonction de distribution
Partie II : le plan stratégie marketing
Chapitre N° 1 : les modèles d’analyse stratégique
La matrice du boston consulting group (matrice BCG)
La matrice de Mac Kinsey
La matrice Arthur Doo Little (matrice ADL)
Chapitre N° 2 : les grands choix stratégiques
Les stratégies infra secteur
* stratégie de domination par les coûts
* stratégie de différentiation
* stratégie de créneau de focalisation de l’activité (de
Concentration ou de niche)
* stratégie de dégagement, de recentrage, de retrait
Les stratégies inter secteur
* l’intégration verticale
* la stratégie de filière
* les stratégies de diversification
Les stratégies interentreprises (DECF)
* les stratégies d’impartition (de coopération, de partenariat)
* les stratégies de croissance externe
Les stratégies d’internationalisation
*les étapes de l’internationalisation
* Avantages et risques
Chapitre N°3 :la planification
Nature et évolution de la planification
*nature de la planification
* évolution de la planification
Le processus de la planification
* fixation de l’écart stratégique (ou ‘’gap’’ stratégique)
* les objectifs généraux, fondamentaux
* la fixation des objectifs
*qualités des objectifs stratégiques
La méthode des scénarios
* processus de construction des scénarios sectoriels
* place des scénarios
Le contrôle
* l’objet du contrôle
*la mise en œuvre du contrôle
* les techniques de contrôle
Bibliographie
