Cours d’analyse et management strategique
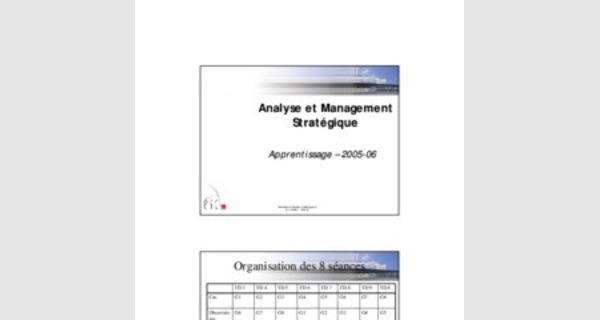
Cours d’analyse et management stratégique
Pourquoi un cours de stratégie?
- Parce que vous devez être entraînés à une discipline qui se situe enamont dans l’entreprise.
– Que vous devrez comprendre dès votre entrée dans vos futures fonctions pourquoi les décisions de terrain sont prises (c’est la lecture stratégique du management opérationnel)
– Que vous aurez, à terme, à peut-être prendre des décisions stratégiques (c’est le management stratégique)
Parce qu’il donne l’éclairage systémique du pilotage de l ’entreprise, mettant en lumière la combinaison des disciplines nécessaires à celui-ci. Il justifie ainsi les disciplines nombreuses enseignées dans l ’Ecole (Marketing, Finance, Economie, Systèmes d’information, Négociation, Projets, etc… )
Introduction générale à la stratégie d’entreprise
- 1. Les deux dimensions du management
- 2. Les deux perspectives de l’analyse stratégique
- 3. Vers une définition du management stratégique
Les deux niveaux du management
- Premier niveau : le management opérationnel
– Définition : Le management opérationnel consiste à prendre des décisions nécessaires pour le fonctionnement quotidien de
l ’entreprise
– Exemple : décisions de tarification des produits et services, choix d ’un argument publicitaire
- Les deux niveaux du management (2)
- Deuxième niveau : le management stratégique
– Définition : Le management stratégique consiste à prendre des décisions vitales pour l’avenir de l’entreprise
– Exemple : décisions de lancement d’une nouvelle ligne de fabrication, décision d’une opération de fusion
…

- Vers une définition du management
stratégique
- Définition d ’Andrews : « La stratégie générale est la combinaison de décisions dans une compagnie
– qui détermine et révèle ses objectifs et ses buts
– qui produit la politique générale et les plans destinés à les atteindre
– qui définit l’étendue des activités que l’entreprise poursuit, le type d’organisation qu’elle a l’intention d ’être et la nature des contributions, économiques ou non, qu’elle tente d’apporter à ses actionnaires, employés, clients et autres communautés d ’intérêt »
Définition du Strategor : élaborer la stratégie de l’entreprise, c’est choisir les domaines d’activités dans lesquels l’entreprise entend être présente et allouer des ressources de façon à ce qu’elle s’y maintienne et s’y développe. Cette définition identifie deux niveaux de la stratégie : la stratégie de groupe et la stratégie concurrentielle
La stratégie de groupe (ou corporate strategy) détermine les domaines d’activités de l’entreprise. C’est cette stratégie de groupe qui conduit l’entreprise à s’engager dans tel ou tel secteur ou à se retirer de tel autre afin de se constituer un portefeuille d’activités équilibré.
La stratégie concurrentielle (ou business strategy) est mise en œ uvre dans chacun des domaines d’activité. Cette stratégie concurrentielle définit les manœ uvres que l’entreprise doit accomplir afin de se positionner favorablement face à ses concurrents dans un secteur donné.
- Définition de Kalika et Orsoni : « Le management stratégique est l’ensemble des tâches relevant de la direction générale, qui ont pour objectifs de fixer à l’entreprise les voies de son développement futur tout en lui donnant les moyens organisationnels d’y parvenir »
- On peut décomposer le management stratégique en quatre éléments clés :
– Vision stratégique
– Décision stratégique
– Animation stratégique
– Organisation stratégique
- La stratégie peut également être définie comme:
– « L’art de diriger un ensemble de dispositifs pouratteindre un objectif. » (M.A. Morsain)
– « L’ensemble des décisions et actions relatives auchoix des moyens et à l’articulation des ressources en vue d’atteindre un but. » (R.A. Thiétart)

– Plus simplement, c’est savoir ou l’on va, pourquoion y va, et allouer les ressources en respect de ces objectifs.
Conclusion (1)
- L’analyse stratégique est réalisée par le ou les dirigeants, assistés éventuellement de collaborateurs ou amis connaissant l’entreprise, voire de consultants.
- On ne fait pas d’analyse stratégique tous les jours, semaines ou mois, il y a un temps pour la stratégie et un temps pour l’action.
- Le tempo variera en fonction de deux variables
– Le tempo technologique (renouvellement desinvestissements)
– Le tempo de la concurrence (évolution liée aumarché)
- La démarche stratégique, menée par l’équipe de dirigeants, consiste à répondre en continu à une série de questions :
- Qui sommes-nous ?
- Où voulons-nous aller ?
- Pourrons-nous y aller ?
- Comment y aller ?
…
Comprendre les enjeux
- On distinguera deux grands découpages de l’entreprise
– La segmentation stratégique
- Macro-segmentation par l’identification du ou des métiers
- Meso-segmentation par l’identification des segments stratégiques
– La segmentation opérationnelle
- Micro-segmentation par les segments marketing
Notion de métier

- Cette notion vient en amont de la notion de segmentation stratégique
- C’est une macro-segmentation qui permet d’éclairer le champ d’action actuel et futur de l’entreprise.
- En énonçant son métier on s’ouvre des opportunités mais aussi on s’interdit certains choix
On appelle
métier stratégique de l'entreprise
l'offre fondée sur des
compétences ou des savoir-faire
en vue de répondre aux
besoins actuels ou futurs de ses clients.
•Un métier est un ensemble cohérent d’activités actuelles et à venir sur lequel l’entreprise décide prioritairement d’allouer des ressources
•Une entreprise possède un métier si elle combine et adapte ses savoir-faire avec le maximum d’efficacité et de synergie
•Il est important que les gens de l’extérieur et de l’intérieur s’y reconnaissent !
Exemples
PME, fabricant de savons industriels
- Fabricant de savon X ?
- Fabricant de savons, crèmes et détergents ?
- Hygiène et propreté ?
PME, fabricant de chaussures de sécurité
- Fabricant de chaussures solides ?
- Fournisseurs de produits et service garantissant la sécurité des personnes et des biens ?
Notion de métier (suite)

- Quel est le métier de BIC ?
- Quel est le métier de BONDUELLE ?
- Quel est le métier d’une Ecole supérieure de commerce ?
- Quel est le métier de la SNCF ?
…
Segmentation stratégique
QU'EST-CE-QUE C'EST ?
C'est le découpage de l'entreprise en domaines d'activité stratégique (segments) différents, homogènes.
…
Segmentation stratégique
- On appelle Segment Stratégique un ensemble de 1 à n lignes deproduits partageant les mêmes ressources pour affronter les
mêmes concurrents dans un même environnement. (Stratégie
concurrentielle, G. Garibaldi)
- C’est un domaine d ’activité caractérisé par une combinaisonunique de facteurs clés de succès, faisant appel à des savoirs faire particuliers sur lesquels l’entreprise peut accumuler de l ’expérience, borné par des frontières géographiques pertinentes. (STRATEGOR)
- Identifier les segments stratégiques c’est pouvoir déceler des potentialités de développement sur un segment émergent.
Critères de découpage
- Types de besoins
- Produits
- Clientèles
- Zones géographiques
- Technologies
- Canaux de distribution
? Le croisement de ces paramètres doit permettre de déceler des segments stratégiques
• Application à votre activité
…
L’intérêt de l’outil

- Identifier les cinq forces compétitives fondamentales qui vont déterminer l’attractivité relative d’un secteur industriel
- Cerner les interactions entre ces forces et leurs dynamiques, ce qui permet aux entreprises de prendre des décisions stratégiques en connaissance des positions les mieux défendables et les plus rentables.
…
Nouveaux entrants
- Existe-t-il des barrières à l’entrée importantes pour de nouveaux concurrents potentiels ?
– Economies d’échelle importantes ?
– Existe-t-il des marques bien installées ayant su créer de la loyauté ?
– Est-il nécessaire de prendre des risques financiers importants ?
– Le remplacement d’un produit par un autre est-il coûteux ?
– L’accès aux canaux de distribution est-il difficile et réglementé ?
– Est-ce que les entreprises existantes disposent d’avantages de coûts indépendants (brevets, licences, savoir-faire, accès favorisés aux matières premières… ) ?
– Le secteur est-il réglementé et nécessite l’acquisition de licences (UMTS) ?
– Faibles réactions attendues des acteurs existants
– Rentabilité ?
Produits de substitution
- Est-il facile de substituer un produit ou un service par un autre produit ou service ?
– Pour Porter, un produit de substitution est particulièrement dangereux s’il représente une amélioration significative du rapport prix/performance.

Pouvoir de négociation des acheteurs
- Dans quelle mesure est-ce que les clients peuvent négocier ?
– Volume des achats
– Proportion des prix d’achat dans la masse des coûts
– Niveau de différenciation des produits
– Coût d’un changement de produit
– Marge des acheteurs
– Potentiels de production en interne (intégration de la filière)
– Impact du produit sur la performance du client
– Quantité d’informations dont dispose le client
Pouvoir de négociation des fournisseurs
- Dans quelle mesure est-ce que les fournisseurs peuvent négocier ?
– Nombre de fournisseurs existants
– Absence de produits de substitution
– Niveau de différenciation des produits

– Nombre de clients alternatifs
– Caractère indispensable ou de forte valeur du produit
– Coût d’un changement de fournisseur
– Capacité d’intégration des compétences du client pour produire et vendre pour les clients de son client
Concurrents existants
- Quels sont les indicateurs de menaces venant des concurrents existants ?
– Nombre et compétitivité des concurrents
– Faible taux de croissance du secteur
– Importance des coûts fixes faisant porter la concurrence sur les taux de stockage et de remplissage
– Faible coût d’un changement de produit, caractère de commodité du produit pour le client
– Diversité des concurrents et de leurs stratégies
– Importance des enjeux représentés par un client
– Barrière à la sortie élevée, pour des raisons économique, stratégique, émotionnelle ou légale
Conclusion

- Modèle le plus reconnu et le plus largement utilisé pour l’analyse stratégique
- Tend à souligner les forces externes et la manière de les contrer. Les forces intrinsèques de l’entreprise et sa capacité à développer ses compétences de manière indépendante ne sont pas abordées.
Le modèle est plus réactif que proactif, et doit être utilisé avec une approche interne-externe.
Chaîne de valeur externe
Intérêt de l’outil
- La chaîne de valeur interne ne peut être isolée de son contexte
- Elle est reliée en amont à l’aval de la chaîne de valeur de ses fournisseurs et en aval à l’amont de la chaîne de valeur de ses distributeurs
- La construction d’un avantage concurrentiel peut s’appuyer sur une coordination plus efficace avec les partenaires.
Utilisation de l’outil
- Situer la firme dans sa filière
- Détailler l’ensemble des opérations qui permettent de transformer une matière première en produit fini, détruit par le consommateur final
- Chercher l’architecture de la filière qui permet la meilleure compétitivité :
– quels stades de la transformation apportent le plus de valeur ajoutée au consommateur final (contrôle)
– Quel niveau de maîtrise de la filière
– Quelle coordination entre les maillons (prise de contrôle, accords spécifiques)
Chaîne de valeur externe ou Filière
- Cette démarche consiste à identifier les étapes successives dans une filière pour que l’entreprise puisse prendre des décisions d’intégration amont, aval ou de se recentrer sur un maillon de la filière
- Ex: IKEA qui a fait prendre en charge par ses clients le maillon montage, et logistique aval.
…
Intérêt de l’outil
- Approfondir les 5 forces de Porter
- Etudier la logique de la concurrence interne que se livrent les entreprises d’un même domaine.
- Faire apparaître des structures internes au secteur, fondées sur des regroupements d’entreprises aux caractéristiques similaires et stables dans le temps.
Critères possibles (Strategor)
- Degré de spécialisation
- Image de marque
- Politique de prix
- Mode de distribution
- Etendue des services annexes proposés
- Qualité perçue du produit
- Type de politique commerciale
- Degré d’intégration verticale
- Maîtrise technologique
- Position en termes de coûts
- Relations avec la société mère
- Relations avec les pouvoirs publiques
…
Groupe stratégique

- Un groupe stratégique est constitué par les entreprises qui ont fait des choix similaires sur les principaux critères.
?Les groupes stratégiques permettent de dresserune topographie de la concurrence d’un même secteur
?A condition de conserver les mêmes critères, ilspermettent de représenter l’évolution dans le temps de la structure concurrentielle
Utilisation de l’outil
- Peut se faire de manière générique ou par DAS
- S’appuit sur une identification préalable des Facteurs Clefs de Succès (FCS)
- Débouche sur l’analyse de la rivalité concurrentielle à partir de trois types de concurrence :
– Barrières à l’entrée et à la sortie (par groupe stratégique)
– Lutte concurrentielle inter-groupes (nombre et taille des groupes, degré d’interdépendance, distance stratégique)
– Lutte concurrentielle intra-groupe (comportement défensif, offensif ou proactif)
Facteurs clés de succès FCS
- Les facteur clés de succès: Il s’agit des compétences, des ressources, des atouts qu’une entreprise doit nécessairement détenir pourréussir dans une activité donnée. Le facteur cléde succès est donc lié au secteur, c’est une qualité dont l’entreprise dispose ou non.
Un groupe stratégique est constitué par les entreprises ayant les mêmes FCS
…
Le contexte de l’entreprise
- L ’entreprise évolue dans un contexte ou agissent des acteurs qui ont une interaction avec celle-ci : « Ecosystème entreprisecontexte »
- Qui sont les acteurs de l’environnement proche de l’entreprise : « Stakeholders »
- Quelles interactions ?
L’intérêt de l’outil
- Un avantage compétitif ne peut se comprendre qu’en envisageant l’entreprise dans son ensemble.
Décomposer les activités d’une entreprise permet de déterminer la performance relative, et ainsi de déterminer les sources d’avantages compétitifs.
…

Activités primaires
- Activités directement engagées dans le flux du produit vers le client et englobent :
– La logistique interne (réception, entreposage, enregistrement des inputs du produits… )
– Les opérations (transformation, emballage, maintenance des équipements, tests, management opérationnel)
– La logistique externe (traitement des commandes, entreposage, livraison, management de la distribution… )
– Le marketing et la vente (publicité, promotion, vente, fixation des prix, sélection des canaux de distribution… )
– Le service (installation, formation, réparation, mise à jour… )
Activités de soutien
- Elles renforcent les activités primaires :
– Les achats (achat des matières premières, approvisionnement, négociation des contrats fournisseurs… )
– Le développement technologique (R&D, améliorations de produits et/ou de processus, (re)conception, développement de nouveaux services… )
– La gestion des ressources humaines (recrutement, formation, système de compensation… )
– L’infrastructure (direction générale, procédures de planification, finance, comptabilité, management de la qualité.
La marge
- Indique que les marges bénéficiaires réalisées dépendent de la gestion de la chaîne de valeur.
Conclusion

- Introduite en 1985, la chaîne de valeur est toujours utilisée afin de dégager les forces et faiblesses d’une entreprise
Elle est aussi très utile dans le cadre d’alliances stratégiques pour déterminer les complémentarités possibles (force de vente compétente d’un côté, puissance logistique de l’autre… )
…
L’intérêt de l’outil
- S’inscrit dans une « planification de portefeuille » qui a pour but de répartir les capitaux entre les différents pôles d’activité d’une entreprise diversifiée
- Afin d’assurer un succès à long terme, une entreprise doit avoir un portefeuille de produits dotés de taux de croissance et de parts de marché différents.
- La matrice BCG aide à déterminer les priorités d’investissement.
Utilisation
- Pour chacun des produits ou services du portefeuille, déterminer le taux de croissance du marché attendu.
- Déterminer la part de marché relative de ces produits ou services
- Positionner les produits sur les deux dimensions de manière arbitraire mais importante entre faible et relativement élevé
- Des critères prédéterminés peuvent aider
Prédéterminer des critères
- Une part de marché sera considérée comme faible quand elle correspond à moins de 1/3 de celle de notre plus grand concurrent
Un taux de croissance de marché est considéré comme élevé quand les revenus augmentent de plus de 10% après correction de l’inflation.
…
Conclusion
- Une « vedette » peut avoir fait son temps…
- Un « poids mort » peut se révéler source insoupçonnée de vitalité
- Une « vache à lait » peut donner des « veaux », à condition d’investir dans une saillie de temps en temps…
- Les parts de marché ne sont pas forcément de bons indicateurs de génération de liquidités,
- Un taux de croissance élevé ne garantit pas qu’en injectant de l’argent on récupérera davantage plus tard,
- Investir dans un produit ne le rend pas forcément plus rentable
- Comme les marchés ne sont pas toujours clairement définis, il est conseillé d’utiliser des parts de marché relatives
- Sur des marchés immatures, les taux de croissance comme les parts de marché ne justifient pas toujours les stratégies suggérées par la matrice BCG.
…
La méthode ADL
- Les éléments de base :
– Pour apprécier la position compétitive de l'entreprise sur un DAS donné, la méthode ADL (1980) mesure l'ensemble des atouts qualitatifs et quantitatifs, qu'elle possède par rapport à ses concurrents.
– L'ensemble des facteurs pris en compte fait l'objet d'une notation comparée entre le DAS considéré et les concurrents puis, en tenant
compte d'une pondération, une évaluation globale conduit à classer les DAS de l'entreprise sur une échelle à 5 positions distinctes

- Apports et difficultés de la méthode ADL :
– Par rapport à la démarche du BCG, la méthode ADL est supérieure sur au moins 2 points fondamentaux :
– son champ d'application est plus général : les facteurs d'analyse sont à la fois qualitatifs et quantitatifs
– ce qui implique un effort d'analyse et de recherche des éléments décisifs de la position stratégique et de la concurrence
– En revanche ces avantages se paient au prix des difficultés à la fois
techniques et psychologiques des analyses multidimensionnelles (comme pour la méthode Mc Kinsey)
…
Prescriptions stratégiques
1. Développement naturel : suppose l’engagement de toutes les ressources nécessaires pour suivre le développement correspondant aux activités pour lesquelles l’entreprise a une bonne position concurrentielle, mais aussi la totalité des segments d’avenir ;
2. Développement sélectif : atteindre une meilleure position et donc une meilleure rentabilité pour les activités à position concurrentielle moyenne voire faible
3. Abandon : préférable pour les activités de peu de rendement où la position concurrentielle de l’entreprise est faible
…
La méthode Mc Kinsey
- Les éléments de base :
– Troisième méthode classique d'analyse de portefeuille, elle est née de la collaboration entre la société Mc Kinsey et la firme General Electric qui reprochait à l'approche BCG son simplisme dans l'évaluation des positions concurrentielles.

– La méthode Mc Kinsey propose le positionnement des DAS sur une grille à 9 cases (voir schéma ci-dessous ).
– Son établissement requiert le repérage :
– des facteurs externes qui déterminent l'attrait du secteur auquel appartient une activité donnée;
– celui des FCS dont le degré de maîtrise fonde la force concurrentielle de l'entreprise.
– Chacune de ces dimensions étant appréciée sur une échelle à 3
positions.
Plan de l’exposé
- Introduction générale à la stratégie d’entreprise
- Notion de Métier
- La segmentation stratégique : base de l’analyse stratégique
- Analyse de l ’environnement
- Analyse des Ressources disponibles et mobilisables
- Outils d’analyse du portefeuille d’activités stratégiques
- La décision stratégique
- Mise en œ uvre, le management stratégique
Méthode d’analyse stratégique appliquée au cas
