Cours complet sur le financement de projet
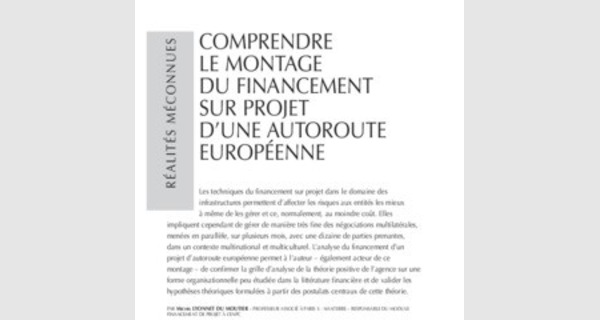
Cours complet sur le financement de projet
Les techniques du financement sur projet dans le domaine des infrastructures permettent d’affecter les risques aux entités les mieux à même de les gérer et ce, normalement, au moindre coût. Elles impliquent cependant de gérer de manière très fine des négociations multilatérales, menées en parallèle, sur plusieurs mois, avec une dizaine de parties prenantes, dans un contexte multinational et multiculturel. L’analyse du financement d’un projet d’autoroute européenne permet à l’auteur – également acteur de ce montage – de confirmer la grille d’analyse de la théorie positive de l’agence sur une forme organisationnelle peu étudiée dans la littérature financière et de valider les hypothèses théoriques formulées à partir des postulats centraux de cette théorie.
PAR MICHELLYONNET DU MOUTIER – PROFESSEUR ASSOCIÉ À PARIS X NANTERRE – RESPONSABLE DU MODULE
FINANCEMENT DE PROJET À L’ENPC
Le financement sur projet (1) est en pleine expansion. Le montant des crédits syndiqués et des obligations levées sur les marchés financiers pour ce genre de montage a été multiplié par huit au cours des sept dernières années. Il est ainsi passé de 17,7 milliards de dollars US en 1994 à 133,5 milliards de dollars US en 2001 (2).
Il est surprenant que peu d’ouvrages ou d’articles de fond soient consacrés à cette technique. L’une des raisons est la grande confidentialité qui entoure ce genre d’opération, en particulier dans le domaine des grandes infrastructures à péage. Peu de données sont publiées et quand elles le sont, elles ne sont pas nécessairement complètes. Seule une vision d’« insider » au sein du projet permet d’appréhender la finesse de montages contractuels et financiers rendus complexes par la multiplicité des intervenants, les environnements locaux changeants et les enjeux politiques et économiques inhérents à ces projets.
Dans cet article, après avoir défini ce qu’est le financement sur projet et esquissé une typologie, nous étudierons un cas concret pour comprendre comment se déroule la négociation de ce genre de montage et comment elle est gérée. Cette analyse découle d’une recherche menée pendant trois années sur le terrain, complétée par la mise au point d’une grille de lecture théorique.
DÉFINITION DU FINANCEMENT SUR PROJET
La définition du financement sur projet est difficile à cerner. Cette expression s’applique à une gamme extrêmement étendue de projets en fonction de la nature des cash flows générés par ceuxci et de la structure contractuelle retenue. Ce type de montage porte sur des projets privés à la fois dans le d o m a i n e i n d u s t r i e l (usines de cog é n é r a t i o n électrique,…) et dans celui des ressources naturelles.
Il peut également s’inscrire dans le cadre d’un partenariat publicprivé comme pour les concessions de travaux et de services publics portant sur de grandes infrastructures. Il regroupe des montages financiers très variés, même s’ils gravitent autour de quelques principes généraux (financement remboursé par les seuls cash flows du projet, recours limité envers les actionnaires de la société concessionnaire, etc.). Il se situe à la convergence de deux modèles culturels différents : le modèle français et le modèle angloaméricain. Audelà du montage financier, le financement sur projet est également une forme particulière de « gouvernance ». Cette complexité fait que, dans la maigre littérature consacrée à ce sujet, le financement sur projet est plutôt défini par ce qu’il n’est pas que par ce qu’il est. Nous explorerons en premier lieu la typologie des projets montés dans le cadre du financement sur projet, puis les deux modèles dominants.
Le financement sur projet est une technique moderne et sophistiquée issue d’un mode très ancien de financement. Un des plus anciens exemples de ce montage (3) concerne un prêt fait par les banquiers italiens Frescobaldi à la Couronne anglaise au XVIIe siècle, remboursé à ceuxci par l’exploitation, à leurs risques et périls, pendant deux années des mines d’argent du Devon. Des exemples encore plus anciens peuvent être trouvés en France avec la concession des canaux (4). Les grandes expéditions maritimes, comme la découverte des Amériques, ont été financées de la sorte au moyen de capitaux privés. À la fin du XIXe siècle, on trouve des exemples comme la Tour Eiffel dont le financement est assuré grâce aux recettes du monument pendant vingt ans.
Depuis les années 1970, ce type de technique est utilisé pour le financement d’usines de cogénération électrique dont le montage est relativement simple 1980, avec le financement des grands champs pétroliers. Dans les années 1990, les bailleurs de fonds et autres investisseurs s’intéressent aux grandes infrastructures.
C’est dans ce cadre notamment que se développe un type particulier de financement sur projet : le BOT (Build, Operate, Transfer : Construire, Exploiter et Transférer). Dans ce montage, une collectivité publique concède à un opérateur privé le droit de réaliser une infrastructure, de la financer, d’exploiter le service public (ou d’intérêt général) dont elle est le support, de rembourser les financements par les recettes de cette exploitation et, enfin, de rendre l’infrastructure à la collectivité. Ce type de partenariat publicprivé est possible car, contrairement aux opérations industrielles guettées par l’obsolescence ou au domaine des ressources naturelles limitées dans le temps par l’épuisement du gisement, les opérations d’infrastructure ont une durée de vie longue et peuvent générer des cash flows pendant des périodes beaucoup plus étendues que l’amortissement de l’ouvrage. Le modèle français est très ancré sur la notion de service public à laquelle les Français sont attachés (6).
D’après Bezançon [1997], ce phénomène provient de l’Ancien Régime, époque où « tout est délégation ». Les rois disposant de moyens financiers limités, se concentraient sur leurs prérogatives dites régaliennes et déléguaient les autres services publics. Parmi les nombreuses activités confiées au secteur privé, certaines sont directement issues de ce passé : les services de proximité (distribution de l’eau, ramassage des ordures, etc.), confiés aux collectivités locales, et les services liés aux grandes infrastructures. Le Roi confiait la réalisation de grands ouvrages, comme les canaux, à des promoteurs privés (par exemple, Riquet pour le canal du Midi) auxquels il conférait des privilèges exorbitants pour protéger leurs idées. En contrepartie de ce monopole, les promoteurs réalisaient l’opération à leurs entiers risques et périls.
La centralisation rencontrée dans le modèle français garde encore des traces de cette relation particulière entre un roi puissant et un délégataire qui est son obligé. Une autre spécificité du modèle français, devenue au fil du temps un obstacle à son développement, est l’obligation assez générale d’un paiement du service par l’utilisateur final.
Actuellement, en France, on distingue en pratique deux types de concession : la concession pure dans laquelle le concessionnaire est chargé de la réalisation et de l’exploitation (par exemple, les autoroutes) et l’affermage, dans lequel la collectivité investit dans l’équipement, l’exploitation étant exécutée aux risques et périls du fermier (7). Les montages qui s’insèrent dans le cadre du modèle angloaméricain sont beaucoup plus nombreux. Ils reposent sur un système plus décentralisé. Ainsi, au RoyaumeUni, le gouvernement délègue certains de ses pouvoirs réglementaires à des « agences », sortes de clubs formés par les représentants des différents intervenants dans le projet (concessionnaires, utilisateurs, etc.)(8). Le développement du financement sur projet a été accéléré grâce au lancement de la Project Finance Initiative (PFI) par le Chancelier de l’Échiquier Norman Blamont, en 1992. Ce montage est en passe de devenir la référence sur le plan européen.
Au départ, la PFI est un programme de gouvernement. Il s’agit pour les Britanniques, d’une part, de dégager des moyens de financement et, d’autre part, d’améliorer la rentabilité des fonds investis par le secteur public. Ils veulent ainsi réduire le coût pour la collectivité par rapport aux modes habituels d’attribution des marchés de travaux publics et créer ce qu’ils appellent de la Value for Money, concept clé de la PFI.La PFI a été appliquée dans de nombreux domaines au RoyaumeUni et, en particulier, au secteur des infrastructures (9). Le principe le plus souvent retenu est celui du « péage fictif » (shadow toll, traduit également par « péage virtuel »). Dans ce montage, la collectivité publique signe avec la société concessionnaire un contrat de DBFO (Design, Build, Finance andOperate : Concevoir, Réaliser, Financer etExploiter) qui est une forme de BOT par laquelle le concessionnaire est responsable de la conceptionconstruction de l’autoroute et de son financement. Lors de l’exploitation, le péage est payé, non par les conducteurs mais par l’État, essentiellement sur la base de la fréquentation de l’autoroute mais aussi sur des critères qualitatifs (faible immobilisation de l’autoroute pour l’entretien, réduction du nombre d’accidents, etc.).
Dans ce cadre, le projet n’est pas inscrit dans le portefeuille des entreprises, mais détaché dans une entité ad hoc, la société concessionnaire ou société de projet. Le principe est que les risques transférés par le concédant à la société concessionnaire sont répartis entre les participants les mieux à même de les gérer. Les financements, qui peuvent atteindre 80 à 90 % du montant de l’opération, sont comptabilisés dans cette entité. Malgré la faiblesse des fonds propres par rapport aux risques encourus, le recours des bailleurs de fonds envers les actionnaires (10) de la société concessionnaire est limité. Le risque de construction est entièrement transféré au groupement conjoint et solidaire des constructeurs et celui de l’exploitation à l’exploitant, s’il existe. Les bailleurs de fonds et, de manière plus limitée, les actionnaires de la société concessionnaire, supportent in fine les risques résiduels, à savoir essentiellement le risque de trafic.
Ce risque est limité dans le cas d’une opération en shadow toll. En effet, dans le cas du « péage direct », leniveau du péage demandé à l’utilisateur a un effet dissuasif sur les conducteurs. Si celuici est trop élevé, les conducteurs peuvent décider de circuler sur le réseau national gratuit ou de choisir un mode de transport concurrent (bus, train, etc.). Dans le cas du péage virtuel, l’accès à l’infrastructure est gratuit pour tous (11). La société concessionnaire prend donc uniquement le risque d’atteindre le nombre de véhicules prévu dans le plan d’affaires et pas celui de l’élasticité du prix par rapport à la demande.
Le financement sur projet nécessite un montage juridique extrêmement complexe. Dans la PFI, la documentation est rédigée selon les principes du droit anglais. La promotion entreprise par les autorités britanniques et le grand succès rencontré dans son application ont poussé à une exportation de ce modèle dans de nombreux pays et notamment en Europe.
Nous exposerons maintenant l’exemple d’une autoroute en Europe dont le montage est issu de la PFI. Pour des raisons de confidentialité, nous ne mentionnons ni le nom réel du projet, ni le payshôte. Le projet a été baptisé PAF (Péage Autoroutier Fictif) et le pays d’accueil « Constélia » (12).
UNE MÉTHODOLOGIE NÉCESSAIREMENT
PROCHE DES SCIENCES SOCIALES
Le cas présenté cidessous a fait l’objet d’une étude clinique qui s’est étalée sur trois années. L’étude avait pour but de tester un certain nombre de propositions dans le cadre de la théorie positive de l’agence. La recherche clinique a consisté à suivre le petit groupe de négociateurs (une vingtaine) d’un des consortiums ayant participé à l’appel d’offres et à comprendre comment se sont nouées les relations contractuelles et financières du projet (13).
L’objet du présent article n’est pas d’exposer le modèle théorique mais d’utiliser la grille d’analyse qui en découle pour comprendre les mécanismes sousjacents à l’exemple présenté.
- Physiquement, il n’y a d’ailleurs pas de barrière de péage sur l’autoroute, mais uniquement des boucles magnétiques de comptage. Ce choix réduit en outre très sensiblement les frais d’exploitation de l’autoroute constitués en grande partie par les salaires des agents de péage.
- Nous avons également changé le nom des entités participantes et de leurs représentants. Les caractéristiques du projet ont aussi été modifiées.
- Ce groupe comprenait des représentants des constructeurs, de l’exploitant, de l’investisseur, des banques commerciales et de leurs conseillers. Il était chargé de négocier les documents contractuels permettant la répartition des risques entre les intervenants, découlant du contrat de concession entre le concédant et la société concessionnaire.
LA THÉORIE POSITIVE DE L’AGENCE
La théorie positive de l’agence découle notamment de l’article séminal de Jensen et Meckling [1976] et sa méthodologie d’un papier de Jensen [1983]. Cette théorie analyse la relation entre un mandant et un mandataire. On peut, par exemple, considérer que les actionnaires d’une société délèguent à des dirigeants professionnels la gestion de l’entreprise. Or, le dirigeant salarié n’a pas nécessairement des intérêts identiques à ceux des actionnaires. Pour limiter ce conflit potentiel d’intérêts, les actionnaires mettent en place un contrôle du dirigeant (commissaires aux comptes, auditeurs, etc.). Les dirigeants euxmêmes peuvent souhaiter donner des gages de bonne volonté aux actionnaires, par exemple en versant un dividende supérieur à celui que requerrait la gestion normale de la société. Il en résulte des coûts, dits « coûts d’agence ».
La théorie positive de l’agence compare les diverses formes de sociétés (ou de formes organisationnelles) et montre que celles qui survivent sont les plus efficientes en ce sens qu’elles engendrent moins de coûts d’agence que les formes concurrentes, qui sont normalement amenées à disparaître, à plus ou moins brève échéance.
La recherche a présenté deux grandes difficultés. Tout d’abord, ces opérations sont très confidentielles. Nous n’avons eu accès au terrain que parce que nous étions membre du groupe de négociateurs. Cette position d’observateurparticipant, très riche en enseignements (14), nécessite cependant de grandes précautions méthodologiques pour garantir un minimum d’objectivité au recueil d’informations. Ceci nous a incités à choisir, comme support du recueil de données, les documents contractuels et leurs versions successives, issues des séances de négociation, ainsi que les documents préparatoires à ces réunions. Ce choix permet un recueil objectif et une analyse systématique, mais il entraîne une seconde difficulté : la gestion de près de trente mille pages de documentation. Nous avons dû mettre au point plusieurs techniques pour établir une classification et permettre la vérification du modèle.
À l’issue de ce travail, ont été mis en lumière certains coûts d’agence liés à une mauvaise allocation des risques consécutive à des conflits d’intérêt internes aux entités participantes. Pour limiter la subjectivité
de l’étude, diverses « triangulations » de l’information ont été effectuées. La plus importante a consisté en des entretiens de validation auprès de personnes–clés de l’affaire. Les entretiens ont été menés selon la technique de l’entretien focalisé (15). Ils ont fait l’objet d’une analyse de contenu menée au moyen d’une technique proche de celles utilisées en marketing.
L’ÉTUDE CLINIQUE
Le projet
Le projet PAF est une autoroute d’environ cent kilomètres, réalisée dans un pays européen, le Constélia. Elle permet le désenclavement des régions traversées et la liaison de cellesci aux zones limitrophes plus développées. En d’autres termes, il s’agit de structurer le territoire sur le long terme. Le gouvernement prend deux décisions pour lancer l’opération. La première est de recourir au secteur privé pour éviter d’augmenter son endettement. La seconde est de recourir à la technique du shadowtoll, les utilisateurs locaux ne disposant pas d’unpouvoir d’achat suffisant pour avoir accès à une autoroute payante. Dans le cadre de ce partenariat publicprivé, le gouvernement lance un appel d’offres en BOT. L’ensemble des composantes techniques et financières retenues par le Consortium permet de fixer un prix de péage fictif, au moyen d’un modèle financier approprié. L’offre est accompagnée d’un projet de documentation juridique.
À l’issue de cette première phase, les deux meilleurs candidats sont retenus et participent à la phase finale de négociation avec le concédant. L’un d’entre eux est finalement choisi pour mettre en œuvre le projet. La sélection aux différentes étapes du projet repose sur une grille d’évaluation basée à 70 % sur le total des paiements effectués par l’État (16). Les 30 % restants correspondent aux aspects qualitatifs de l’offre.
Les participants au projet PAF
L’organisation contractuelle du projet est indiquée dans le schéma cidessous. Nous présenterons d’abord les différents participants au projet.
Le concédant
Le concédant est l’État. Dans ce pays, le pouvoir exécutif est exercé par le gouvernement. Les ministères de l’Équipement, de l’Environnement et des Finances interviennent à divers titres dans le projet. La négociation des contrats est confiée par l’exécutif au ministère de l’Équipement.
…
Organisation contractuelle de l’opération
Le consortium préfigurant la société concessionnaire et ses actionnaires
Lors de la phase de mise en œuvre du projet, c’est la société concessionnaire qui noue la plupart des contrats. Toutefois, pendant la phase d’appel d’offres, cette structure, même si elle est légalement constituée, n’intervient pas en tant que telle. L’entité qui négocie avec le concédant et les bailleurs de fonds est le Consortium. Celuici est composé des futurs actionnaires de la société concessionnaire. Les règles de décision suivies au sein de cette forme transitoire sont un peu différentes de celles qui seront appliquées en phase opérationnelle. Par exemple, l’unanimité est requise pour des décisions particulièrement importantes, comme l’accord sur les termes et conditions de la proposition remise au concédant.
Le Consortium est composé d’un constructeur international (Interconstruct), d’un entrepreneur local (Locroutes), du futur exploitant (OPERPAF) et d’un investisseur international (2IProjects). La répartition de l’actionnariat est la suivante.
| Société | Nature des prestations | Répartition |
| Interconstruct | Constructeur | 50 % |
| Locroutes | Constructeur | 25 % |
| 21Projects | Investisseur | 15 % |
| Operpaf | Exploitant | 10 % |
| 100 % |
Il se forme entre les représentants de ces différentes organisations un petit groupe qui négocie en se déplaçant d’un pays à l’autre : les réunions du Consortium ont lieu à Paris, les réunions avec les bailleurs de fonds, à Londres, les réunions de négociation avec le concédant dans la capitale du Constélia, etc.
Principales caractéristiques du montage juridique et financier
Le plan de financement
Le plan de financement du projet est synthétisé dans le tableau suivant.
Emplois
| Coûts de construction | 400 |
| Frais financiers intercalaires | 110 |
| Divers | 40 |
| Total emplois | 550 |
| Ressources | |
| Fonds propres | 55 |
| Dette senior | 495 |
| Total ressources | 550 |
Les bailleurs de fonds
Vu la taille des financements nécessaires pour le projet, ils ne peuvent être mis en place par un seul établissement. Les risques et la trésorerie des prêts sont répartis entre plusieurs banques formant un syndicat : on parle alors de « prêts syndiqués ». Ces crédits sont montés par les banques « arrangeuses » de l’opération et proposés ensuite par cellesci à d’autres participants bancaires. Les arrangeurs comprennent Interbank, banque très expérimentée dans la syndication de financements de projet ; Locbank, banque locale connaissant le contexte financier, politique et économique du pays ; Core Bank, banque « amie » des membres du Consortium. Ces trois établissements sont actifs sur le marché de la dette américaine et européenne. Asian Bank, le quatrième arrangeur, permet de couvrir les marchés asiatiques. Ces bailleurs de fonds ont l’habitude de ce genre de montages qui nécessitent un investissement considérable en temps par des experts de haut niveau.
Les constructeurs
Interconstruct et Locroutes seront les réalisateurs duprojet. Ils forment, pour ce faire, la société en participation Realpaf dans laquelle ils sont conjoints et solidaires, à savoir qu’ils mettent leurs moyens en commun dans cette entité juridique et partagent les pertes ou les profits en fin de construction.
