Cours sur les instruments financiers
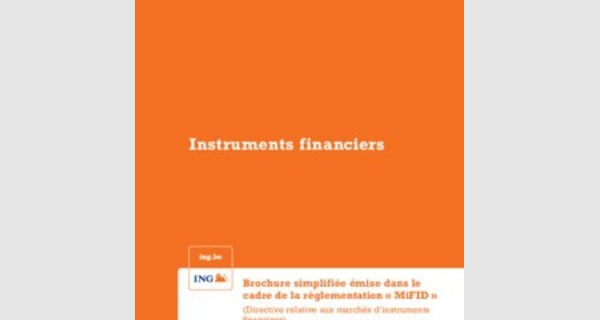
Cours sur les instruments financiers
Partie I.Les instruments financiers visés par MiFID
Nous renvoyons au tableau de la partie II pour les aspects « Risques » liés à ce type d’instrument financier.
1. Obligations
1.1. Description
Une obligation est une reconnaissance de dette de la part d’un émetteur; elle représente une fraction d’un emprunt émis par un émetteur pour lequel le déten-teur de l’obligation perçoit des intérêts (coupons).
L’émetteur peut être :
-- un organisme public, belge ou étranger ; -- une entreprise privée, belge ou étrangère ; -- un organisme international ;
-- un établissement de crédit (on parlera alors de bonde caisse plutôt que d’obligation).
Leur principe est simple : un taux d’intérêt qui donne droit au paiement d’un coupon périodique, une durée d’emprunt, un prix d’achat et un prix de rembourse-ment à l’échéance.
Certaines obligations présentent toutefois des particu-larités que nous aborderons au point 1.3 (principaux types d’obligations).
1.2. Caractéristiques générales
Marché primaire/secondaire
Les obligations sont émises sur le marché primaire et il est possible d’y souscrire pendant une période de sous-cription. Après cette période, les obligations peuvent être négociées (achat/vente) sur le marché secondaire où les prix varient quotidiennement (quand les taux d’intérêt montent, les cours baissent et inversement).
Prix d’émission et valeur de remboursement
Une obligation peut être émise au pair (prix d’émission = 100 % de la valeur nominale), au-dessus du pair (par exemple, valeur nominale de 100, prix affiché de 102) ou sous le pair (par exemple, valeur nominale de 100, prix affiché de 98). La valeur de remboursement à l’échéance est souvent de 100 % de la valeur nominale, mais une prime de remboursement peut être prévue.
Durée
La durée est déterminée dès l’émission de l’obligation, mais un remboursement anticipé (« call ») peut être prévu. Un remboursement anticipé ou call signifie que l’émetteur se réserve le droit, à certaines dates ou périodes déterminées au moment de l’émission, de mettre fin à l’emprunt et de rembourser son détenteur à un prix déterminé au préalable.
La durée influence également le rendement de l’obli-gation. En général, plus la durée de l’emprunt est longue, plus le taux d’intérêt est élevé.
Qualité de l’émetteur
La majorité des émetteurs reçoivent un rating, code standardisé attribué par des agences de notation indépendantes (Moody’s, Standard & Poors, Fitch...). Ce rating donne une appréciation de la solvabilité du débiteur. Plus le rating est bon (par exemple AAA), plus le risque débiteur est faible. Pendant la durée de vie de l’obligation, ce rating peut néanmoins être revu.
1.3. Principaux types d’obligations
On peut distinguer les obligations selon deux points de vue : selon leur nature ou selon leur émetteur.
1.3.1. Obligations selon la nature
- Obligations ordinaires
Les obligations ordinaires ont une durée fixe et sont assorties d’un taux d’intérêt invariable pendant toute cette durée. Les porteurs d’obligations ordi-naires ne bénéficient d’aucun privilège particulier ; en cas de faillite de l’émetteur, ils sont remboursés après tous les créanciers privilégiés.
- Obligations privilégiées
Les porteurs d’obligations privilégiées sont rembour-sés en priorité, en cas de faillite de l’émetteur. Le remboursement du capital et des intérêts est garanti par certains actifs du débiteur.
- Obligations subordonnées
Les porteurs d’obligations subordonnées ne sont remboursés, en cas de faillite de l’émetteur, qu’après tous les autres porteurs d’obligations (créanciers pri-vilégiés et créanciers ordinaires).
- Obligations à coupon zéro
Les obligations à coupon zéro sont caractérisées par une absence de coupon (les intérêts ne sont pas distribués annuellement, mais capitalisés jusqu’à l’échéance); et une émission sous le pair, c’est-à-dire que l’investisseur paie à l’émission moins que la valeur nominale (le prix d’émission est largement inférieur à celui du remboursement car il est égal à la valeur nominale actualisée à la date d’émission et au taux d’intérêt fixé).
- Obligations indexées
Il s’agit ici d’obligations dont le rendement est lié à l’évolution de l’un ou l’autre indice (par exemple : inflation, prix de l’or, indice boursier ou cours d’une action, cours de change donné) ; différentes clauses d’indexation peuvent être prévues : par exemple, seul le prix de remboursement est indexé et aucun coupon n’est payé.
- Obligations à taux variable (ou à taux flottant Floating rate notes (FRN))
Dans ce type d’obligation, le niveau du coupon n’est pas fixe, mais est revu périodiquement.
- Obligations convertibles
Les obligations convertibles ont, comme les obliga-tions ordinaires, un taux et une durée fixes. Ce qui les différencie est le droit (et non l’obligation) pour le détenteur de l’obligation de demander, durant une ou plusieurs périodes données et à des condi-tions fixées au préalable, que celle-ci soit convertie en actions.
- Obligations avec warrants
L’obligation avec warrant est liée à une action ; le warrant donne le droit d’acheter l’action sous-jacente à un prix fixé d’avance. Séparée de son warrant, l’obligation devient une obligation ordinaire. Séparé de l’obligation, le warrant possède les caractéris-tiques de tous les warrants (cfr. point 5.3.3).
- Titres de créance reverse convertibles
Un « reverse convertible » est un titre de créance courant sur une courte période et offrant un coupon relativement élevé. Ce coupon doit être considéré comme rémunérant la possibilité que se réserve l’émetteur (généralement une banque) de rembourser les titres de créance à l’échéance, soit en espèces à la valeur nominale des titres en ques-tion, soit en un certain nombre d’actions ou en leur contre-valeur en espèces. Ces titres sont toujours remboursés au choix de l’émetteur de l’obligation.
Compte tenu des risques qui y sont liés, la FSMA (Financial Services and Markets Authority) a demandé aux établissements de crédit de ne plus utiliser le terme « obligation » pour ce type d’instrument.
- Les obligations perpétuelles
Il s’agit d’obligations pour lesquelles aucune date d’échéance n’est fixée. Elles sont toutefois généra-lement assorties d’un call (remboursement anticipé).
- Les obligations structurées
Également appelées « Structured Notes ». Il s’agit d’obligations courant pendant une période déter-minée avec, le plus souvent, une garantie du capital souscrit, et qui peuvent offrir un coupon lié à l’évo-lution d’un sous-jacent.
Les sous-jacents d’une obligation structurée peuvent être des organismes de placement collectifs, des actions, des indices, un panier d’actions, des (indices sur) matières premières, etc..
Vu le degré de complexité de ce produit, il est réservé à des investisseurs avisés.
1.3.2. Obligations selon l’émetteur
- Les bons de caisse
Il s’agit d’une reconnaissance de dette d’un emprun-teur (l’institution financière) envers un prêteur (l’in-vestisseur).
En contrepartie du capital versé à l’institution finan-cière, l’investisseur perçoit un intérêt sur le montant confié sur la durée conclue (souvent de 1 à 5 ans, parfois 10 ans ou plus).
À échéance, le capital est remboursé. On distingue les bons de caisse ordinaires, à taux d’intérêt pro-gressif, de capitalisation (l’intérêt annuel n’est pas distribué, mais ajouté chaque fois à la somme de départ), avec capitalisation facultative (= bons de croissance) ou avec paiement périodique (trimestriel, mensuel, semestriel).
- Les obligations linéaires (OLO)
Les obligations linéaires sont libellées en euros, dématérialisées et émises principalement par le Trésor belge à moyen, long ou très long terme (jusque 30 ans). Leur taux d’intérêt, la durée et le prix de remboursement sont fixes. Elles sont émises par tranche, et le prix d’émission est fixé par adjudication. Ces instruments sont essentiellement destinés aux professionnels. Les particuliers peuvent éventuellement y accéder sur le marché secondaire via leur institution financière.
- Les bons d’État
Les bons d’État sont des titres à revenu fixe et cou-pon annuel émis, en euros, par l’État belge pour des investisseurs non professionnels.
L’émission sur le marché primaire a lieu quatre fois par an (mars, juin, septembre, décembre) et le titre est coté à la bourse de Bruxelles.
- Les corporate bonds
Une obligation émise par une entreprise ou « corpo rate bond » est un titre de créance représentatif d’une participation dans un emprunt à long terme émis par une entreprise du secteur privé.
En général, le taux d’intérêt est normalement plus élevé que sur les bons de caisse ou bons d’État pour compenser un risque de crédit supérieur.
- Les euro-obligations
Les euro-obligations sont des obligations émises au niveau international (dans plusieurs pays en même temps) par des sociétés privées, des institutions publiques, des États souverains et des organismes internationaux, en dehors du pays de la devise dans laquelle elles sont émises.
Elles sont généralement libellées en différentes devises.
La devise de l’émission (risque de change), la qualité de la société qui émet l’emprunt (l’émetteur), le ren-dement, la possibilité d’un remboursement anticipé sont des éléments à bien prendre en considération par l’investisseur dans le choix des euro-obligations.
1.4. Avantages et inconvénients des obligations
1.4.1. Avantages
- En principe, et en ce qui concerne la plupart des obligations, ce type de placement n’offre aucuneincertitude (montant, date des revenus intermé-diaires et remboursement de capital déterminés au moment de l’émission).
- Les obligations permettent d’obtenir une rémuné-
ration supérieure à ce qu’offrent les placements à court terme, et ceci avec un niveau de risque inférieur à celui que présentent les placements en actions. Cette rémunération est généralementd’autant plus attractive que le rating de l’émetteur est faible (mais ceci s’accompagne également d’un risque plus élevé).
- Les obligations permettent aux investisseurs qui recherchent des revenus d’engendrer un rendementattractif.
- Des investissements en obligations, essentiellement en obligations d’États de l’OCDE, sont possibles à partir de sommes très modiques et sont donc acces-sibles à tous.
- En plus d’un revenu régulier, les obligations peuvent produire des plus-values lorsque les taux du marché deviennent inférieurs au taux de l’obligation détenue.
- Contrairement aux placements « privés », les obli-gations sont en règle générale négociables à toutmoment sur un marché secondaire en fonction dela liquidité disponible.
1.4.2. Inconvénients
- La garantie de capital n’est effective qu’à l’échéance.
- Pendant la durée de l’emprunt, la valeur de l’obliga-tion fluctuera en fonction de divers facteurs, dontl’évolution des taux d’intérêt et la solidité financière de la société émettrice sont les principaux.
- La valeur réelle du principal lors du remboursement à l’échéance finale est généralement inférieure à celle du principal au moment de l’émission, en raison de l’inflation. Ce phénomène, appelé « érosion moné-taire », est d’autant plus grand que l’inflation est élevée et que la durée de l’obligation est longue. Il doit être compensé si le taux d’intérêt nominal est supérieur au taux d’inflation moyen au cours de la durée de vie de l’obligation.
- Un emprunt ne peut être acquis aux conditions initiales que pendant la période de souscription. En dehors de cette période, l’emprunt est acquis à un prix variable, et le prix d’achat doit être majoré decourtage.
2. Actions
Nous renvoyons au tableau de la partie II pour les aspects « Risques » liés à ce type d’instrument financier.
2.1. Description
L’action est une part des capitaux propres d’une socié-té. L’actionnaire est donc propriétaire de la société au prorata du nombre d’actions qu’il possède.
Le particulier qui y adhère opte alors généralement pour un instrument sans échéance (la sortie ne peut se faire que par cession du titre, il n’y a pas de rembourse-ment prévu contractuellement), sans revenu fixe et sans valeur nominale ni valeur fixe.
Le cours d’une action constitue un compromis entre les revenus (dividendes et plus-values) et les risques. Ces derniers tiennent à de nombreux facteurs, aussi bien intrinsèques à la société (comme sa situation financière, technique et commerciale, sa politique d’investissement, ses perspectives et celles de son sec-teur économique, etc.) qu’externes, puisque le marché boursier est influencé par les événements politiques, la situation économique et monétaire, tant internationale que nationale, et par des éléments émotionnels ou irrationnels pouvant accentuer (à la hausse comme à la baisse) les fluctuations des cours de la bourse.
Tous ces facteurs complexes influencent le cours de l’action et peuvent le rendre assez volatil à court terme. L’investissement en actions doit par conséquent être considéré comme un placement à long terme. Les actions sont le plus souvent regroupées dans un « indice ».
Celui-ci regroupe des actions possédant des caractéris-tiques communes, que ce soit d’un point de vue géo-graphique (indices nationaux tels le Bel 20, le CAC 40, le DAX, le Footsie, le Dow Jones, le Nikkei), d’un point de vue sectoriel ou d’un point de vue de la capitalisa-tion boursière (indices de small caps…).
2.2. Caractéristiques générales
Rendement
C’est le dividende éventuel et la fluctuation du cours (plus-value) qui constituent ensemble le rendement (« return ») d’une action.
Risque
L’investisseur court le risque total de l’entreprise (il ne perçoit aucun revenu si l’entreprise va mal et, en cas de faillite, l’actionnaire passe après le créancier dans la répartition du produit de la vente des actifs, autre-ment dit, la plupart du temps, il ne peut rien récupérer en cas de faillite). En contrepartie, étant coproprié-taire, l’actionnaire détient les droits suivants :
Droits attachés à l’action
-- droit au dividende : si l’entreprise a réalisé desbénéfices et que l’assemblée générale décide de les distribuer en tout ou en partie (et non de les réinves-tir ou de les mettre en réserve), l’actionnaire a droit à une part de ces bénéfices, appelée dividende. Le dividende peut varier d’une année à l’autre, en fonction des bénéfices réalisés, mais aussi de la politique de distribution de ceux-ci. Si l’exercice est clôturé sur une perte, il se peut qu’il n’y ait pas de distribution de dividende. Le dividende n’est donc jamais garanti.
Le dividende est généralement distribué en numé-raire. Parfois, l’actionnaire a aussi la possibilité de le percevoir sous la forme de nouvelles actions (stock dividend), selon une proportion établie d’avance.
-- droit de vote aux assemblées générales ordinaireset extraordinaires pour l’approbation des comptes annuels, la désignation et la démission des admi-nistrateurs, l’approbation du montant du dividende distribué aux actionnaires ; l’actionnaire a ainsi undroit de contrôle sur la gestion.
-- droit d’information : l’actionnaire peut prendreconnaissance, avant l’assemblée générale, du bilan de la société, du contenu de son portefeuille-titres, du rapport des commissaires et réviseurs, ainsi que d’autres informations, périodiques ou occasionnelles, communi-quées par la société ; l’actionnaire peut demander des explications sur la situation de l’entreprise.
-- droit de répartition : en cas de liquidation, l’action-naire a droit à une part de l’avoir social.
-- droit de souscription (priorité sur les actions nouvelles), en cas d’augmentation de capital décidée avec l’accord des actionnaires. L’actionnaire qui ne souhaite pas participer à cette augmentation de capital peut vendre son droit de souscription en bourse, si l’action est cotée. Certaines entreprises distribuent parfois des actions gratuites, appelées « bonus ».
-- droit de transmission : pour les sociétés cotées,l’actionnaire peut vendre ses actions sur un marché boursier.
2.3. Principaux types d’actions
Actions représentatives du capital de la société :
Ces actions peuvent comporter les particularités sui-vantes :
-- Actions avec ou sans droit de vote
Les actions avec droit de vote permettent à l’action-naire, en tant que copropriétaire, de participer à l’assemblée générale et de prendre part au vote et à la gestion de la société. Les actions sans droit de vote donnent droit à un dividende qui ne peut être infé-rieur à celui accordé aux actions avec droit de vote.
-- Les actions privilégiées ou préférentielles
Ces actions peuvent donner droit, avant toutes les autres actions, à une part du bénéfice annuel. En cas de dissolution de la société, elles sont rembour-sées avant toutes les autres.
Actions non représentatives du capital de la société :
À distinguer des actions classiques, les parts bénéfi-ciaires ne sont pas représentatives du capital social ni d’un apport matériel et ne peuvent pas avoir de valeur nominale.
Elles sont émises en contrepartie d’un apport autre que financier dans la société, autrement dit un apport non évaluable. Elles donnent droit à une partie du bénéfice au cours de la vie de la société ou à la dis-solution de celle-ci. Leurs titulaires ne peuvent exercer leur droit de vote que dans des cas limités.
-- Actions cotées
Pour qu’une action puisse être admise à la cote, cer-taines conditions fixées par les autorités de marché doivent être remplies. L’introduction d’une action en bourse est également appelée IPO (Inital Public Offering).
-- Introductions en bourse (IPO, Initial PublicOffering)
IPO est le terme utilisé quand une entreprise émet des actions pour la première fois en bourse. Une société qui procède à une introduction en bourse a comme objectif principal la récolte de fonds pour l’investissement et sa croissance. Pour qu’une société puisse être introduite en bourse, certaines conditions doivent être remplies (taille minimum, publication d’informations régulières et détaillées, règles de « Corporate Governance », etc.) d’entre-prise, etc...). Les investisseurs particuliers peuvent également avoir accès aux introductions en bourse.
-- Actions sectorielles
Sous l’angle de l’investissement boursier, quatre secteurs peuvent être distingués :
-- les valeurs cycliques (construction, matières pre-mières, chimie) ;
-- les valeurs de croissance (télécoms, pharmacie,informatique) ;
-- les valeurs financières (banques et assurances) ; -- les valeurs défensives, articulées autour des biens de consommation et des services aux particuliers (production et distribution).
2.4. Avantages et inconvénients des actions
2.4.1. Avantages
- Sur le plan financier, il a été démontré que sur une longue période, le rendement d’une action est supérieur à celui d’une obligation. Ceci s’explique notamment par la prime de risque exigée par l’investisseur. À la différence d’une obligation, le rendement d’une action est constitué surtout par la plus-value que l’action acquiert au fil du temps, et non seulement par le revenu (dividende) qu’elle distribue.
- Liquidité : si ses actions sont cotées, l’actionnairepeut les vendre chaque jour par l’intermédiaire d’un marché boursier. La « liquidité » d’une action indique la facilité avec laquelle elle peut être achetée ou vendue.
2.4.2. Inconvénients
L’investissement en actions est un placement à risque (cfr. tableau partie II) :
-- dépendant de la rentabilité de la société, le dividende est un revenu variable (par opposition à l’intérêt fixe produit par une obligation) ;
-- la valeur de l’action sur le marchéfluctue en fonctiondes perspectives de la société et de la tendance générale des marchés.
3. Les organismes de placement collectifs (OPC)
Nous renvoyons au tableau de la partie II pour les aspects « Risques » liés à ce type d’instrument financier.
3.1. Description
Le terme « Organisme de Placement Collectif » (ci-après dénommé « OPC ») est un terme général qui désigne une entité, avec ou sans personnalité juridique, qui recueille des capitaux auprès du public et les investit collectivement dans un ensemble de valeurs mobilières selon le principe de la répartition des risques.
Les OPC sont une forme de gestion collective de por-tefeuilles. Les OPC les plus populaires sont les sicav. Le terme OPC recouvre cependant toute une série de pro-duits ayant une nature juridique spécifique.
-- les sicav (sociétés d’investissement à capital variable) ; -- les fonds de placement (dont les fonds d’épargnepension belges) ;
-- les sicaf (sociétés d’investissement à capital fixe) dontles sicafi (sicaf immobilières) ;
-- les pricaf (sociétés d’investissement à capital fixeinvestissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance ;
-- les SIC (sociétés d’investissement en créances).
Nous nous limiterons ici aux sicav et fonds de placement.
3.2. Caractéristiques générales
-- Sicav et fonds de placement ont tous deux la possi-bilité d’augmenter ou de diminuer quotidiennement leur capital. La grande différence entre les deux formes est que la sicav a la personnalité juridique,alors que le fonds commun de placement ne l’a pas : le fonds est la propriété indivise de ses actionnaires.Ceci a notamment des impacts fiscaux qui ne seront pas abordés ici.
-- Les OPC sont soumis àune législation spéci-fique ainsi qu’au contrôle prudentiel par la FSMA (Financial Services and Markets Authority).
-- La gestion des actifs est confiée à des spécialistesqui investissent les montants collectés dans diverses valeurs mobilières (actions, obligations, instru-ments du marché monétaire, certificats immobiliers, devises, placements à terme, etc.), en respectant la politique d’investissement du fonds décrite dans le prospectus. L’investisseur n’a aucun droit de regard sur la politique d’investissement suivie par l’OPC. Pour savoir si un OPC répond à ses besoins, il doit se référer au prospectus d’émission de celui-ci.
-- Les OPC réinvestissent les fonds qui leur sont confiéspar le public selon le principe de la répartition desrisques.
-- La valeur d’inventairecorrespond à la valeur de mar-ché, par action, de l’actif net du portefeuille. Cette valeur d’inventaire est calculée périodiquement, le plus souvent quotidiennement, et est publiée dans la presse financière.
-- Les OPC sont gérés dans l’intérêt exclusif des parti-cipants.
En investissant dans un OPC, on peut étaler le risque de placement et on a plus aisément accès aux bourses et marchés étrangers.
-- Les OPC sont tenus de respecter les dispositionsrelatives à l’information des investisseurs (établisse-ment d’un prospectus d’émission, rapport annuel, semestriel relatif à la performance, publication de la valeur d’inventaire...).
3.3. Principaux types d’OPC
Outre la distinction des OPC selon leur forme juri-dique, on peut aussi les distinguer selon la politique de gestion et la stratégie d’investissement.
Nous allons succinctement aborder ici en quoi ils se distinguent.
3.3.1. Distinction selon la politique de distribution
On fait une distinction entre les actions de distri-bution, d’une part, et les actions de capitalisation,d’autre part.
Certaines sociétés laissent à l’investisseur le choix entre les deux types.
• Actions de distribution :
Elles donnent à l’investisseur la possibilité de percevoir un dividende périodique (le plus souvent annuel). Tout ou partie des revenus encaissés sont alors reversés à leur détenteur.
• Actions de capitalisation :
Les revenus perçus ne sont pas distribués aux déten-teurs, mais sont automatiquement réinvestis et ajoutés au capital investi et replacés.
Il n’y a pas de distribution de revenus ou de dividendes. L’investisseur ne bénéficie du rendement de son inves-tissement qu’au moment de la vente de ses parts. C’est alors qu’il touche un revenu sous forme de plus-value.
3.3.2. Distinction selon la stratégie d’investissement
Il existe aujourd’hui une multitude d’OPC, principale-ment des sicav.
Les OPC peuvent être regroupés autour de quelques grands axes en fonction du type de valeurs détenues en portefeuille (liquidités, obligations, actions, métaux précieux, certificats immobiliers ou combinaison de deux ou plusieurs de ces valeurs).
- OPC monétaires : investissent de façon prépondé-rante en liquidités et en valeurs à court terme, telles que les dépôts à terme, les certificats de trésorerie, les obligations ayant une échéance rapprochée, le papier commercial et les certificats de dépôt.
- OPC d’obligations : investissent principalement envaleurs à revenu fixe.
- OPC d’actions : investissent principalement en actionsde sociétés, et accessoirement en produits dérivés (cfr. point 5.3) comme les warrants, les options, etc.
- OPC avec protection de capital : sont assortisd’une date d’échéance à laquelle, un montant de remboursement minimum est prévu pour l’investis-seur. Ce montant représente une protection com-plète (100 %) ou partielle de l’investissement initial (moins les éventuels frais et taxes).
Les valeurs sous-jacentes à ces fonds peuvent être de natures très différentes. Le plus souvent, ces sous-jacents sont des actions ou des obligations. Cependant, le fonds à protection va s’orienter davantage vers des valeurs à rendement fixe. Le gestionnaire doit en effet veiller à ce que la mise de départ soit récupérée.
Les OPC jouent ici sur deux tableaux : d’une part, restituer la mise de départ à l’échéance et, d’autre part, coupler les performances de l’OPC à l’évolu-tion du sous-jacent y afférent.
On distingue deux catégories d’OPC avec protection de capital : les « fonds à cliquets » et les « autresfonds ».
-- Les « fonds à cliquets » permettent de limiter lerisque d’une chute de l’indice à l’échéance finale. Le système de cliquets permet de bloquer défini-tivement des gains soit à un certain moment, soit à un certain niveau, et ce quelles que soient les performances ultérieures du fonds.
-- Les « autres fonds », quant à eux, ne cliquent pasde bénéfices à des périodes intermédiaires, mais à l’échéance, la hausse de l’indice sous-jacent est por-tée en compte pour un certain pourcentage (moins de 100 %, 100 % ou plus, nombreuses variantes…).
- OPC mixtes : investissent tant en actions qu’enobligations.
On distingue plusieurs types de fonds mixtes, selon leur profil de risque :
-- les mixtes « défensifs » consacrent une plus grandepartie aux placements sans risques (par exemple, 75 % sont investis en obligations, dans une majorité de devises stables) ;
-- les mixtes « neutres » répartissent leurs avoirs defaçon plus ou moins équilibrée entre les placements non risqués (obligations) et les placements risqués (actions) ;
-- Les mixtes « dynamiques » ou « agressifs » consacrentune plus grande partie aux placements à risque (par exemple, 75 % sont investis en actions).
- Fonds d’épargne-pension : dans le cadre de l’encouragement à l’épargne-pension individuelle (arrêté royal du 22 décembre 1986 instaurant un régime d’épargne-pension), les autorités ont favorisé un certain nombre de produits de placement. Les nou-velles conditions de placement pour les fonds d’épargne-pension sont mentionnées dans la loi du 17 mai 2004 adaptant, en matière d’épargne-pension, le Code des impôts sur les revenus 1992. Chaque personne entre 18 et 64 ans soumise à l’impôt des personnes physiques peut investir un montant maximum dans un plan d’épargne-pension et peut le soustraire de ses revenus dans sa déclaration fiscale. Lorsqu’elle atteint l’âge de 60 ans, un impôt unique et définitif est d’application et il est possible de sortir du plan. Si elle souhaite sortir plus tôt (avant la mise à la retraite), elle doit s’acquitter d’un précompte plus élevé.
Les fonds d’épargne-pension sont des fonds de placement jouissant d’un statut privilégié, et ils ont séduit un grand nombre de Belges. Ce sont des fonds de placement mixtes, puisqu’on y trouve à la fois des actions et des obligations. La politique d’investissement de ce type de fonds est en plus soumise à certaines restrictions légales.
- OPC immobiliers : investissent principalement enbiens immobiliers. Les OPC qui investissent unique-ment dans d’autres OPC immobiliers ou dans des certificats fonciers appartiennent à cette catégorie (sicafi).
- Pricaf : sont des sociétés d’investissement à capitalfixe investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance.
- Fonds de fonds : sont des OPC qui investissentdans d’autres OPC. Les gestionnaires de fonds de fonds sélectionnent d’autres gestionnaires de fonds pour une région, un secteur, un thème…
- Hedge Funds : (cfr. point 4.2.2) fonds dérégulésutilisant des stratégies de portefeuille dites « alter-natives » ou non traditionnelles dans un but de couverture contre (« to hedge ») les fluctuations boursières ou spéculatives ou visant à produire des rendements positifs quelle que soit l’évolution des marchés financiers (stratégie de rendement absolu (appelés aussi fonds « absolute return »). Un certain nombre de ces fonds cherchent aussi, dans le cadre de ces stratégies, à mettre en place l’« effet de levier », ce qui accroît considérablement les risques. Cependant, il existe aussi des low risk hedge funds.
- OPC indiciels : ces OPC ont pour politique d’investis-sement de suivre le plus fidèlement possible l’évolu-tion d’un indice de référence (par exemple, un indice boursier national (le Bel 20 en Belgique) ou un indice sectoriel).
L’évolution de l’OPC suit donc la performance moyen ne de l’indice concerné.
- ETFs/Trackers : un ETFs/tracker est un fonds indicielcoté en bourse. L’investisseur a ainsi la possibilité, en une seule transaction, de bénéficier de la performance d’un indice, d’un panier d’actions, d’un panier d’obligations ou de matières premières. L’ETFs/tracker allie les avantages des actions (simplicité, cotation continue) à ceux des fonds traditionnels (accès à un vaste choix de valeurs, diversification).
3.4. Avantages et inconvénients des OPC en général
3.4.1. Avantages
- Diversification :les OPC permettent à l’investisseurde se constituer un portefeuille diversifié avec une répartition des risques.
- Gestion par des gestionnaires professionnels :plusrentable et plus efficace; les professionnels peuvent réagir plus rapidement aux circonstances du marché. Pour les investisseurs qui n’ont pas le temps, pas l’envie ou pas les connaissances requises pour assurer eux-mêmes la gestion d’un portefeuille avec achat et vente d’actions aux moments propices, choix et arbi-trage d’obligations, etc., les OPC offrent une solution appropriée.
- Économies d’échelle :vu l’importance des moyensmis en œuvre, il est possible de bénéficier de réduc-tions de frais (sur les transactions boursières par exemple) et d’obtenir de meilleurs rendements.
- Placementsadaptésauxbesoinsdel’investisseur:la multiplicité des OPC existants et le caractère propre de chacun d’eux permet de bien répondre aux besoins spécifiques et variés des investisseurs.
- Possibilité d’investir des montants peu élevés :même avec une faible mise, l’investisseur peut par-ticiper à plusieurs marchés, voire plusieurs devises ; portefeuille diversifié avec un montant peu élevé.
- Accès à des marchés spécifiques difficilement oupas du tout accessibles aux particuliers isolés (les marchés asiatiques, par exemple) ou à des produits financiers sophistiqués (options, futures).
- Liquiditéettransparence:lavaleurd’inventaire(pourles sicav) ou le cours de bourse (pour les sicaf) est calculée au moins deux fois par mois, et souvent même quotidiennement. Outre les informations obli-gatoirement diffusées aux investisseurs (prospectus et rapports (semi-)annuels qui doivent être soumis pré-alablement à l’autorité de contrôle), bon nombre de sites internet d’institutions financières publient une large information sous forme de fiches techniques de fonds et de brochures d’information. Ces informa-tions, librement accessibles, permettent aux investis-seurs d’assurer facilement le suivi de leurs placements et du contexte global économique et financier.
- En fonction du type de fonds et du sous-jacent dans lequel sera investi l’OPC, il faudra tenir compte de certains avantages propres à l’instrument financier enquestion (voir rubrique « avantages » pour chacun des instruments financiers parcourus dans cette brochure (soulignons, par exemple, l’avantage d’un fonds à cliquet qui permet ainsi de verrouiller définitivement la hausse intermédiaire et de l’obtenir à l’échéance, quoi qu’il arrive, etc...).
3.4.2. Inconvénients
- Les frais : les parts et actions d’OPC donnent lieugénéralement à la perception de frais de gestion (part la plus importante des frais), de frais d’entrée et desortie (pouvant varier fortement selon leurs caracté-ristiques propres et selon les institutions financières qui les commercialisent) ainsi que de taxes sur lesopérations de bourse (TOB).
- En fonction du type de fonds et du sous-jacent dans lequel sera investi l’OPC, il faudra tenir compte de certains inconvénients propres à l’instrument financier en question (voir rubrique « inconvénients » pour chacun des instruments financiers parcourus dans cette brochure (soulignons, par exemple, le risque plus important que comporte un OPC d’actions par rapport à un OPC d’obligations, etc.)).
Les investissements alternatifs
Nous renvoyons au tableau de la partie II pour les aspects « Risques » liés à ce type d’instrument financier.
4.1. Description
Les investissements alternatifs sont ceux qui ne peuvent pas être réalisés via des classes d’actifs stan-dard (obligations, actions ou marchés monétaires). Ils présentent des caractéristiques uniques en termes de rapport risque/return. Dans de nombreux cas, ils pré-sentent un degré de sophistication élevé.
4.2. Principaux types d’investisse-ments alternatifs
On distingue quatre grands groupes de placements alternatifs :
-- les placements immobiliers (real estate) ; -- les hedge funds ;
-- le private equity ;
-- or, mines d’or, métaux précieux, matières premières(commodities).
4.2.1. Les placements immobiliers
- Les certificats immobiliers
Le certificat immobilier (ou foncier) est un titre qui donne à son détenteur un droit à une partie du loyer et du prix de revente de l’immeuble (ou du groupe d’immeubles) sur lequel il porte. L’émetteur est officiellement le propriétaire de l’immeuble : le détenteur du certificat n’en est que le financier.
- Les sicaf immobilières (sicafi)
Une sicafi est une société d’investissement à capital fixe à vocation immobilière. C’est de l’immobilier titrisé, c’est-à-dire que l’investisseur acquiert des immeubles non pas directement, mais indirec-tement, par l’achat d’un titre représentatif des immeubles de la sicafi. La sicafi doit obligatoirement investir dans plusieurs immeubles (pas plus de 20 % de ses actifs dans un seul ensemble immobilier).
Il s’agit principalement d’immeubles de bureaux, d’immeubles à vocation commerciale ou semi-indus-trielle, mais aussi parfois de logements. La sicafi peut aussi détenir des certificats immobiliers et des titres de sociétés immobilières.
4.2.2. Les fonds à effet de levier (hedge funds)
Un « hedge fund » est un produit d’investissement qui cherche à maximiser la performance par le biais de stratégies d’investissement alternatives et à engendrer des rendements positifs quelle que soit l’évolution des marchés financiers (stratégie de rendement absolu). Les pratiques d’investissement des hedge funds sont l’effet de levier, la vente à découvert, les produits déri-vés, les swaps et l’arbitrage.
Les hedge funds sont des produits complexes réservés à des investisseurs avertis (cfr. point 3.3.2).
4.2.3. Le private equity
Ce terme fait référence aux capitaux qui sont four-nis à des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Diverses raisons peuvent conduire à ce type d’inves-tissement (développement de nouveaux produits et technologies, renforcement structure du bilan, aug-mentation du fonds de roulement…).
Un investissement en private equity est également possible par le biais de fonds et permet ainsi de limiter le risque lié à une société individuelle.
Sommaire
Partie I. Les instruments financiers visés par MiFID 6
1. Obligations 6
1.1. Description 6
1.2. Caractéristiques générales 6
1.3. Principaux types d’obligations 6
1.3.1. Obligations selon la nature 6
1.3.2. Obligations selon l’émetteur 7
1.4. Avantages & inconvénients des obligations 8
1.4.1. Avantages 8
1.4.2. Inconvénients 8
2. Actions 9
2.1. Description 9
2.2. Caractéristiques générales 9
2.3. Principaux types d’actions 10
2.4. Avantages & inconvénients des actions 10
2.4.1. Avantages 10
2.4.2. Inconvénients 10
3. Les organismes de placement collectifs (OPC) 11
3.1. Description 11
3.2. Caractéristiques générales 11
3.3. Principaux types d’OPC 11
3.3.1. Distinction selon la politique de distribution 11
3.3.2. Distinction selon la stratégie d’investissement 12
3.4. Avantages & inconvénients des OPC en général 13
3.4.1. Avantages 13
3.4.2. Inconvénients 14
4. Les investissements alternatifs 14
4.1. Description 14
4.2. Principaux types d’investissements alternatifs 14
4.2.1. Les placements immobiliers 14
4.2.2. Les fonds à effet de levier (hedge funds) 14
4.2.3. Le private equity 15
4.2.4. Or, mines d’or, métaux précieux et matières premières 15
4.3. Avantages et inconvénients des investissements alternatifs 15
4.3.1. Avantages 15
4.3.2. Inconvénients 15
5. Les instruments financiers dérivés 15
5.1. Description 15
5.2. Caractéristiques générales 16
5.3. Principaux types d’instruments financiers dérivés 16
5.3.1. Options 16
5.3.2. Futures & Forwards 17
5.3.3. Instruments présentant des similitudes avec les options 17
5.4. Avantages & inconvénients des instruments financiers dérivés 17
5.4.1. Avantages 17
5.4.2. Inconvénients 17
6. Produits d’assurance d’épargne ou d’assurance d’investissement 18
6.1. Produits d’assurance d’épargne 18
6.1.1. Description 18
6.1.2. Caractéristiques générales 18
6.1.3. Avantages et inconvénients d’un contrat Branche 21 19
6.1.3.1. Avantages 19
6.1.3.2. Inconvénients 19
6.2. Produits d’assurance d’investissement 19
6.2.1. Description 19
6.2.2. Caractéristiques générales 19
6.2.3. Principaux types de produits d’assurance d’investissement 20
6.2.4. Avantages et inconvénients des produits d’assurance d’investissement (par rapport aux OPC) 20
6.2.4.1. Avantages 20
6.2.4.2. Inconvénients 20
Partie II. Les différents types de risque des instruments de placement 20
1. Les différents types de risque - définition 20
1.1. Risque d’insolvabilité 20
1.2. Risque de liquidité 20
1.3. Risque de change 21
1.4. Risque de taux 21
1.5. Risque de volatilité du cours 21
1.6. Risque d’absence de revenu 21
1.7. Risque de capital (ou de remboursement) 21
1.8. Autres risques 21
2. Tableau récapitulatif 22
