Cours complet sur la finance de banques
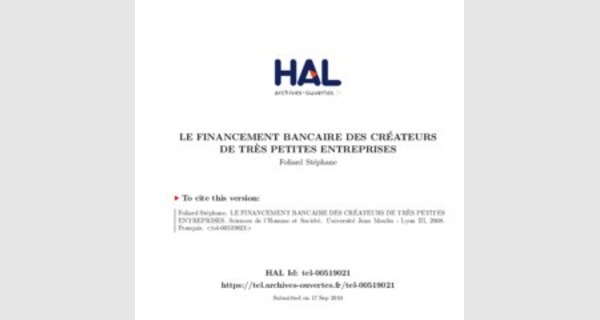
Cours complet sur la finance de banques
La fable du créateur et du banquier n’est bien sûr qu’une caricature de la réalité. On y retrouve toutefois des éléments partagés par unepart importante des porteurs de projet : la relation avec un conseiller financier est un élément délicat dans une démarche de création d’entreprise, c’est un rapport humain déterminant, la décision du banquier est difficile à percevoir, les entrepreneurs misent sur le futur quand le banquier parle au présent, la valeur du projet est toujours plus importante pour le créateur que pour le financier.
Les trois premiers indicateurs simples que nous avons ensuite relevés concernent les créations d’entreprises sur l’année écoulée etillustrent une situation qui peut paraître paradoxale : la dynamique des créations d’entreprises en France a rarement été aussi forte et poursuit une tendance haussière sur les dernières années et ces créations concernent en majorité des entreprises de très petite taille qui n’emploient pas de salariés. Cette dynamique est étonnante quand on constate que les encours de crédit accordés au Très Petites Entreprises (TPE par la suite) progressent moins rapidement que le rythme des créations. Deux idées sont possibles pour expliquercet état de fait : soit la taille des entreprises nouvellement créées diminue, ce qui justifie le faible emploi salarié et l’augmentation plus faible des encours, soit les banques sont frileuses face à cet engouement entrepreneurial qui constitue pour elles une source de revenu mais également un risque. Seuls, ces trois indicateurs chiffrés sont déjà de nature à encourager le chercheur à étudier le financement initial des TPE. Le sujet correspond également à une véritable demande des porteurs de projet qui se trouvent au centre d’un discours politique et médiatique les incitant à entreprendre, et des banques dont la frilosité est, à tord ou à raison, montrée du doigt. Les porteurs de projet semblent ne pas comprendre les positions des banquiers. Les nombreuses rencontres avec cette population qui ont émaillé le début de notre travail, attestent de la nécessité d’éclairci la relation entre ces deux catégories d’acteurs professionnels qui sont amenés à travailler ensemble par l’obligation pour l’entrepreneur de détenir un compte professionnel. Encore faut-il que l’aventure entrepreneuriale puisse se concrétiser.
Nous souhaitons étudier le financement des TPE. Cela suppose d’abord de savoir de quoi l’on parle quand on parle de TPE 2, quel va être le support de notre recherche. Approcher les TPE dans leur phase de création n’est pas une chose aisée pour diverses raisons.
Le terme TPE recouvre un ensemble particulièrement hétérogène de réalités organisationnelles englobant les commerces de proximité, une grande partie de l’artisanat, la petite industrie, de nombreux prestataires de services, les professions libérales et le monde agricole. Leur diversité esttellement importante qu’elle empêche tout travail de taxonomie exhaustive comme le reconnaît MARCHESNAY (2003).
Les porteurs de projet ne sont pas toujours faciles à identifier, ils mènent généralement leur projet de manière discrète malgréquelques points de passages obligatoires comme les Chambres Consulaires ou les banques. La culture française du secret et le tabou entourant l’argent et le statut de « patron » rendent cette population peu loquace.
L’indigence des informations disponibles sur les TPE et leur mode de fonctionnement, que ce soit leur création ou leur gestion, rend leur approche très difficile. Les TPE sont reconnues comme des entreprises opaques, rechignant à délivrer des informations.
Les banques sont peu enclines à communiquer sur leu r clientèle et sur leurs procédures d’octroi de crédit, même d’une manièreynthétiques ne trahissant pas le secret bancaire.
La littérature académique entrepreneuriale relativeau TPE ou au financement bancaire de ces entrepreneurs, est quasi inexistante face à une presse spécialisée qui reprend et développe les thématiques politiques prônant l’esprit d’entreprise et sa concrétisation sous forme d’organisations plus ou moins formalisées, comme en atteste le rapport HUREL de janvier 2008 sur le développement de l’auto-entrepreneur3. Le sujet reste donc à défricher, ce qui conduit le chercheur à une démarche de prudence dans un cadre d’une grande richesse où les risques de dispersion sont légions.
Travailler sur le financement bancaire des TPE semble cumuler les difficultés, même si nous profitons d’un contexte socio-économique et politique porteur illustré par le dynamisme précédemment cité et les intentions d’entreprendre qui repartent à la hausse. Afin de préciser la réalité économique et socialentourante les TPE, nous pouvons présenter quelques chiffres. Nous retenons comme base de définition de la TPE dans cette introduction, le critère du nombre de salariés mêmesi nous développerons dans le chapitre 1 les limites de cette démarche. Le cadre général edla création d’entreprises est très dynamique sur les dix dernières années (Figure I.01..). Elles alimentent ainsi un stock important d’entreprises progressant de 12,7 % de 1997 à 2007 (Figure I.0.2.) et de plus de 600 000 unités depuis 1999. Il est intéressant d’observer à présent la part respective des différents types d’entreprises créées, en distinguant les TPE ayant moins de 10 salariés et le reste des entreprises. Au 1er janvier 2006, l’INSEE dénombre 2 651 194 entreprises qui se répartissent comme suit.
Le rapport HUREL prévoit de redynamiser le statut d’entrepreneur individuel capable de répondre à des demandes du marché, même si cela doit se faire sur une courte ériodep. Il rejoint en cela les idées deself-employment nord-américaines où il est très aisé de partir en affaires, comme il est facile de stopper cette activité. L’état actuel de l’environnement des entreprises françaises et, en p articulier, leur statut fiscal et social et les mentalités, ne permet pas un tel développement. Le rapport HUREL doit permettre de lancer un travail de fond sur l’organisation des entreprises et leurs démarches.
…
S’intéresser aux TPE revient donc à travailler sur les entreprises largement majoritaires dans le panorama économique français. Certes, ces entreprises ne représentent, toujours selon l’INSEE, que 29 % de l’effectif salarié et 27 % de la valeur ajoutée à fin 2006. Il faut tout de même nuancer ces chiffres, car aujourd’hui,87 % des entreprises se créent sans salarié mais créent les emplois des porteurs de projet, soit près de 280 000 emplois non salariés « dépendants » sur la seule année 2007, cequi est loin d’être négligeable.
Sur la même année 2007, nous observons une baisseensible des défaillances d’entreprises dont les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire ont diminué de 8,3 %. Globalement, nous observons un grand dynamisme des TPE, une augmentation conséquente du stock d’entreprises de cette taille et, pourtant, les financements bancaires augmentent moins vite que les besoins supposés, si on les considère proportionnels. Nous avons relevé dans les pages économiques d’un grandquotidien le titre évocateur suivant :
« Les PME subissent la frilosité des banques : la proportion de prêts accordés aux petites et moyennes entreprises a baissé depuis octobre, a indiqué hier le secrétaire d’Etat aux Entreprises, Hervé Novelli ». Ce paradoxe supposé est déjà de nature à intéresserle chercheur à comprendre le fonctionnement du finance ment bancaire des TPE. Cette frilosité a sans doute ses raisons, les banques n’ont aucun intérêt à limiter leur activité commerciale liée aux financements de nouveaux clients, à qui elles pourront proposer leurs produits de banque et d’assurance, sur lesquels elles basent l’essentiel de leur produit net bancaire6.
Nous souhaitons, dans cette introduction générale,exposer le cheminement de la démarche qui nous a conduit à nous intéresser, malgré les difficultés énoncées, à la démarche des porteurs de projet de taille TPE et, plus particulièrement, sur ce qui apparaît le point noir de leur démarche : la demande de financements bancaires. Pour ce faire, nous présenterons dans une première section (I.1.) trois points illustrant la pertinence d’un travail de recherche : l’intérêt grandissant des TPE dans le iscoursd politique (I.1.1.), la nature de la TPE et son analyse dans la littérature (I.1.2.), cela nous amènera au troisième point, c’est à dire une réflexion sur les conditions particulièresde financement des TPE en général, et de leur création en particulier (I.1.3.). Dans une seconde section (I.2.), nous présenterons les objectifs de notre recherche et le déroulement de notre présentation. Nous terminerons par la thèse que nous défendons.
I.1. Intérêts d’un travail sur le financement des TPE
I.1.1. La dimension politique des créations de TPE
Par le terme auto-entrepreneur, le rapport HUREL place de facto la création d’entreprise comme une solution importante de lutte contre le sous-emploi en France. Il est présent dans le nouveau Projet de Loi de Modernisation de l’Écon omie du 28 avril 2008 au
Le Figaro.fr, le 12 mars 2008.
Le produit net bancaire est l’indicateur de l’acti vité d’une banque, il se compose de la marge d’intérêt, des commissions positives sur commercialisation de produits et services bancaires et des commissions négatives facturées sur des comptes débiteurs par exemple.
Chapitre 1, Statut de l’auto entrepreneur , du Titre 1, Mobiliser les entrepreneurs, ce qui le place au premier plan. Ce terme renvoie à un statut, celui d’entrepreneu r individuel dévalorisé par les risques patrimoniaux qu’il subit, comme en atteste le développement des formes sociétales dans la TPE, bien que celles-ci ne soient souvent que des artifices ne permettant pas de se protéger réellement à titre personnel contre un risque de faillite. L’idée est simple et consiste à créer de nouveaux emplois par de nouvelles entreprises. Pour DEEKS (1995), l’auto-entrepreneur propriétaire (self-employed) de son organisation n’a pas de salarié et participe directement au travail physique de production. Pour FAYOLLE (2003), la création d’entreprise est une réponse au chômage, même si cette réponse est imparfaite et ne se pose pas la question de la nature des emplois qui sont créés, de leur pérennité. Un élément du rapport HUREL nousinterpelle quand il s’agit d’avancer la création d’activité plutôt que d’entreprise. Cela sous-entend que l’activité économique réalisée peut être ponctuelle et susceptible de déboucher sur des emplois précaires dans le monde des entrepreneurs. Il faut dire que créer des entreprises en France n’est pas une démarche aisée pour plusieurs raisons :
une attitude négative dans notre pays face à l’échec en général et la faillite en particulier, il ne semble pas y avoir de droit à l’ erreur ou de seconde chance pour les créateurs français ;
l’argent est un élément tabou quand les américainsaiment se proclamer des money makers ;
les contraintes administratives apparaissent comme l’élément numéro un des freins à la création d’entreprise, juste avant les financements ;
les français préfèrent toujours le statut de salarié sécurisé par un CDI à toute autre forme d’emploi.
Pourtant, les TPE assurent une fonction essentielle de renouvellement du parc des entreprises dont DESCHAMPS (2000) et OSEO7 (2005) soulignent le vieillissement des dirigeants, et la nécessité d’inciter les porteursde projet à s’intéresser à l’idée de reprise et pas seulement à la création ex-nihilo. Il est vrai que ce renouvellement est rendu nécessaire par les nombreuses cessations d’activité qui, dans une approche écologique, peuvent constituer autant d’opportunités pour de nouveaux porteurs de projet. Notons que le nombre d’emplois reste relativement stable malgré la mortalité précoce de bon nombre de démarches. Les emplois perdus par les entreprises défaillantes sont compensés par les emplois créés au cours du développement des entreprises survivantes. L’intérêt politique est donc bien de « pousser » à la création d’entreprises. Les emplois ainsi générés semblent être pérennes, si l’on s’en tient aux chiffres des dix dernières années. La dimension politique est importante dans la volonté de lutter contre le chômage et de dynamiser la croissance car les 505 000 emplois directement induits par ces créations passeront à 520 000 à l’horizon 2010, les « surviva nts » ayant besoin d’embaucher.
Après le creux des années 90, les créations d’entreprises sont reparties nettement à la hausse pour atteindre le niveau record de l’année 2007 (321 478 entreprises nouvelles selon l’INSEE). Quatre éléments peuvent inciter lesparticuliers à créer leur entreprise.
Les alternances de périodes de croissance et de périodes de crise ou, plus précisément, de croissance molle caractéristique dela dernière décennie, représentent un contexte favorable à la création età la reprise d’entreprises. Il se caractérise par la propension des pouvoirs publics à mettre en place des éléments incitatifs forts comme les systèmes d’aides et d’accompagnement des créateurs et de repreneurs8. Héritée de la crise des années 70, cette optiquegouvernementale ne s’est jamais démentie et prend même une tournure plus active ces dernières années avec les Lois de Modernisation de l’Économie, et po ur les thèmes qui nous concernent la création d’un small business act à la française concrétisé par la commission STOLERU destinée à réserver une partie des marchés publics aux petites et aux moyennes entreprises.
Le taux de chômage persistant à des niveaux élevés est également une incitation à la création et à la reprise d’entreprise pour créer de fait son propre emploi. L’assouplissement des formalités relatives aux dossiers ACCRE9 a d’ailleurs permis une hausse très importante des créations d’entreprises par des chômeurs qui représentaient 40 % des créations et reprises d’entreprises en 2006.
La baisse du taux de chômage connue ces derniers mo is peut aussi avoir un effet incitatif. Elle peut, en effet, amener les chômeurs à considérer la création d’entreprise, particulièrement des TPE, comme un choix raisonnable. Ils sont tentés d’emboîter le pas des créateurs précédents, surtoutquand les taux de mortalité des entreprises diminuent, rendant la création apparemment moins risquée.
Pour MARCHESNAY (2003), les activités émergentes dece début de siècle nécessitent des entreprises de petite taille : le savoir, la santé, la culture, les loisirs, la communication. Si l’on regarde les statistiques de créations d’entreprise sur 2007, on constate que les créations relatives à l’éducation, à la santé et à l’action sociale se font à 96,3 % sans salarié. Ce chiffre est de 94,1 % dans l’immobilier et 92,3 % dans les services aux entreprises. Même l’industrie des biens de consommation est concernée avec 90,1 % . Ces éléments confirment les propos de l’auteur et mettent en évidence la prégnance des TPE dans des secteurs nouveaux.
Une hausse de la croissance serait de nature à enra yer d’une certaine manière ce processus : les entreprises dynamiques peuvent offrir de bonnes perspectives salariales à leurs employés « entreprenants » (BRUYAT, 1993, p 5).
Au-delà de la réforme annoncée du statut de l’auto-entrepreneur, il est important de proposer aux porteurs de projet les moyens de bâtir des entreprises solides mais également des projets susceptibles de voir le jour. Les idées sont d’améliorer la pérennité de l’entreprise par un financement suffisant et d’augm enter la natalité des organisations par leur financement initial. Le développement de l’accompagnement des porteurs de projet répond à cette problématique et semble porter ces ruits,f en atteste la baisse des procédures à l’encontre des entreprises défaillantes. Faisant l’objet de communications, cet accompagnement, plus ou moins orienté sur des publics spécifiques tels que l’entrepreneur immigré (LEVY-TADJINE, 2004), les femmes, les chômeurs, les jeunes, permet d’améliorer le suivi individuel des projets et est sans doute à l’origine de la baisse des défaillances constatées. Le partage des connaissances entre le porteur de projet et ces organismes permet d’éviter de nombreuses erreurs dans la préparation, puis dans la gestion de l’organisation.
L’implication politique est également forte au niveau du financement des porteurs de projet pour lesquels tout le monde s’accorde à dire qu’il est difficile, sans toujours préciser pourquoi. Est-ce l’obtention des ressources financières, le montage du business plan, la démarche bancaire dans sa globalité, la préparationde l’entretien avec un conseiller financier ? Les subventions apparaissent comme une source non négligeable de ressources palliant ou complétant les financements bancaires et l’autofinancement. Elles participent pour TROVATO et ALFO (2006) à un élément de politique économique pour compenser le manque de financements accordés aux nouvelles entreprises et leur permettre ainsi d’investir normalement. Ces subventions permettent, d’abord, aux entreprises d’avoir une activité normale et non pas sous-dimensionnée fautede moyens, les investissements nécessaires sont réalisés et amènent la rentabilitéattendue sur laquelle va pouvoir se construire la croissance de l’organisation. Une entreprise sous-dimensionnée va nécessairement limiter son activité et aura beaucoup de mal à capitaliser des résultats modestes nécessaires au financement du développement. Ces subventions permettent, également, de démarrer une entreprise quand les financements extérieurs et, en particulier, bancaires sont défaillants. Nous sommes face à deux problématiques différentes :investir suffisamment pour permettre une rentabilité correcte et un développement de l’organisation, et financer le départ d’une nouvelle activité.Les interventions de l’Etat dans le cadre du Prêt à la Création d’Entreprise et des contregaranties bancaires OSEO permettent aux entrepreneurs de trouver des financements suffisants et aux banques d’être sécurisées contre le risque de défaillance à trois ans, soit pendant la période de remboursement des prêts dont les durées standards ontv de trois à sept ans. L’Agence Pour la Création d’Entreprise (APCE), dans sa note annuelle 2007, prévoie que sur les 321 478 entreprises créées en 2007, 30 % ne passeront pasel cap des trois ans, soit plus de 110 000 cessations d’activités parmi lesquelles il est prudent de rappeler que toutes ne seront pas consécutives à une procédure judiciaire. L’appréhension des banques semble justifiée et la limitation de leurs prêts également.
Le PCE est un prêt de 2 000 à 7 000 € complétant les prêts bancaires dont le montant doit être au moins deux fois celui du PCE. Aucune garantie n’est demandée pour ce PCE, OSEO peut également garantir les prêts bancaires deà hauteur de 70 % dans le cas d’une création ex-nihilo, 50 % dans les autres cas.
Dans cette idée politique de pousser à la création d’entreprise, il apparaît important de favoriser la création d’entreprises quelle que soit la nature de l’activité ou de l’organisation impulsée. La volonté de simplification de l’idée d’entreprendre est vue comme globale avec la simplification des procédures de création, la simplification des obligations sociales et fiscales permettant de fonctionner aisément, la simplification des démarches individuelles avec le retour de l’entrepreneur individuel, l’auto-entrepreneur. Pour MORRIS (2002), tout le monde (ou presque) a un potentiel entrepreneurial qu’il faut éclairer et nourrir.
Dans ce cadre, simplifier les démarches entre le porteur de projet et les banques trouve naturellement sa place. Il semble intéressant, voire urgent, de donner aux porteurs de projet les outils pour comprendre ce que les banques attendent réellement. Les résultats attendus sont un taux de natalité d’entreprises en hausse et le maintien durable des emplois créés à cette occasion. La banque ne doit plus apparaître comme un obstacle insurmontable par manque de connaissance de cet obstacle. Les projets viables doivent pouvoir être financés quand une mauvaise communication avec les banques ne permet pas l’obtention des prêts. Nous nous attacherons à clarifier cette relation po ur la comprendre et pouvoir la transmettre.
I.1.2. La place de la TPE dans la littérature
Le monde de la petite et surtout de la très petite entreprise reste largement un mystère selon JULIEN et MARCHESNAY (1992). Pour MEIER et PACITTO (2007), la gestion de la TPE est une énigme. Pour MARCHESNAY (2003), il faut sortir de l’ignorance. Au cours de nos revues de littérature, nous n’avons trouvé que très peu de travaux relatifs à la nature de la TPE, à ce qui peut la définir comme un objet ontologiquement constitué sur lequel le chercheur va pouvoir travailler. Elle est longtemps restée dans l’ombre de la PME à laquelle de nombreuses démarches tant universitaires qu’émanant d’instances gouvernementales, l’ont associée. Quant il est fait mention de la TPE, c’est pour l’utiliser comme terrain de recherche et étudier d’autres phénomènes. Les contours de la TPE sont définis par des critères de taille, en supposant que celle-ci ait un effet direct et général sur la gestion de l’entreprise. Il nous semble utile de réfléchir également sur ce qui constitue ce terrain, quelle est la nature de la TPE. Qu’elle soit appréhendée comme objet, comme terrain ou comme champ de recherche, il est important de savoir de quoi l’on parle précisément.
Les éléments déclencheurs du renouveau de l’entreprise de petite taille, relatifs à un ralentissement économique et très bien illustrés par BRUYAT (1993), ont conduit à une mutation de l’économie avec le développement d’une segmentation fine des marchés. Deux économies se sont développées en parallèle a: productionl de masse sous le contrôle des grandes entreprises et la segmentation née de la personnalisation croissante des marchés et de l’accélération du changement (JULIEN,1997). Le développement des nouvelles activités de ce début de millénaire et lanotion de proximité qu’elles contiennent (services aux particuliers ou aux entreprises par exemple) corroborent la montée en puissance de la taille TPE. La théorie des interstices de PENROSE (1959) justifie l’existence de petits marchés soit très spécialisés, soit correspondant à une zone géographique limitée où les acteurs sont proches les uns des autres. Les changements enregistrés dans la constitution des marchés correspondent à un besoin de nouveauté et de différenciation de la part des consommateurs. Les petites structures semblent mieux adaptées pour répondre en premier, avant que les grandes entreprises ne se lancent. Ce qui caractérise l’entreprise de taille TPE, c’est la capacité du dirigeant à prendre des risques quand la démarche gestionnaire de la grande montre une réelle aversion à ce type de comportement. Les risques pris par les patrons de TPE concernent le lancement de nouveaux produits, le positionnement concurrentiel, l’approche du client, le financement… Les entrepreneurs de TPE se présentent comme ayant peu de ressources, mais il est clair qu’ils en font ce qu’ils veulent. Plus proche du co nsommateur, les TPE semblent plus à même de proposer de nouvelles solutions aux demandes sans cesse renouvelées. Le comportement des TPE apparaît comme fortement lié aux caractéristiques psychosociologiques du dirigeant qui entreprend, qui crée de l’instabilité dans un contexte contingent (JULIEN, 1997). La TPE n’est cependant pas un jouet subissant cette contingence de son environnement. Pour GUEGUEN (2004) les TPE peuvent avoir une démarche par rapport au marché, une influence qui esl place dans une approche volontariste au sein d’un environnement déterminant. L’entreprise prend un sens d’aventure et une dimension humaine forte où la réussite et l’échec seront vécus comme quelque chose de profondément personnel, d’autant plus que le projet correspond à un choix de vie dans lequel l’entrepreneur investit tout : son emploi, son métier, son épargne, sa vie de famille, sa réputation. Ces éléments nouspoussent à appréhender le caractère humain de la TPE, souvent mis de côté, car difficile d’accès. La dimension humaine, personnelle, de l’entrepreneuriat dans des entreprises de petite taille qui correspondent, nous l’avons vu, à la grande majorité des créations, ne peut être laissée de côté. Nous souhaitons, en effet, travailler sur une rencontre, un échange entre deux catégories d’acteurs incarnées par le porteur de projet et le conseiller financier. Il émane une grande richesse du caractère pluriel de cette population de créateurs - repreneurs dans laquelle on peut tout de même distinguer des régularités (JULIEN, 1997, p 316). Cette richesse provient de la diversité des profils des porteurs de projet et, également, des nécessaires échanges entre l’entreprise de petite taille et les ressources qu’elle va obligatoirement chercher à l’extérieur, n’en disposant pas à l’intérieur. Un article de CREMER13 (2007) parle à cet effet de porosité des frontières de l’entreprise qui tendent à s’estomper, certains émettant même des doutes sur la survie de la notiond’entreprise en tant qu’unité. Le porteur de projet apparaît comme un acteur interagissant avec d’autres, sans qui rien ne se fera. Dans notre démarche, nous avons affaire à la dimension humaine de l’entrepreneur et de sa confrontation avec un conseiller financier. Nous souhaitons comprendre ce qui ce passe lors de cette confrontation.
Pour parler de financement de TPE, nous devrons, d’abord, nous attacher à mieux cerner la TPE, à la spécifier comme forme, au sens de MARTINET (1990), sur laquelle nous pourrons construire notre travail. MARCHESNAY (2003) propose, face au manque criant de connaissances, de repartir d’observations empiriques et d’utiliser la méthode aristotélicienne des dyades qui impose de distinguer :
les entreprises déclarées et les autres, l’économiesouterraine étant évaluée à 10 % du PIB français 14, les activités marchandes et non marchandes, les TPE nucléaires et les TPE organisées, finalement tout ce qui peut rendre spécifique la TPE dans une approche écologique en la distinguant des autres espèces d’entreprises, et en distinguant les différentes familles d’organisations qui composent le genre TPE .
Sans entrer dans le monde de la complexité au sens de MORIN et préconisé par MARCHESNAY, nous positionnons clairement notre travail concernant l’approche TPE dans une volonté de la spécifier et de comprendre ons fonctionnement. Nous travaillons à partir des travaux sur la PME, pour dépasser les idées reçues et préciser ce qui peut l’être en l’état actuel de la recherche. C’est sans doute un chantier qui dépassera largement le cadre de notre présent travail doctoral, mais nous voulons poser ici notre pierre à l’édifice de la compréhension de cette réalité.
Pour conclure cette sous-section en donnant un poids à notre objectif, nous reprenons la conclusion de MARCHESNAY (2003), présentant un numéro de la Revue Française de Gestion consacré aux TPE : nous espérons que le lecteur en retirera une vision enrichie de …98,9 % des entreprises de notre pays.
I.1.3. Les particularités du financement des TPE
I.1.3.1. La frilosité des banques
Nous avons parlé plus haut de la frilosité des banques à l’égard du financement des créations de petites entreprises. Il est utile, pour bien comprendre le problème, de lui donner une dimension chiffrée (Figure I.0.3.).
SOMMAIRE
Introduction générale 9
Partie 1 : Spécification du financement d’une nouvelle TPE 37
Introduction de la Première Partie 38
Chapitre 1. Les TPE, de quoi parlons-nous ? 41

Introduction du chapitre 1 42
1.1.Vers une recherche sur les TPE 42
1.2.La nécessité de dépasser les définitions quantitatives de la TPE 50
1.3.Une approche qualitative de la TPE 57
Conclusion du chapitre 1 104
Chapitre 2. L’appartenance du projet de création de TPE au champ de l’entrepreneuriat 109
Introduction du chapitre 2 110
2.1.La population au cœur de notre réflexion 112
2.2.Porteurs de projet et processus entrepreneurial 118
2.3.Appartenance des TPE au champ de l’entrepreneuriat 131
Conclusion du chapitre 2 150
Chapitre 3. Positionnement épistémologique et cadre méthodologique 153
Introduction du chapitre 3 154
3.1.Une approche positiviste aménagée 155
3.2.Position méthodologique et intersubjectivité particulière 163
3.3.Un ensemble de propositions théoriques issues de l’expérience 175
3.4.Une méthodologie adaptée 191
Conclusion du chapitre 3 205
Conclusion de la Première Partie 206
Partie 2 : Vers une modélisation intersubjectiviste de l’entretien de financement 209
Introduction de la Seconde Partie 210
Chapitre 4. Origine et construction de l’objet de recherche 211
Introduction du chapitre 4 212
4.1.La demande de prêt 212
4.2.Une triple expérience professionnelle 218
4.3.Précisions de l’objet de recherche 230
4.4.Le terrain et les objectifs 249
Conclusion du chapitre 4 267
Chapitre 5 : Exploration et modélisation empirique 269
Introduction du chapitre 5 270
5.1.Exploration et méthodologies 270
5.2.Construction de notre terrain 281
5.3.Collecte de données 285
5.4.Exploitation des données 297
5.5.Résultats détaillés et modélisation empirique 310
Conclusion du chapitre 5 341
Chapitre 6 : La décision de financer une TPE, une question de confiance entre les parties prenantes343
Introduction du chapitre 6 344
6.1.La relation de confiance 346
6.2.Les conventions comme bases de la confiance 373
6.3.La théorie des parties prenantes 387
6.4.Modélisation théorique 392
Conclusion du chapitre 6 394
Conclusion de la Seconde Partie 396
Conclusion générale 397
C.1. Les apports de la recherche 401
C.2. Les limites de la recherche 410
C.3. Les voies de recherche futures 412
Bibliographie 415
Annexes 448
