L’economie sociale familiale dans le developpement rural
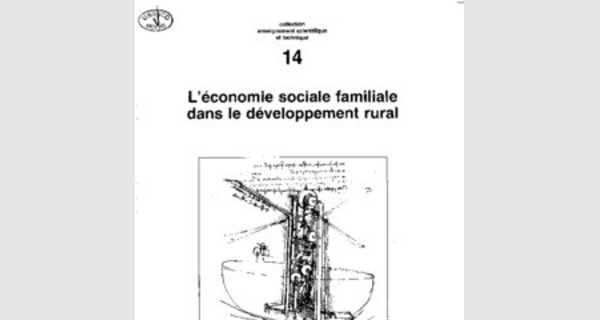
L’économie sociale familiale dans le développement rural
1. SITUATION DE L’ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE
a) EVOLUTION DE L’ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE DANS LES PAYS OCCIDENTAUX
Sans doute n’est-il pas inutile, pour présenter l’éducation en economie familiale rurale, d’en tracer un bref historique qui rende compte de son évolution - particulièrement en France - et la situe dans notre époque. Les mères ont, de tout temps, transmis à leurs filles leurs connaissances conernant la tenue de la maison, le travail sur l’exploitation agricole, les soins aux enfants et leur éducation. Fonctionnant en totale économie de subsistance, à des rythmes différents suivant les régions, les cellules familiales sont devenues des lieux d’activités multiples : ménagères, agricoles, artisanales. Plusieurs types de formation ont successivement tenté de répondre à l’évolution des besoins.
ECONOMIE DOMESTIQUE
L’économie domestique, science de la maison, a tout d’abord été l’apprentissage des travaux qui S’av&aient indispensables : cuisine et conservation des aliments, entretien de la maison et des vêtements, puériculture, jardinage et petits élevages, mais aussi soins aux troupeaux et activités de laiterie, productions agricoles . . . Une formation à caractère techniques et économique s’avèrait nécessaire, et s’y sont ajoutées, au fil des temps, des notions de gestion des ressources, d’économie de marché et d’organisation du travail. Seule une élite campagnarde pouvait en bénéficier. Cependant, le monde est en perpétuel changement : révolutions industrielles, accroissement de l’urbanisation . . . bouleversant les pays de façon plus ou moins rapide, plus ou moins aiguë, et partout l’équilibre des sociétés est compromis, l’inadaptation des systèmes économiques se fait sentir.
ENSEIGNEMENT MENAGER
L’Enseignement Ménager s’est alors adressé à une plus grande fraction de la population féminine dont on reconnaissait le rôle social et economique. La formation ménagère des jeunes paysannes se développe. Diminuer la fatigue des femmes, améliorer l’habitat rural, augmenter les revenus de la famille deviennent des impératifs. Il faut résoudre les problèmes nouveaux créés par l’exode rural et l’éloignement des générations. En ville, les femmes, trop vite entrées dans le monde du travail, n’ont pu s’initier au savoir-faire de leur mère. Elles sont désemparées face à une économie qui les oblige à acheter les produits que la famille ne fabrique plus. Par des formules appropriées, originales, (cours du soir ou sur les lieux de travail, sessions ambulantes, etc...) l’enseignement ménager a pris une dimension sociale. Actuellement les besoins des familles se sont considérablement uniformisés ainsi que les moyens utilisés pour les satisfaire, grâce à la facilité des échanges et à la rapidité des communications, du moins dans les pays fortement industrialisés.
ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE
Si certains problèmes restent toujours liés aux besoins vitaux : se loger, se nourrir, se vêtir, élever ses enfants et préserver sa santé, 1’Economie Sociale Familiale élargit toutefois sa recherche aux difficultés dues à l’environnement, à l’évolution technologique, aux relations entre générations et entre groupes sociaux . . . L’informatique est à l’horizon et transformera une fois de plus les modes de vie et les mentalités. L’Economie Sociale Familiale ne s’adresse plus exlusivement aux femmes.
Les méthodes pédagogiques ne sont plus les mêmes. Autrefois la monitrice montrait aux femmes ce qu’il fallait faire. Aujourd’hui elle essaie de rendre les familles aptes à trouver elles-mêmes leurs solutions. Hier elle travaillait seule dans un secteur féminin bien défini. Actuellement la conseillère agricole cherche à faire partie d’une équipe où se retrouvent travailleurs sociaux, agronomes, économistes, sociologues . . . et tous s’ingénient à replacer les problèmes dans leur contexte économique, social et culturel. C’est la famille tout entière (et non seulement la femme) qui devrait analyser ses difficultés et participer à la prise des décisions qui la concernent.
b) IMPLANTATION DE L’ECONOMIE SOCIAL FAMILIALE EN AFRIQUE
Une semblable évolution de YEconomie Sociale Familiale, dans ses objectifs et dans ses méthodes, a-t-elle pu être constatée dans les pays en développement? Quelle a été sa place, sa fonction économique, sa dimension sociale? Quelle est son ouverture aux problèmes actuels? Une telle étude exigerait des descriptions très nuancées, compte tenu du nombre et de la disparité des pays, des groups sociaux, de leur environnement, de leur histoire et de la diversité des institutions mises en place. Cependant on peut dire, de façon assez générale, que les premiers essais de formation féminine n’ont pas été demandés par la population concernée, en particulier par les paysannes. Ils ont été transposés de la ville à la campagne à partir du “modèle occidental”, celui de la femme dépendante du chef de famille réduite à des tâches d’épouse et de mère, auquel les organisations coloniales, puis l’assistance technique étrangère donnaient valeur universelle. Cette image acculait, quand elle ne le détruissait pas, le statut de la paysanne, et ignorait l’importance de son rôle économique. Les programmes, bien souvent copiés sur l’étranger, n’ont pas été adaptés aux conditions locales, ni aux mentalités, ni au pouvoir d’achat. Peu d’études ont été menées qui auraient dû permettre de comprendre les valeurs sociales, les coutumes, les modes de vie et les traditions, et auraient dû aider à l’expression des besoins, à la recherche de solutions et de formation adaptées.
LA VIE QUOTIDIENNE DES VILLAGEOISES AFRICAINES
Le rôle économique et social des femmes a-t-il jamais été reconnu? Ont-elles toujours été “les grandes oubliées du développement” comme l’indique le titre d’un article récemment paru (l)? Pourtant, dès le début de la colonisation, des études ethnologiques été réalisées, d’autant plus nombreuses que les sociétés observées semblaient originales à leur auteur. Cependant, leurs limites ont été bien précisées, lorsqu’il s’agissait des femmes :
“L’enquête ethnographique étant presque toujours menée à l’aide et auprès des seuls éléments masculins de la population, l’image qui en résulte se trouve être, dans une très large mesure celle que les hommes, et eux seuls, se font de leur société. Obstacles de la langue, du milieu, rapports entre dominés et dominants, la difficulté devient presque insurmontable, les femmes africaines réagissent d’abord par l’indifférence. Qu’importe l’opinion d’une étrangère qui, dès son arrivée, s’est située du côté des hommes. Que cette étrangère vienne ensuite trouver les femmes, accueil réservé ou franchement hostile, fin de non recevoir, trop souvent accueillera ses efforts.ff(2)
La vie des femmes est cependant bien observée et décrite, si elle n’est pas complètement comprise :
“Sur les femmes repose toute l’année la charge monotone des repas : corvée d’eau, quête du bois, pilage du grain, cuisson des aliments, leur prennent chaque jour plusieurs heures. Elles aussi travaillent la terre : les pluies venues, ce sont les femmes qui vont sarcler les terrains ensemencés, autant de fois qu’il est nécessaire, elles participent à la moisson. La ménagère apporte encore tous les éléments de l’indispensable sauce à l’huile de palme ou au beurre de karité, faite de poisson séché ou de feuilles, d’oignons, de tomates, de piment, qui vient relever la bouillie quotidienne à base de mil, le plat de riz, la purée d’ignames ou de manioc. Enfin, les réserves de grain épuisées, durant les semaines de soudure, ce sont les femmes qui nourrissent le ménage grâce aux tubercules plantés dans les jardins qu’elles entretiennent sur l’arrière des habitations. Si les provisions demeurent insuffisantes, elles y suppléent par leur achats sur le marché; mais pour pouvoir acheter, presque toutes les ménagères sont amenées à tenir un commerce, souvent minuscule, et préparent pour les vendre des beignets, des boules d’arachide pilées, du sel, du savon, des piments ou du tabac en poudre. Cette fréquentation des marchés les oblige à des trajets à pied souvent longs . . . Ce tableau ne rappelle guère celui de l’organisation domestique encore en vigueur dans les sociétés européennes où le mari subvient seul aux besoins du ménage, la femme demeurant au second plan, confinée dans la tenue de son intérieur. La femme africaine, dans le mariage, garde une vie indépendants. La présence des Européens, en apportant des conditions de vie nouvelle, a modifié la répartition des charges, le plus souvent au détriment des femmes . . . L’introduction de cultures nouvelles destinées à l’exportation a pu remplacer les soucis guerriers des hommes, les femmes n’y ont vu qu’un surcroît de besogne. L’exode parfois massif des jeunes gens ne laisse au village que les viellards et les femmes... Plus qu’aux droits reconnus par la coutume, l’influence des femmes tient à leur vitalité, à leur indépendance, à leur inépuisable énergie. Les conditions dans lesquelles elles sont élevées ne peuvant qu’accroître ces qualités naturelles.” (3)
Dès cette époque (nous sommes en 1960) la question alimentaire était posée, de vastes enquêtes étaient menées et des stations de recherche créées. Il peut sembler dommage que les programmes féminins s’en soient si peu inspiré, leurs responsables (missionnaires et femmes européennes, à l’origine) continuant à transposer le modèle occidental dans lequel la cuisine, la couture, le tricot . . . avaient une telle importance! Pourtant se mettaient en place des structures pour la santé des mères et des enfants, dans les villes et plus timidement dans quelques régions rurales pilotes. Elles ont largement contribué à diminuer la mortalité infantile, par un meilleur sevrage et une protection contre les maladies contagieuses. Devenus indépendants de nombreux pays ont organisé des services d’ “Animation des paysans” et la nécessité de la participation des femmes a été mise à l’ordre du jour.
“Les femmes ont-elles un rôle à jouer dans le développement? Il est probable qu’à une telle question il n’est aujourd’hui personne qui réponde par la négative. Et pourtant, quand on examine de près la politique menée par les différents pays de l’Afrique de l’Ouest pour aider réellement les femmes à jouer leur rôle on reste confondu par le décalage qui existe entre les discours et les faits. La plupart du temps, en effet, l’effort d’éducation et de formation féminine se limite aux actions entreprises par quelques Centres Sociaux qui ne s’intéressent qu’à un nombre réduit de problèmes dont il faut bien reconnaître qu’ils ne sont pas toujours les plus urgents et avec des méthodes dont le moins qu’on puisse dire est qu’elles ne sont pas toujours les plus adaptées.“(41)
L’INADAPTATION DES FORMATIONS FEMININES
Lorsqu’on analyse les échecs répétés d’actions de développement destinées aux femmes rurales, l’on constate :
- leur inefficacité par suite de l’inadaptation des programmes On a vu quelle a été l’influence de la projection de l’image de la femme urbanisée dans le monde rural. La formation des responsables é l’étranger ou dans des institutions trop souvent situées dans les villes y a aidé. Même si elles sont d’origine rurale, les jeunes cadres de 1’Economie Familiale sont souvent déformées par le long séjour urbain nécessaire é leur formation.
- la trop grande spécialisation des actions ponctuelles
Elles ont fait perdre de vue la globalité du développement : “Selon un plan établi à l’avance, l’agronome visite la famille paysanne et discute avec le mari, la nutritionniste ou l’infirmière parlent uniquement à la femme tandis que l’enfant reçoit des rudiments sur l’agriculture par son maître de classe. Les intéressés souhaiteraient s’entretenir ensemble avec les différents spécialistes, mais il n’ont aucun pouvoir pour modifier les programmes de formation offerts . . . formations conçues non pas pour répondre plus efficacement aux attentes de la population mais bien par conformisme aux habitudes occidentales qui ont inspiré le contenu de tels programmes. La marginalité economique et sociale augmente lorsque les plans de développement rural ne procèdent pas d’une vision globale du changement”.(5)
- le méconaissance de la vie des femmes de la campagne
Il est prioritaire pour qui veut travailler avec les femmes de la campagne d’élaborer avec elles des programmes de développement et de s’écarter des schémas de “famille nucléaire”, de “budget familial”. “On a parfois escompté que le développement rural, en augmentant les revenus des chefs de famille, entraînerait un mieux-être de la population. Or de nombreuses études montrent qu’il n’en est rien : l’enrichissement des chefs de famille va bien souvent avec une stagnation, ou même une dégradation des conditions de vie familiale supportée principalement par les femmes et les enfants. En effet, la famille africaine n’est pas un groupe social homogène et égalitaire disposant d’un “revenu familial” dont chacun profiterait selon ses besoins. C’est plutôt un assemblage de cellules dotées d’une certaine autonomie économique sous l’autorité du chef de famille. Selon la coutume, certaines charges et dépenses incombent au chef de famille : impôts, dépenses d’exploitation, logement, frais scolaires, parfois céréales pour la consommation familiale . . . D’autres incombent aux épouses : alimentation, habillement, santé et équipement domestique pour les membres de la cellule mère-enfant dont chacune est responsable. Ce sont les épouses qui doivent, par leurs activités propres, alimenter ce budget.“(6)
L’instabilité des unions, la polygamie, l’exode masculin sont des facteurs qui ajoutent à la complexité du groupe familial. Dans celui-ci chacun peut avoir une relative indépendance sur ses propres terres, organisant le travail, commercialisant la récolte et disposant du revenu, sans qu’il y ait toujours pouvoir unique de décision. Mais les coutumes déterminent tout un réseau de dons et d’échanges, resté fort dans certaines régions, complètement perdu ailleurs.
Les femmes n’ont pas la même “vision” du développement que les hommes. Le paysan est intégré à son village. Il vit sur des terres ancestrales. La paysanne s’installe au foyer de son mari. Mais elle reste très attachée à sa famille d’origine, y retourne lors des conflits et peut s’y rétablir définitivement si elle ne se remarie pas après un divorce ou un veuvage. Elle doit alors souvent quitter ses enfants, fixés dans la famille de leur père et lui restant très attachés sur le plan affectif, mais aussi économique. Un vie1 adage nigérien déclare : “la femme est mobile comme le feu, l’homme est stable comme les trois pierres du foyer”.
En outre la modernisation de l’agriculture a presque partout déstablisé le statut des femmes. Voici ce qu’en dit Marie Angélique Savané (7) Dans l’unité de production, l’encadrement agricole, la fourniture de semences, plants et engrais; les coopératives, les sociétés rurales, l’infrastructure commercial et l’organisation du marché ont été entièrement orientés vers les productions pour l’exportation. Cela a créé non seulement des distorsions économiques sur le plan régional mais aussi des discriminations sexuelles dans l’unité de production sur le plan du travail agricole : “l’introduction de méthodes technologiques et scientifiques dans l’agriculture a contribué souvent à la marginalisation des femmes. Les projets de développement, les services agricoles, la formation aux techniques de l’agriculture moderne et l’acquisition de machines et des terres ont été orientées principalement vers les hommes” (FAO, Rapport Commission statut de la femme, 1970)
En effet, dans l’économie de marché, l’unité de production devient vendeuse de force de travail et de marchandises. Mais les rapports de production “traditionnel” étant maintenus, c’est le chef de l’unité qui reçoit la rémunération du travail des femmes, des jeunes et de la clientèle. ffL’homme acquiert de nouvelles fonctions patronales comme ordonnateur du travail et dépositaire des gains de la famille, tandis que sa femme ou ses femmes prennent certaines des caractéristiques du prolétariat rural” (Revue internationale de travail, janvier 1977) D’autre part, les innovations techniques augmentent bien souvent les tâches des femmes. E. BOSERUP a constaté que : “Les femmes exécutent 55% du travail agricole dans un village traditonnel et 68% dans un village où on applique des techniques agricoles perfectionnées” (Woman’s role in economic development Londres : ALLEN & UNWIN, 1970.
Il est même apparu dans certains pays que l’introduction de nouvelles cultures, si elle accroît la participation des femmes à la main-d’oeuvre, n’accroît pas toujours leurs revenus. Les seuls efforts dirigés vers les femmes sont faits pour leur apprendre à mieux gérer la production familiale, à devinir de meilleures nutritionnistes et de bonnes couturières. Ce sont les fameux “projets féminins” dont le résultat est de renforcer la statut inférieur des femmes dans la production en les cantonnant dans les circuits de la production marchande (cf. Dossier FIPAD 14) Ainsi la modernisation crée au sein de l’unité de production des différences de productivité non seulement entre les hommes (chef de l’unité et les “cadets”) mais aussi avec les femmes, ce qui aggrave encore l’inégalité déjà existante, et renforce leur subordination dans la mesure où l’essentiel de leur travail n’étant pas rémunéré, est dévalorisé.” (7)
Connaître la famille rurale est donc une nécessité, mais elle ne peut se limiter à des études d’emplois du temps masculin et féminin. Il s’agit de cerner en profondeur les relations hommes-femmes-jeunes dans le contexte des générations, des réalités villageoises (échanges-dons), de comprendre les rôles traditionnels, leur évolution, de situer la richesse des valeurs dont est porteuse toute société et qui risquent de disparaître sous couvert de modernité. Tel est un des rôles essentiels de YECONOMIE SOCIALE FAMILIALE.
II. QUELQUES OBJECTIFS D’ACTION
“Dans sa recherche d’une organisation harmonieuse et efficace de la vie familiale en vue de satisfaire les besoins de chacun dans ses rapports avec la société, 1’Economie Sociale Familiale procède de la façon suivante:
- elle suscite une prise de conscience des situations, replacées dans leur contexte économique, social et culturel,
- elle participe à l’éveil des besoins d’information et de formation nécessaires aux choix et aux prises de décisions,
- elle aide à assumer les changements par acquisition de connaissances et de techniques, dans les domaines de la vie quotidienne”. (8)
Il a été vu combien l’application de modèles étrangers peut bouleverser un développement encore fragile, ou le freiner. Chaque pays doit établir ses lignes d’action et en privilégier tel ou tel aspect, qui se définit d’ailleurs davantage par des objectifs à atteindre que par une énumération de tâches. Il peut cependant être utile de dégager ici quelques suggestions d’orientation que des programmes nationaux pourraient retenir comme prioritaires. D’autres ne feront pas ces choix. Mais force est de constater que tous les domaines de la recherche en Economie Familiale ont entre eux de profondes interpénétrations. Ces suggestions concernent l’autosuffisance alimentaire des familles rurales, la technologie à mettre au service des villages, la recherche de revenus propres aux femmes.
“La contribution spécifique de 1’Economie Sociale Familiale consiste en sa possibilité de faire le lien entre les politiques globales de développement et l’individu au sein de la cellule familiale”. (9)
a) L’AUTO-SUFFISANCE ALIMENTAIRE DES FAMILLES RURALES “
Il est urgent d’insister sur une dimension trop souvent occultés par des instruments d’analyse et des démarches empruntés aux pays riches : le rôle capital des femmes dans le fonctionnement de nos systèmes alimentaires. Elles sèment, elles récoltent, elles transportent, elles stockent, elles vendent et elles transforment. L’importance de leur participation à chacune de ces étapes varie, bien sûr, d’un éco-système à l’autre; mais d’une façon générale elles sont présentes à tous les niveaux de la chaîne alimentaire, de l’instant où la semence est mise en terre au moment de la consommation. Ce constat mérite la plus grande attention. J’accorde toute leur importance aux causes habituellement soulignées et prises en compte: aléas climatiques, croît démographique, bas niveau technologique, politiques et pratiques agricoles. Mais pour une Afrique à la recherche de solutions nouvelles et adaptées, il importe au plus haut point de prendre en compte le travail des femmes.” (10)
