Consommation et l'epargne des menages cours facile
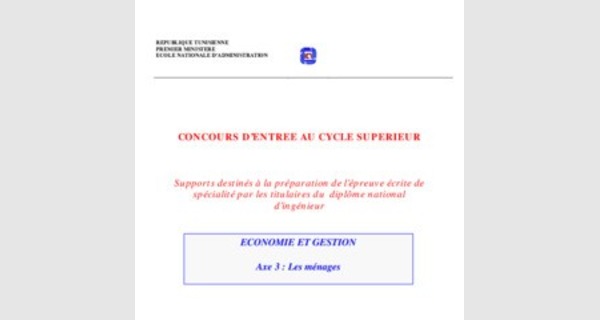
Consommation et l’épargne des ménages cours facile
3.2. LA CONSOMMATION ET L’EPARGNE DES MENAGES
3.2.1. Les notions de consommation et d’épargne
3.2.1.1. La notion de consommation
La consommation privée occupe une place particulière dans le fonctionnement de l'économie. Tout d'abord, il s'agit d'une composante particulièrement importante du PIB, considéré sous l'angle de la demande. Ensuite, elle présente un certain caractère de stabilité, par opposition aux investissements des entreprises, aux variations de stocks ou aux exportations, plus sensibles aux mouvements conjoncturels, mais aussi par rapport au revenu disponible. Aussi la consommation est-elle souvent perçue comme un facteur de soutien de l'activité, voire un amortisseur en période de faible croissance.
3.2.1.1.1. Définitions
La consommation est l'utilisation et la destruction des biens et des services afin de satisfaire des besoins. La comptabilité nationale, distingue deux types de consommation finale: la consommation finale des ménages ; appelée consommation privée et la consommation finale des administrations publiques ; appelée consommation publique. On s’intéresse dans ce chapitre à l’étude de la consommation finale des ménages.
3.2.1.1.2. Les formes de consommation
La consommation peut revêtir différentes formes. Ainsi, il est possible de distinguer entre plusieurs types de consommation dont les plus importants sont présentés dans ce qui suit.
Consommation finale et consommation intermédiaire
La consommation des ménages est dite finale car elle concerne des biens et des services qui satisfont directement leurs besoins (alimentation, vêtements, consultation médicale). La consommation des entreprises est dite intermédiaire car elle concerne des biens et des services utilisés pour produire d'autres biens et services (électricité, acier, verre).
Consommation individuelle et collective
¾ Une consommation individuelle satisfait un agent économique : le bien ou service consommé ne l’est que par un seul individu à l’exclusion de tout autre
¾ Une consommation collective satisfait de nombreux individus en même temps : un bien ou un service peut être consommé en même temps par plusieurs individus sans possibilité d’exclusivité, et ce, en leur permettant de satisfaire le même besoin.
Ce sont des consommations assurées par des organismes publics ou des collectivités locales: l'éducation nationale, transport en commun, une piscine municipale. Parfois ces services sont assurés par des établissements privés, par exemple les salles de spectacles privées (cinéma, théâtre).
Autres formes Comme la classification des biens, la consommation peut être :
¾ durable ou non durable : les biens non durables sont détruits dés la première utilisation (carburant, nourriture…) alors que les biens durables sont détruits progressivement (vêtements, voitures…) ,
¾ matérielle ou immatérielle : les biens matériels regroupent l’ensemble des biens alors que les biens immatériels constituent les services,
¾ marchande ou non marchande : tous les biens sont par nature marchands dans le sens ou ils sont échangés sur un marché à un prix couvrant au moins leur coût de production. Par contre, certains services ne sont pas marchands, soit parce qu’ils sont gratuits, soit parce qu’ils sont cédés à un prix inférieur à leur prix de revient.
3.2.1.2. Le concept d’épargne :
3.2.1.2.1. Définitions :
L'épargne des ménages est la part du revenu disponible non affectée à la consommation. L’épargne peut être considérée, également, comme une décision volontaire de mettre une certaine somme d’argent sur un compte en attente d’une future utilisation (exemple : constitution d’un plan d’épargne retraite). Le taux d'épargne se calcule ainsi :
…
Le patrimoine des ménages est l'ensemble de ses avoirs (actifs) moins ses dettes (passifs). Au sens usuel, le patrimoine c'est la richesse du ménage. C'est le résultat d'une accumulation de l'épargne. Economiquement, le patrimoine est un stock, alors que l’épargne est un flux.
3.2.1.2.2. Motivations de l’épargne :
On distingue trois motivations principales : l’épargne de précaution, l’épargne volontaire et l’accumulation du capital.
Épargne de précaution :
La majorité des ménages épargnent dans le but de se prémunir contre certains risques : maladie, retraite, chômage, vol ou toute autre dépense imprévue, et ce malgré l'existence d'organismes sociaux d'assurance et de compagnies d’assurance privée. Cette épargne est appelée épargne de précaution car elle est motivée par un besoin de sécurité.
Epargne volontaire ou consommation différée :
Les ménages épargnent pour réaliser un projet important et différent une consommation dans le futur : vacances, achat d'une automobile, achat d'un appartement par exemple. Ils peuvent, dans ce cas, définir d’avance le montant qu’ils devront épargner afin de disposer de la somme nécessaire au moment de l’achat. Dans certains cas, ils acceptent même de réduire leur train de vie et donc leurs consommations pour atteindre cet objectif. L’épargne ne doit alors plus être considérée comme un reste, une partie du revenu disponible non utilisée, mais au contraire comme une décision volontaire de mettre une certaine somme d’argent sur un compte en attente d’une future utilisation (exemple : constitution d’un plan d’ épargne retraite).
Accumulation de capital:
Certains épargnent pour accroître le patrimoine qu'ils transmettent à leurs enfants, ou pour le plaisir de s'enrichir, d'accumuler des richesses. Des ménages aisés placent une partie de leur épargne à la Bourse en achetant des actions ce qui peut leur rapporter beaucoup d’argent mais aussi leur en faire perdre. Tout dépend des risques qu’ils sont disposés à prendre.
3.2.1.2.3. Les formes de l’épargne :
On distingue classiquement deux formes d'épargne, l'une financière et l'autre non financière.
L’épargne financière : Elle comprend :
- les liquidités monétaires « inactives » (qui ne rapportent rien) : c'est la thésaurisation sous forme de « tirelire » ou « bas de laine » d'autrefois, le plus souvent maintenant, les sommes déposées sur des comptes courants bancaires ou postaux ;
- l'épargne liquide, c'est-à-dire l'argent placé à terme comme les livrets d’épargne bancaires (comptes spéciaux d’épargne, comptes d’épargne logement, le plus utilisé restant les livrets des caisses d'épargne ou les comptes épargnes des banques.
Tous ces comptes sont rémunérés selon les taux d'intérêt en vigueur ;
- les titres (actions et obligations) achetés sur le marché financier ou bien encore les SICAV (sociétés d'investissement à capital variable) ;
- la souscription de contrat d'assurance-vie auprès des compagnies d'assurances.
L’épargne non financière ou investie:
Elle comprend les achats de logements, maisons individuelles pour les ménages, et les achats de biens de production pour les entreprises individuelles. Les achats effectués sont ici considérés comme des investissements et non des consommations. Ces investissements nécessitent des sommes importantes au moment de l’acquisition qui doivent être amorties sur plusieurs années (exemple : le remboursement d’un crédit logement peut s’étaler sur 10 à 20 ans, parfois même plus).
3.2.2. Les déterminants de la consommation et de l’épargne des ménages
La consommation constitue une variable fondamentale en économie. Un certain nombre d’économistes se sont donc attachés à définir précisément la fonction de consommation. L’analyse de la fonction de consommation, d’un point de vue macroéconomique, est alors effectuée même si la consommation globale n’est que le résultat de l’agrégation des consommations individuelles des ménages.
Les facteurs qui influencent la consommation peuvent être classés en trois catégories :
- les facteurs économiques : le revenu, le prix, le crédit, la publicité, l'intervention économique de l'État (en matière de politique fiscale, de politique des revenus, de politique des crédits, etc.) ;
- les facteurs sociaux : la composition et la taille de la famille, l'âge et le sexe, l'intervention de l'État en matière sociale (politique familiale, protection sociale, retraite, etc.).
- les facteurs sociologiques :
- l'appartenance à un groupe social : le groupe social est formé des individus qui présentent des conditions économiques (niveau de revenu, patrimoine), des genres de vie (pratiques culturelles, politiques) et des valeurs identiques. Les agents se comportent en fonction de la position sociale qu'ils occupent.
- les modes de vie caractérisés par plusieurs éléments : le type d'habitat et le cadre de vie, le partage du temps entre travail et loisir, le type d'activité et les conditions de travail, le degré d'intégration sociale.
3.2.2.1. Le revenu disponible courant
L’économiste J.M. KEYNES a été le premier à formuler clairement une fonction de consommation à l’échelle macroéconomique et à lui donner une place prépondérante dans l’analyse économique. La théorie keynésienne considère qu’il y a une relation stable entre la consommation et le revenu disponible courant des ménages : C = f(Yd) ; avec C : consommation et Yd : revenu disponible courant Le revenu courant disponible a deux emplois : la consommation et l’épargne
Yd = C + S
Yd : revenu disponible courant, C : consommation, S : épargne
L’épargne est considérée comme la partie du revenu qui n’est pas consommée.
3.2.2.1.1. Les propensions moyennes
Le revenu courant disponible est la somme de la consommation et de l’épargne (Yd = C + S), il est intéressant de calculer et d’analyser le comportement de consommation et d’épargne des ménages sur la base des propensions moyennes :
La propension moyenne à consommer (PMC) :
La relation consommation / revenu est déterminée par la notion de propension moyenne à consommer. Cette propension moyenne à consommer se calcule en faisant le rapport entre consommation finale des ménages et leur revenu.
Elle détermine donc la part du revenu des ménages qui est consacrée à la consommation.
3.2.2.1.2. Les propensions marginales :
…
La propension marginale à consommer (c) : L’analyse keynésienne repose sur une approche dynamique de la fonction de consommation. Il s’agit d’analyser les variations de la consommation globale engendrées par la variation du revenu disponible des ménages. Keynes définit alors la propension marginale à consommer, qui détermine dans quelle mesure une variation des revenus à un impact sur la consommation finale.
…
3.2.2.1.3. La « loi psychologique fondamentale » de Keynes :
La relation entre la consommation et le revenu disponible courant est établie par Keynes en se basant sur ce qu’il appelle « la loi psychologique fondamentale » selon laquelle : « ... En moyenne et la plupart du temps, les hommes tendent à accroître leur consommation à mesure que leur revenu croît, mais non d’une quantité aussi grande que l’accroissement du revenu. »
La théorie de Keynes considère que lorsque le revenu s’accroît, la consommation augmente dans des proportions moins importantes. En d’autres termes, les ménages épargnent une part croissante de leur revenu au fur et à mesure que celui-ci s’accroît. Cette loi permet d’avancer trois principales caractéristiques de la fonction de consommation keynésienne :
1. La consommation des ménages est une fonction stable du revenu disponible courant.

2. La propension moyenne à consommer des ménages doit diminuer dans le temps avec l’augmentation des revenus.
3. A long terme, la propension moyenne à consommer va devenir inférieure à la propension marginale à consommer.
3.2.2.1.4. Expression de la fonction de consommation keynésienne :
Selon Keynes, la consommation dépend, avant tout, du revenu courant disponible. Des facteurs indépendants du revenu courant peuvent agir sur la consommation globale des ménages mais ils sont d’importance minime (le temps, le patrimoine, le niveau des prix, ...). Ces facteurs déterminent la consommation incompressible (consommation autonome au revenu).
…
Interprétation :
¾ Le point A représente le seuil d’épargne : Tout le revenu est consommé (Y= C) et par conséquent, le montant de l’épargne est nul (S= 0)
¾ A gauche du point A, la consommation (C) est supérieure au revenu (Y). Cet excédent de consommation est financé par l’épargne de l’agent économique (S)
¾ A droite du point A, la consommation (C) est inférieure au revenu (Y). En conséquence l’épargne est positive. Il s’agit d’une zone d’épargne.
3.2.2.1.5. Les limites de la théorie de la consommation:
Dans les faits, l’analyse keynésienne ne semble pas validée par les données économiques. A court terme, la propension moyenne à consommer peut connaître des variations en fonction entre autre du moral global des ménages. Par contre, sur le long terme, cette propension moyenne à consommer témoigne d’une certaine stabilité et il y a une égalité approximative entre la propension moyenne et marginale à consommer. Il n’y aurait donc pas tendance à une augmentation du comportement d’épargne de la part des ménages lorsque le revenu de ceux-ci augmente.
Les études en coupe transversale (basées sur les coefficients budgétaires), confirment l’hypothèse de Keynes selon laquelle les ménages épargnent d’autant que leur revenu est élevé. Cependant, il est difficile de transposer ce type d’étude dans le temps, notamment, sur de longues périodes. A la suite de Keynes, d’autres auteurs sont venus compléter l’analyse de la fonction de consommation en approfondissant la relation consommation / revenu.
3.2.2.1.6. Les améliorations postkéynessienne :
De nombreux travaux postkeynésiens ont cherché à expliquer la contradiction à laquelle aboutissent, d’une part, les analyses à court terme et en coupe transversale qui confirment la décroissance de la propension moyenne à consommer lorsque le revenu courant disponible augmente et, d’autre part, la stabilité de cette propension à long terme. Dans ce cadre, deux types d’analyses ont été proposées : L’économiste J. Duesenberry a proposé de remplacer le revenu disponible courant par le revenu relatif alors que l’économiste Brown a suggéré l’introduction des effets de retards dans la fonction de consommation.
Le revenu relatif:
Pour J. Dusenberry, la consommation, à une période donnée, dépend non seulement du revenu de cette période mais aussi des habitudes de consommation acquises antérieurement. Il insiste sur l’importance des facteurs psychologiques dans la fonction de consommation en mettant en avant le coté symbolique de la consommation à travers l’effet d’imitation ou de démonstration qui consiste à copier le style de vie de la classe sociale supérieure :
« Tout citoyen d'une classe sociale donnée tend à acquérir le comportement de la classe immédiatement au-dessus. ».
De ce point de vue, le club des « privilégiés » servirait de modèle de référence aux autres catégories sociales qui tentent de suivre ses dépenses lorsque leurs revenus augmentent ou lorsque la production de masse banalise les objets. Pour expliquer les fluctuations de la propension à consommer en courte période, l’auteur fait l’hypothèse d’une irréversibilité dans le temps des décisions de consommation « ou effet de cliquet »
Cet effet de cliquet peut se définir comme la tendance du consommateur à maintenir son niveau de consommation antérieur même en cas de baisse de son revenu. De ce point de vue, le consommateur peut même être amené à prélever sur son épargne. Ainsi, la fonction de consommation dépend du revenu courant et du revenu le plus élevé atteint par le passé. Elle prend la forme suivante : Ct = f(Yt, Ymax)
Ct = a Yt +b Ct-1 + u (1)
Avec :
Ct : la consommation courante
Ct-1 : la consommation de la période précédente
a : la propension marginale à consommer de court terme
b : coefficient associé à la consommation précédente
u : constante
La fonction de consommation de long terme est obtenue en tenant compte du coefficient d’augmentation de la consommation courante par rapport à la consommation précédente. Si la consommation augmente de g% par an : Ct = (1+g)Ct-1
3.2.2.2. La richesse ou le revenu permanent
La fonction de consommation proposée par Friedman s’appuie sur l’analyse intertemporelle des choix du consommateur (théorie microéconomique du consommateur) et prend en compte une nouvelle notion de revenu : le revenu permanent. Est-ce que les gens qui ont le même niveau de revenu ont aussi le même niveau de consommation réelle ?
3.2.2.2.1. La notion de revenu permanent :
Milton Friedmann est l'économiste le plus opposé qui soit au modèle keynésien. Il pense que le comportement du consommateur n'est pas lié au revenu qu'il perçoit à un moment donné mais au revenu qu'il prévoit. Le consommateur anticipe donc ses gains, et prend ses décisions d'épargne ou de consommation en tenant compte non seulement de son revenu actuel mais surtout de ses revenus futurs.
3.2.2.2.2. La décomposition du revenu :
Selon M. Friedman, il faut faire une distinction entre le revenu stable ou permanent sur lequel les individus peuvent compter avec une assurance et le revenu temporaire ou transitoire qu’ils peuvent recevoir de temps à autre. Ainsi le revenu courant se décompose comme suit : Y = Yp + Ytr
Les déterminants de la consommation permanente:
Friedman considère que le revenu permanent détermine une consommation théorique : la consommation permanente représentée par « la valeur des services que l’on prévoit de consommer durant la période considérée. » En s’appuyant sur la théorie des choix intertemporels du consommateur, Friedman considère que la consommation permanente est proportionnelle au revenu permanent : Cp = k Yp
Le paramètre k dépend du taux d’intérêt et de l’existence d’un capital non humain qui permet d’emprunter. Estimation de la consommation courante: Pour tester empiriquement la fonction de consommation, Friedman a estimé le revenu permanent à partir des revenus observés dans le présent et dans le passé avec une pondération décroissante à mesure qu’ils s’éloignent dans le temps : Yp = (1-λ) (Yt+ λYt-1+ λ2 Yt-2 + ……….+ λn Yt-n + ..........) 0< λ
<1 >
…
F. Modigliani introduit l’évolution du patrimoine et du revenu pour le choix de consommation tout au long de la vie d’un individu. D’où l’hypothèse du cycle de vie de la consommation selon laquelle l’individu cherche à stabiliser son niveau de consommation au cours de sa vie grâce à son patrimoine. L’hypothèse de cycle de vie permet de déterminer le niveau de consommation réelle à partir du comportement à long terme des ménages, ces derniers essaient de répartir leur consommation sur l’horizon temporel de la durée de la vie en étant soumis à la contrainte des ressources totales dont ils peuvent en disposer.
Table des matières
3.2. LA CONSOMMATION ET L’EPARGNE DES MENAGES ............... 3
3.2.1. Les notions de consommation et d’épargne ........................... 3
3.2.1.1. La notion de consommation ............... 3
3.2.1.2. Le concept d’épargne : ....................... 4
3.2.2. Les déterminants de la consommation et de l’épargne des ménages............... 6
3.2.2.1. Le revenu disponible courant ............. 7
3.2.2.2. La richesse ou le revenu permanent .............................. 14
3.2.2.3. L’âge et le cycle de vie :.................... 17
3.2.2.4. L’approche psychologique de la consommation:.......... 20
3.2.3. Niveau et structure des dépenses de consommation des ménages:................ 22
3.2.3.1. Les catégories de consommation.................................. 22
3.2.3.2. Les lois d’ENGEL............................ 23
3.2.3.3. La concentration des dépenses de consommation........ 24
3.2.4. Applications ..................... 26
3.2.5. Eléments de réponses.................................. 31
3.2.6. Bibliographie : ................. 36
3.3 LA DEMANDE D’UN BIEN.............. 37
3.3.1 . Fondement de la théorie du consommateur......................... 38
3.3.1.1. Théorie cardinale de l’utilité : ........... 38
3.3.1.2. La théorie ordinale de l’utilité : ............................ 43
3.3.2. Analyse de la demande du consommateur................. 53
3.3.2.1. Variation du revenu........................... 53
3.3.2.2. Variation du prix d’un bien ............... 66
3.3.2.3. Effet substitution-effet revenu........... 76
3.3.3. Application et corrigés............................... 84
3.3.4. Bibliographie : ................. 90
