Comptabilité générale cours
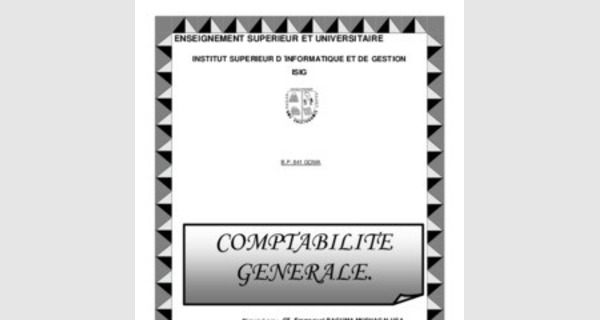
Participez au vote ☆☆☆☆☆★★★★★
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
INSTITUT SUPERIEUR D INFORMATIQUE ET DE GESTION
ISIG
DEVELOPPEMENT P R O F E S
ISIG
M A T I O N
B.P. 841 GOMA
COMPTABILITE
GENERALE.
Dispensé par : CT. Emmanuel BAGUMA MUSHAGALUSA
Appartenant à :
Année académique 2010 2011
2
AVANT-PROPOS
Réunis à Port Louis (île Maurice), des dirigeants africains ont signé, le 17 octobre 1993, le traité
de l Organisation pour l harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) dont le but, sur le plan
économique, est de promouvoir le développement et l intégration régionale ainsi que la sécurité
juridique et judiciaire dans l espace OHADA.
Ce traité vise à doter les Etats parties, seize à ce jour (Benin, Burkina Faso, Cameroun,
Centrafrique, Comores, Congo, Côte d Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale,
Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo), de règles communes, simples, modernes et adaptées à la
situation de leurs économies.
Les actes pris pour l adoption de ces règles communes sont appelés « Actes Uniformes ». Ils
sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties, nonobstant toute disposition de
droit interne antérieure ou postérieure contraire. C est ainsi que l Acte Uniforme portant organisation et
harmonisation des comptabilités des entreprises, auquel est annexé les système comptable OHADA,
a consacré un nouveau référentiel comptable dans les Etats signataires.
Cet Acte Uniforme est entré en vigueur le 1er janvier 2001 pour les comptes personnels des
entreprises et le 1er janvier 2002 pour les comptes combinés et les comptes consolidés.
Ce changement de référentiel comptable a crée un vide en matière d ouvrages didactiques pour
assurer la formation initiale et continue de comptables dans l espace OHADA. L objectif de cet
ouvrage est de contribuer à le combler.
Le premier tome, consacré à la comptabilité générale, commence par un rappel de la logique de
base du modèle, dans son articulation avec l activité de l entreprise, puis propose une présentation
générale du système comptable OHADA. Il est structuré en cinq parties :
Les techniques comptables de base du système OHADA ;
Les opérations du cycle d exploitation ;
Les opérations du cycle de trésorerie ;
Les opérations du cycle de financement ;
Les opérations du cycle d investissement.
Le deuxième tome est consacré aux systèmes comptables, aux opérations spécifiques et aux
travaux de fin d exercice.
Le troisième tome, qui traite de la comptabilité des sociétés, est structuré autour des centres
d intérêts essentiels, à savoir la constitution des sociétés commerciales et les modifications du capital.
Cet ouvrage, qui se veut complet, est assorti de nombreux exemples chiffrés d un ensemble de
questions de réflexion et d exercices pratiques judicieusement choisis et à la difficulté croissante, afin
de faciliter la compréhension et l assimilation des thèmes traités.
Fruit d une longue expérience pratique, cet ouvrage se voudrait le compagnon indispensable de
tous les apprenants en comptabilité et gestion, le précieux instrument de travail de tous les
professionnels de la comptabilité de tous ceux qui souhaitent actualiser leurs connaissances et mettre
en
uvre le système comptable OHADA.
3
PREMIERE PARTIE
LES SYSTEMES COMPTABLES
CHAPITRE I
LA PREPARATION DES ENREGISTREMENTS
4
L article 20 de l Acte Uniforme relatif au droit comptable OHADA stipule que « les livres
comptables et autres doivent être tenus sans blanc ni altération d aucune sorte ». le respect de ces
dispositions nécessite une préparation minutieuse des enregistrements et des autres actes
comptables. Cette préparation peut consister à faire des pré comptabilisations et/ou des pré
totalisations des pièces comptables avant leur enregistrement au journal.
1. LA PRECOMPTABILISATION
L expérience a montré que, pour éviter les erreurs, le travail d enregistrement dans le journal
doit être préparé.
Les erreurs du journal peuvent concerner :
soit les comptes qui doivent jouer : le compte débité ou le compte crédité est exact, ou parfois
même les deux ; ces erreurs dites d imputation faussent la comptabilité dans sa nature ;
soit des nombres : les erreurs numériques proviennent d une lecture erronée des données
chiffrées portées sur les documents de base (factures, reçus, chèques
) ; dans la pratique, pour
éviter ces erreurs, on procède à un premier enregistrement « pré comptabilisation »que l on confie
toujours à un comptable qualifié.
Document de
Précomptabili
Enregistreme
Report dans
base
sation
nt dans le
le grand livre
journal
L enregistrement des écritures dans le journal et dans le grand livre peut être ensuite fait par un
teneur de livre.
1.1. Principe de la précomptabilsation
La précomptabilisation consiste à indiquer sur le document de base ou sur une pièce spéciale
de précomptabilisation :
le ou les numéros de compte à débiter ;
le ou les numéros de compte à créditer ;
les sommes correspondantes.
C'est-à-dire les indications de base qui figureront dans l article du journal.
1.2. Technique de la précomptabilisation
Le travail effectué sur le document même est facilité par l apposition d un cachet (grille
d imputation) que l imputateur complète en inscrivant le numéro du document, les numéros des
comptes à débiter et à créditer, les sommes correspondantes.
APPLICATION
SODIP
Facture n° 705
Doit : Mbango
Date : le 13/02/N
5
Marchandises
150 000
Port débours
25 000
TVA 19,25% (de 150 000)
28 875
Net à payer
203 875
Présentez la grille de précomptabilisation sur cette facture chez Mbago.
SOLUTION
Facture d imputation
SODIP
Facture n° 705
Doit : Mbango
Date : le 13/02/N
Marchandises
150 000
Port débours
25 000
TVA 19,25% (de 150 000)
28 875
Net à payer
203 875
13/02/N
A 705
Grille d imputation
D
C
601
150 000
611
25 000
445
28 875
401
203 875
Cette grille joue ainsi le rôle de pièce comptable
1.2.2. Précomptabilisation sur pièces comptables spéciales (de petit format)
Dans ce cas, les éléments de base du futur article du journal sont inscrits sur la pièce conçue
pour effectuer la comptabilisation des documents de base.
Cette pièce peut se présenter comme suit :
Date
Nom du document de base/n° du document de base
N° fiche
Comptes
Sommes
N°
Intitulés
D
C
Visa du responsable
APPLICATION
6
Remplissez la pièce présentée ci-dessus avec les éléments de la facture de Mbango de
l application précédente.
SOLUTION
Date
Nom du document de base/n° du document de
N° Fiche
base. Document n° 705
13/02/N
Comptes
Sommes
N°
Intitulés
D
C
601
Achats de marchandises
150 000
611
Transports sur achats
25 000
4452
TVA récupérable sur achats
28 875
401
Fournisseurs, dettes en comptes
203 875
Visa du responsable
2. LA PRETOTALISATION
2.1. Fondement de la prétotalisation
Chaque jour, les services comptables sont conduits à enregistrer de nombreux documents
semblables entre eux.
Il en est ainsi, par exemple :
des factures d achat de marchandises ;
des factures de vente de marchandises ;
des chèques reçus des clients ;
des chèques émis.
L enregistrement dans le journal, document par document, constitue une tâche longue et
souvent fastidieuse. Pour faciliter la tâche aux comptables, on a mis au point la technique de
prétotalisation.
2.2. Principe de la prétotalisation
La prétotalisation consiste à regrouper sur une fiche conçue à cet effet les pièces comptables de
même nature d une période pouvant être une journée ou une semaine, dans le but de passer à la fin
de la période (journée/semaine) un article récapitulatif au journal.
La conception de la fiche de prétotalisation doit tenir compte des comptes mouvements lors de
l enregistrement des pièces comptables que l on veut regrouper.
2.3. Pratique de la prétotalisation
Etablissement d une fiche récapitulative
7
Si les opérations sont peu nombreuses, une fiche d imputation récapitulative peut être établie à
l aide d une additionneuse.
APLLICATION
Présentez une fiche de prétotalisation pour les six documents ci-dessous et passez au journal
l article récapitulatif dans
la comptabilité de Sodip.
SODIP
SODIP
Facture n° 719 Doit : Facture n° 720 Doit :
Date : le 22/02/N Dobili
Date : le 22/02/N KWEDI
Marchandises
200 000
Marchandises
300 000
Escompte 2%
4 000
Emballages
50 000
consignés
196 000
350 000
TVA 19,25%
37 730
67 375
TVA 19,25%
Port
20 000
25 000
Port débours
Net à payer par
253 730
442 375
chèque
Net à payer à crédit
SODIP
SODIP
Facture n° 721 Doit :
Facture n° 722
Doit :
Date : le 22/02/N
Mboma :
Date : le 22/02/N
Dotii
Marchandises
150 000
Marchandises
500 000
Escompte 2%
1 500
TVA 19,25%
96 250
148 500
Port débours
50 000
TVA 19,25%
28 586
Net à payer à crédit
646 250
Net à payer en
177 086
espèces
8
SODIP
SODIP
Facture n° 723 Doit :
Facture n° 724 Doit :
Date : le 22/02/N Bouba :
Date : le 22/02/N Ebanga :
Marchandises
100 000
Marchandises
180 000
Emballages consignés
50 000
Escompte
3 000
150 000
177 000
TVA 19,25%
28 875
TVA 19,25%
34 072
Net à payer
178 875
Net à payer
211 072
SOLUTION
Fiche de prétotalisation
Facture ventes de marchandises n° 719 à 724 journée du 22/02/N
N°
Noms
Comptes à débiter
Comptes à créditer
facture
des
clients
411
521
57
673
4191
443
701
781
719
Dobil
-
253
-
4 000
-
37 730
200
20 000
730
000
720
Kwedi
422
-
-
-
50 000
67 375
300
25 000
375
0O0
721
Mbona
-
-
1 500
1 500
-
28 586
150
-
000
9
722
Dotti
646
-
-
-
-
96 250
500
50 000
250
000
723
Bouba
-
178
-
-
50 000
28 875
100
-
875
000
724
Ebanga
-
-
3 000
50 000
-
34 072
180
-
000
Article récapitulatif
22/02/N
411
Clients
1 088 625
521
Banques
432 605
57
Caisse
388 158
673
4191
Escomptes accordés
8500
100 000
443
A Clients, dettes emballages
292 000
consignés
701
1 430 000
Etat, TVA facturée
781
95 000
Ventes de marchandises
Transferts de charges suivant
fiche
Transfert de prétotalisation facture
du 22/02/N
CHAPITRE II
LE CONTROLE DES ENREGISTREMENTS ET
LA RECTIFICATION DES ERREURS
Les erreurs peuvent êtres commises dans les documents de base, au journal, dans les grand
livre, dans la balance. C est pourquoi il est nécessaire de procéder de temps en temps au contrôle des
livres et autres documents comptables en vue de rectifier les éventuelles erreurs.
1. LES DIFFERENTS TYPES D ERREURS
1.1 Origines des erreurs
- Dans les documents de base eux-mêmes
Ces erreurs ne sont pas imputables au comptable mais au service ayant établi les documents
(facturier, caissier, magasinier
). Elles n en vicient pas moins la comptabilité. Aussi, le comptable
doit-il d abord s assurer de l exactitude des calculs arithmétiques des pièces de base.
10
- Les erreurs d imputation
C est le fait d enregistrer une opération dans le compte non adéquat.
- Les erreurs de calcul
Lorsque les opérations arithmétiques sont mal effectuées.
- Les erreurs d inversion de chiffres
Il s agit d un mauvais report du montant, on écrit par exemple 45 200 au lieu de 42 500 ;
- Les erreurs d omission
Quand on oublie d enregistrer une opération ou de reporter un montant.
- Les erreurs de double emploi
Lorsqu on enregistre une opération plusieurs fois par erreur ou que l on reporte un montant
plusieurs fois. Ces erreurs peuvent avoir une incidence arithmétique apparente ou non.
1.2. Incidence des erreurs
1.2.1. Erreurs ayant une incidence arithmétiques apparente
Ce sont :
les erreurs dans l inscription des sommes ;
les erreurs de totalisation ;
le report d un débit au crédit (ou réciproquement) ;
une omission de report ou un double report.
On les repère très rapidement grâce aux instructions de contrôle dont dispose la comptabilité.
Au niveau du journal :
Total débit = Total crédit (principe de la partie double)
Au niveau de la balance :
Total des soldes débiteurs = Total des soldes créditeurs
Total des mouvements débits = Total des mouvements crédits
Au niveau du journal et de la balance :
Total du journal = Total des mouvements de la balance.
Lorsque l une de ces égalités n est pas vérifiée, une erreur au moins a été commise dans la
comptabilité.
1.2.2. Erreurs n ayant aucune incidence arithmétique apparente
Ce sont généralement les erreurs d imputation.
Elles sont repérées très difficilement. Ce sont le plus souvent des événements extracomptables
qui permettent de les détecter.
11
Exemple : c est une réclamation ou une prestation d un fournisseur qui peut permettre de constater
qu une erreur d imputation a été commise au niveau des comptes fournisseurs.
1.2.3. Conséquences des erreurs
Toute erreur non corrigée se répercute dans les documents utilisés ultérieurement et toute la
comptabilité en est faussée.
Les erreurs sans incidence arithmétique apparente sont les plus difficiles à détecter, ce sont le
plus souvent des erreurs d imputation dans le journal. Ces erreurs sont les plus lourdes de
conséquences. Aussi l imputation au journal doit-elle être effectuée par un comptable qualifié et faire
l objet d un contrôle rigoureux.
2. LA RECTIFICATION DES ERREURS
l Acte Uniforme relatif au droit comptable OHADA indique clairement en son article 20 que
« toute correction d erreur s effectue exclusivement par inscription en négatif des éléments erronés,
l enregistrement exact est ensuite opéré ».
APPLICATION
On vous donne la facture suivante :
LADY M
Facture n° V-785
Date : le 15/7/N Doit: Le chic camerounais
Douala
Designation
Quantité
P.U
Montant
Robe x 210
8
25 000
200 000
TVA 19,25%
38 500
Net à payer
238 500
Le comptable a passé par erreur l écriture suivante :
15/7/N
411 Clients 238 000
701 Ventes de marchandises 38 500
4431 Etat, TVA facturée sur ventes 200 000
Suivant facture N°V 785
12
Rectifiez l erreur
SOLUTION
Annulation de l écriture erronée
15/7/N
411 Clients - 238 000
701 Ventes de marchandises - 38 500
4431 Etat, TVA facturée sur ventes - 200 000
Annulation de la facture erronée
On passe l écriture juste
15/7/N
411 Clients 238 500
701 Ventes de marchandises 200 000
4431 Etat, TVA facturée sur ventes 38 500
Suivant facture n° V 785
13
CHAPITRE III
LE SYSTEME CENTRALISATEUR
L une des insuffisances majeures du système classique est l existence d un journal unique qui
ne peut être tenu que par une seule personne, quels que soient le volume des pièces comptables à
enregistrer et el nombre de personnes travaillant au service comptable.
C est pour pallier cet inconvénient que l on a mis au point le système centralisateur. Celui-ci
préconise en effet la création de plusieurs journaux auxiliaires pouvant être tenus simultanément par
plusieurs personnes.
1. LE PRINCIPE DU SYSTEME CENTRALISATEUR
Les documents de base imputés sont classés de manière idéologique, c'est-à-dire par type
d opération (achats, ventes, mouvements de banque, effets de commerce
) puis repartis entre les
postes de travail qui correspondent aux journaux ouverts.
Le choix des journaux qu il convient d ouvrir dans une entreprise donnée est fonction de divers
éléments tels que l objectif du système d information de l entreprise, son organisation interne, le
volume des faits comptables, etc.
En général, les entreprises qui utilisent le système centralisateur ne demandent pas à leur
comptabilité la fourniture d informations très détaillées, leur plan de comptes étant réduit plus ou
moins au minimum légal.
Les journaux auxiliaires sont tenus chronologiquement. Tout mouvement intéressant un compte
individuel est inscrit dans ce compte, directement, et l écriture est alors décalquée dans le journal, par
report.
2. LE CHOIX ET LA PRESENTATION DES JOURNAUX AUXILIAIRES
Chaque type d opération fait toujours intervenir un même compte qui est soit débité, soit crédité
en contrepartie de plusieurs autres comptes.
14
Ce compte est appelé « compte support » ou « compte pivot ». le journal auxiliaire est souvent
désigné par le nom de compte support. Le tracé d un journal auxiliaire se déduit à partir des comptes
qui interviennent en contrepartie du compte support. Il suffit de déterminer l article type qui correspond
aux opérations couramment enregistrées dans le journal auxiliaire considéré.
A chaque compte correspond en principe une colonne unique, car il est soit débité, soit crédité.
Le nombre de colonnes est généralement restreint pour garder au journal des dimensions pratiques et
parce que les enregistrements très détaillés ne correspondent pas à l esprit du système d ouvrir une
zone « divers » comprenant deux colonnes destinées respectivement à l enregistrement de la somme
et à la désignation du compte.
Les comptes débités sont regroupés dans une zone, de même que les comptes crédités. En
général, c est la zone qui comporte le plus faible nombre de colonnes qui est disposée en premier.
Exemple : Présentation d un tracé de journal de banque. Voir page ci-
Contre
3. LES RISQUES DE DOUBLE ENREGISTREMENT
Chaque opération es enregistrée dans le journal auxiliaire adéquat. Cependant, certaines
opérations peuvent intéresser deux journaux auxiliaires. Pour éviter le double enregistrement, il
convient d utiliser le compte de liaison 58-Autres virements internes, en contrepartie du compte
support. La division de ce compte comprend :
585-Virement de fonds ;
588-Autres virements internes
512-Effets à l encaissement.
Lors de la centralisation, ce compte est soldé si les écritures ont été régulièrement passées.
Journal auxiliaire de banque-débit
Comptes à débiter
Comptes à créditer
Date
Libellés
Divers
52
67
58
Sommes N°
Journal auxiliaire de banque-débit
Comptes à débiter
Date
Libellés
Divers
52
77
58
Sommes N°
15
4. LA TENUE DES LIVRES AUXILIAIRES
4.1.
Liste des principaux journaux auxiliaires
Journal auxiliaire caisse-débit
Journal auxiliaire caisse-crédit ou journal unique de caisse
Journal auxiliaire banque-débit ou journal unique de banque
Journal auxiliaire banque-crédit
Journal auxiliaire chèques postaux-débit
ou journal unique chèques postaux
Journal auxiliaire chèques postaux-crédit
Journal auxiliaire achats à crédit ou achats à crédit et au comptant
Journal auxiliaire des effets à recevoir-entrées (412 débit)
Journal auxiliaire des effets à recevoir-sorties (412)
Journal auxiliaire des effets à payer-sorties (402 crédit)
Journal auxiliaire des effets à payer-entrées (402 débit)
Journal auxiliaire des opérations diverses
La solution à relever est fonction des besoins de l entreprise. Le journal des opérations diverses
enregistre toutes celles qui ne trouvent pas leur place dans un autre journal.
4.2.
Enregistrement des achats
Les achats peuvent être réglés au comptant ou à terme (crédit). Les enregistrements des
achats au comptant diffèrent selon la définition du journal auxiliaire des achats.
Journal des achats à crédit
Tous les achats à crédit de biens et services sont enregistrés dans le journal.
Les achats réglés comptant sont enregistrés dans le journal auxiliaire de trésorerie concerné.
Cette solution est simple, elle évite l emploi d un compte de virement interne mais ne donne pas
une vue d ensemble des achats et de la TVA déductible.
Journal des achats à crédit et au comptant
Tous les achats sont enregistrés dans ce journal quel que soit le mode de
règlement.
Les règlements au comptant par chèque ou en espèces sont enregistrés
dans le journal auxiliaire de trésorerie concerné au crédit du compte
support par le débit :
du compte 401-Fournisseur si un compte individuel est ouvert au nom de ce
fournisseur (ne pas oublier le report dans le compte individuel)
du compte 58-Autres virements internes ou des sous-comptes fournisseurs
16
comptant ou achats comptant dans le cas contraire
5. LA CENTRALISATION PERIODIQUE
5.1.
Fondement juridique
D après l article 5 du décret comptable du 29 novembre 1983, les écritures portées sur les
journaux et les livres auxiliaires doivent être centralisées une fois par mois au moins dans le livre
journal et dans le grand livre. Ce sont en effet les mouvements des comptes durant la période qui sont
notés dans le journal général.
5.2.
Livre journal
En fin de période, à la fin du mois en général, toutes les colonnes des journaux auxiliaires sont
totalisées. Après vérification de l égalité : total des colonnes débit=total des colonnes crédit, et
rectification des erreurs constatées, les opérations de la période, enregistrées dans chaque journal
auxiliaire, sont centralisées dans le livre journal en un seul article.
Cependant, les avoirs enregistrés dans les journaux auxiliaires des achats ou des ventes
peuvent être enregistrés en un article particulier.
Les colonnes diverses doivent être ventilées suivant les comptes mouvementés avant la
centralisation.
Le tracé du livre journal est en général celui du journal classique à deux colonnes de sommes.
Le livre journal doit être coté et paraphé par le greffier du tribunal de commerce.
5.3.
Grand livre
Les comptes du grand livre sont mis à jour par report du livre journal. Cependant le décalqué
peut être utilisé. Les relevés nominatifs clients et fournisseurs permettent la vérification de
concordance entre les grands livres auxiliaires et les comptes collectifs des tiers, clients, fournisseurs,
salariés du grand livres général.
La balance mensuelle est établie à partir des comptes du grand livre général.
Schéma du système centralisateur
A INSERER PAGE 32
6. LA COMPARAISON ENTRE LES SYSTEMES
Voir tableau ci-contre
Système
Classique à
Classique à journal divisionnaire
Centralisateur
Principaux caractères
journal unique
Enregistrement chronologique
Le compte
Le compte
Le journal
auxiliaire
Mise à jour des comptes
Journal et
Journaux divisionnaires et comptes
Journaux
17
compte
auxiliaires et
comptes
individuels
Plan de compte détaillé possible
Permanente
Permanente
En fin de période
Information de synthèse à partir du
Oui
Oui en multipliant les colonnes de
Oui en multipliant
journal
ventilation
les colonnes de
ventilation
Qualification des teneurs des livres
Non
Regroupement des opérations dans
Dispersion des
les JD
informations
concernant un
même compte
Charge de travail pour un volume
Elevée
Manipulation des comptes généraux
Moyenne
donné des faits comptables
en fin de séquence
Volume des faits comptables pouvant
Manipulation
Elevé, fonction de la division des
Manipulation
être traités
des comptes
journaux et du niveau de
limitée aux
généraux,
mécanisation
comptes
lourdeurs des
individuels en
reports si par
cours de période
décalqué
Qualités
Faible, journal
Fourniture des informations
Elevé, fonction
unique ; goulot
détaillées de synthèse à jour
des J.A ouverts
d étranglement
et du niveau de
mécanisation
Limites antérieures à l utilisation de
Simplicité
Lourdeur de la manipulation des
Informations
l informatique
relative de la
comptes, onéreux
limitées par jour
mise en
uvre
Avenir
Ne convient
L informatique supprime les
Devrait être
qu à une petite
inconvénients
compromis par le
entreprise
développement
de l informatique
APPLICATION
La comptabilité de l entreprise Sodip est tenue suivant le système centraliseur. Les journaux
auxiliaires ouverts dans cette entreprise sont les suivants :
- J.A. de caisse-recettes/J.A de caisse-dépenses ;
- J.A. de banque-débit/J.A de banque-crédit ;
- J.A. de CCP/JA. Des achats de marchandises ;
- J.A. de ventes des marchandises ;
- J.A. des effets à recevoir-entrées et sorties ;
- J.A. des effets à payer-sorties et entrées ;
- J.A. des opérations diverses.
Enregistrez les documents ci-dessous dans les différents journaux
concernés.
Centralisez-les au journal général.
18
ETS ETAME
Chèque n° 3410N
Facture n°25 Doit :
BDF : 200 000
Date : le 05/10 Sodip
Ordre : Ngake
Motif : sa facture du 20/07
Marchandises
500 000
Date : 02/10
TVA 19,25%
96 250
Net à payer en espèces
596
250
ETS SODIP
Chèque n° 3942N
Facture n°v 01 Doit :
BPF : 1 200 000
Date : le 07/10 Ekwalla
Ordre : Ngake
Marchandises
800 000
Motif : Achats marchandises au
comptant
Escompte 2%
16 000
Date : 20/10
784 000
7. L ETUDE DES JOURNAUX AUXILIAIRES DES EFFETS DE COMMERCE
7.1.
Journal auxiliaire des effets à recevoir
Ce journal enregistre les mouvements des comptes 412-Clients effets à recevoir et 511-Effets à
encaisser.
Ce journal peut être subdivisé en deux :
le journal auxiliaire des effets à recevoir-entrées ;
le journal auxiliaire des effets à recevoir-sorties
Journal auxiliaire des effets à recevoir-entrées
Il enregistre les effets à recevoir qui entrent en portefeuille, notamment :.
des effets négociés (remis à l escompte à la banque) ;
des effets remis à l encaissement ;
des effets encaissés directement par l entreprise ;
des effets endossés au profit des tiers par l entreprise ;
des effets à recevoir annulés avant ou après l échéance.
19
APPLICATION
La comptabilité de Sodip est tenue selon le système centralisateur. Le chef comptable met à
votre disposition les informations ci-dessous :
- 05/10 Traite n° 30 tirée sur le client Théo 75 000FCFA
- 07/10 Traite n° 22 endossée à l ordre du fournisseur Manga 150 000 FCFA
- 10/10 Traite n° 40 remise à l encaissement à la BICEC 350 000 FCFA
- 15/10 Remise à l escompte traite n° 34 400 000 FCFA
- 18/10 Billet à ordre n°54 du client Zock 300 000 FCFA
- 25/10 Encaissement direct ce jour traite échue 100 000 FCFA
Enregistrez ces opérations dans les journaux auxiliaires suivants :
Effets à recevoir-entrées et Effets à recevoir-sorties
SOLUTION
Journal auxiliaire des effets à recevoir-entrées
Compte à
Compte à
débiter
créditer
Dates
N° Pièces
Tirés
Echéances
Lieu de
paiement
412
411
5/10
T-30
Théo
-
-
75 000
75 000
18/10
B-54
Zock
-
-
300 000
300 000
375 000
375 000
7.2.
Journal auxiliaire des effets à payer
Compte
Comptes à débiter
à
Dates
Libellés
créditer
Divers
412
401
512
415
588
Sommes
N°
07/10 Endos T22
150 000
150 000
-
-
-
-
-
10/10 T40
remise
à
350 000
-
350 000
-
-
-
-
l encais.
15/10 Remise
400 000
-
400 000
-
-
-
escompte T34
25/10 Encais. Direct
100 000
-
-
100 000
-
-
20
100 000
150 000
350 000
400 000
100 000
Ce journal enregistre les acceptations écrites ou tactiles de paiement par lettres de change
tirées par les fournisseurs et autres créanciers ou les souscriptions de billets à ordre. Il peut se
subdiviser en deux :
journal auxiliaire des effets à payer-sorties ;
journal auxiliaire des effets à payer-entrées.
Journal des effets à payer-sorties
Les traites tirées sur l entreprise par les fournisseurs et autres créanciers
acceptés.
Les billets à ordre souscrits par l entreprise à l ordre des fournisseurs et
autres créanciers.
Journal des effets à payer-entrées
Les traites tirées sur l entreprise et les billets à ordre souscrits par cette dernière à l échéance
rentrent dans l entreprise pour y demeurer sous forme d archives. Ce sont :
les effets à payer réglés à l échéance par l entreprise ;
les effets domiciliés échus ;
les effets à payer annulés avant ou après l échéance.
APPLICATION
- 05/04 Acceptation de la lettre de change n° 42 du fournisseur Sodip au 30/04, 500 000 FCFA
(domiciliation SGBC Bali)
- 08/04 Souscription à l ordre du fournisseur Sogelec du billet à ordre n° 111 au 15/05,
340 000FCFA.
- 11/04 Règlement par chèque de la traite n° 13 du fournisseur Ngake, 200 000 FCFA
- 20/04 Avis de débit de la BICEC relatif aux effets domiciliés Dobo, 250 000 FCFA.
- 22/04 Annulation de la traite n° 34 par le fournisseur Dobo, 140 000 FCFA.
Enregistrez les opérations ci-dessus au journal auxiliaire des effets à payer-sorties et au
journal auxiliaire des effets à payer-entrées des Ets Etame.
SOLUTION
Journal auxiliaire des effets à payer-sorties
Comptes
Comptes
à créditer à débiter
Dates
N°
des Tireurs
ou Domiciliation Echéance
effets
bénéficiaires
402
401
21
05/04
42
Sodip
SGBC
30/04
500 000
500 000
08/04
111
Sogelec
-
15/05
340 000
340 000
840 000
840 000
Journal auxiliaire des effets à payer-entrées
Compte à
Compte à créditer
débiter
Dates
Libellés
Divers
402
588
401
Sommes
N°
11/04
Règlement effet n°13
200 000 200 000
-
20/04
Domiciliation échue
250 000 250 000
-
22/04
Annulation traite n°34
140 000
-
140 000
590 000 450 000
140 000
8. LE CAS PARTICULIER DU JOURNAL DES OPERATIONS DIVERSES
Les opérations n intéressant aucun journal auxiliaire de l entreprise sont enregistrées dans le
journal auxiliaire des opérations diverses. Le journal des opérations diverses se présente comme le
journal classique. Dans ce journal, il n ya donc plus risque de double enregistrement et les comptes
585 et 588 ne sont plus utilisés.
22
CHAPITRE IV
GENERALITES SUR LES TRAVAUX DE FIN D EXERCICE
1. PRESCRIPTIONS LESGALES
On définit l exercice comptable comme la période s écoulant entre deux inventaires annuels.
L exercice correspond donc à douze mois d activité.
Au terme de l article 9 du Code de Commerce, le commerçant est tenu de faire un inventaire
annuel des éléments actifs et passifs composant le patrimoine de son entreprise. Cet inventaire doit
être recopié dans un livre d inventaire coté et paraphé.
2. CLASSEMENT DES TRAVAUX DE FIN D EXERCICE
Du point de vue comptable, la fin d exerce entraîne une série de travaux importants
généralement désignés par l expression « inventaire comptable ».
La chronologie de ces travaux est la suivante :
vérification de l exactitude arithmétique de la comptabilité au moyen d une balance avant
inventaire ;
après une série d opérations matérielles telles que le comptage des stocks et leur valorisation,
l inventaire des immobilisations et le calcul des amortissements, le pointage des droits, créances,
obligations et dettes, il y a la passation d écritures de redressement destinée à ajuter les comptes ;
écriture de détermination du résultat des activités ordinaires, du résultat hors activités
ordinaires et du résultat net ;
23
nouvelle vérification d exactitude arithmétique de la comptabilité par l établissement d une
balance après inventaire ;
établissement des états financiers de fin d exercice qui sont :
le compte de résultat
le bilan ;
le tableau financier des ressources et des emplois ;
l état annexé ;
clôture des livres et des comptes.
CHAPITRE V
L AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS
1. LA NOTION D AMORTISSEMENT
1.1.
Définition de l amortissement
Selon le système comptable OHADA, l amortissement est la constatation comptable d un
amoindrissement de la valeur d une immobilisation, qui se déprécie de façon certaine et irréversible
avec le temps, l usage ou en raison du changement de techniques, de l évolution des marchés ou de
toute autre cause.
Amortir, c est repartir le coût du bien sur la durée probable d utilisation.
Seules les causes de dépréciation irréversible donnent lieu à des
amortissements. En conséquence, parmi les immobilisations corporelles,
seules celles qui s usent normalement au cours du temps doivent être
amorties.
1.2.
Calcul de l amortissement
Dans chaque pays, l administration fiscale communique, pour les différents biens
d amortissables, les taux et les méthodes d amortissement à pratiquer. Le taux et la durée
d amortissement devraient être fixés en fonction des conditions d utilisation du marché.
Un bien complètement amorti mais toujours utilisé par la société doit continuer à figurer au
bilan.
Par exemple, au Cameroun, seule la méthode d amortissement linéaire est admise par
l administration fiscale.
1.3.
Durée d utilisation
24
On détermine pour chaque bien pris individuellement une durée normale d utilisation. Les
durées de vie les plus couramment admises sont :
pour les bâtiments de 20 à 25 ans ;
pour les matériels et outillages, de 10 à 12 ans ;
pour les matériels et mobiliers de bureau, 10 ans ;
pour les véhicules de transport, 5 ans.
On considère qu à la fin de cette durée normale d utilisation le bien n a plus aucune valeur.
En conséquence, la totalité de la valeur d entrée du bien doit être dépréciée (amortie) sur la
durée normale d utilisation.
1.4.
Amortissement annuel (ou annuité d amortissement)
Chaque année, la somme portée en amortissement est égale à :
Valeurd ' entrée
Amortissement annuel =
Duréedevie
Exemple : Déterminons les caractéristiques de l amortissement pratiqué par l entreprise Dobill sur la
voiture Peugeot 106 acquise le 1er janvier N pour un prix d achat de 15 000 000 FCFA.
- Détermination de la durée normale d utilisation : s agissant d une voiture particulière, on retiendra
une durée normale de 5 ans, soit n=5.
- Détermination de l amortissement annuel (ou annuité d amortissement = a)
15000000
Amortissement annuel =
= 3000000FCFA
5
Soit a = 3 000 000 FCFA
1.5.
Taux d amortissement
Si la durée de vie exprimée en années est égale à n, on peut calculer le taux qui est appliqué
chaque année pour calculer l amortissement annuel soit :
00
1
Taux d amortissement =
n
Exemple : Reprenons l exemple de la voiture acquise par l entreprise Dobill sachant que la durée de
vie probable n = 5.
- Détermination du taux d amortissement annuel :
1
Taux d amortissement annuel =
= ,
0 20 soit 20%
5
- Détermination de l amortissement annuel (annuité d amortissement = a)
Amortissement annuel = 15 000 000 x 20% = 3 000 000
Soit a = 3 000 000 FCFA
25
On en déduit que :
A = Valeur d entrée x Taux d amortissement
1.6.
Valeur comptable nette
Val
eur
nette = - -
Somme des amortissements
comptable à une
pratiqués jusqu à cette date
date donnée
Valeur d entrée
(amortissements cumulés)
On veut vérifier que, selon le système de calcul des amortissements annuels, toutes les
annuités d amortissement sont égales entre elles ; elles sont constantes. Ce procédé de calcul de
l amortissement est appelé le système de l amortissement constant (ou linéaire).
Exemple : le schéma de l amortissement linéaire de la voiture se présente ainsi (valeur d entrée
= 15 000 000 FCFA) :
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
Années
N N+1 N+2 N+3 N+4
1.7.
Plan d amortissement ou tableau d amortissement
Pour chaque bien faisant partie du patrimoine de l entreprise, on établit un plan d amortissement
qui se présente sous forme de tableau.
Exemple : le plan d amortissement de la voiture est le suivant :
TABLEAU A INSERER PAGE 70
Pour un bien acquis en début d exercice, le nombre de lignes du plan d amortissement est égal
à la durée de vie du bien.
1.8.
Cas particulier : immobilisation acquise en cours d exercice comptable
Lorsqu une immobilisation est acquise en cours d exercice comptable, on doit calculer la
première annuité d amortissement prorata temporis, c'est-à-dire proportionnellement au temps écoulé
entre la date de la mise en servie de l immobilisation et la date de clôture de l exercice.
26
Exemple : Le Cabinet AECC a acquis le 1er juillet N un meuble de rangement pour une valeur
d origine de 1 690 000 FCFA.
Déterminons les caractéristiques de l amortissement de ce bien.
- Durée normale d utilisation : s agissant de mobilier de bureau, on retiendra une durée normale
de 10 ans, soit n = 10.
- Taux d amortissement annuel : taux d amortissement = 1/10 = 0,10 soit taux = 10%.
- Une annuité d amortissement normale = a ; amortissement annuel = 1 690 000 x 10% =
169 000, soit a = 169 000 FCFA.
- La première annuité d amortissement doit être réduite prorata temporis.
Entre la date d acquisition (1er juillet) et la date de clôture de l exercice (31 décembre), il s est
écoulé six mois. La première annuité d amortissement doit donc être proportionnelle à cette durée,
soit :
6
A1 = 169 000 x
= 84 500
12
Le plan d amortissement du mobilier de bureau se présente ainsi :
PLAN D AMORTISSEMENT
Nature de l immobilisation : Mobilier de bureau, armoire de rangement
Valeur d entrée : 1690 000 FCFA
Date d acquisition : 01/07/N Durée de vie : 10 ans
Années
Base à amortir
Annuité
Valeur nette comptable
d amortissement
en fin d exercice
N
1690 000
84 500
1 605 500
N+1
1690 000
169 000
1 436 500
N+2
1690 000
169 000
1267 500
N+3
1690 000
169 000
1 098 500
N+4
1690 000
169 000
929 500
N+5
1690 000
169 000
760 500
N+6
1690 000
169 000
591 500
N+7
1690 000
169 000
422 500
N+8
1690 000
169 000
253 500
N+9
1690 000
169 000
84 500
N+10
1690 000
84 500
0
27
La première annuité n ayant pas été complète, il a été nécessaire de calculer une annuité
supplémentaire en fin de durée de vie du bien, pour que le montant total des amortissements
amène la valeur nette comptable à zéro. Un bien acquis en cours d exercice a un plan
d amortissement qui comprend une ligne de plus au tableau que sa durée de vie normale.
1.9.
Système d amortissement dégressif
Les marchés des biens d occasion montrent que la dépréciation est plus forte en début qu en fin
de vie des biens. L amortissement de dépréciation devrait donc être dégressif.
1.9.1. Principe
L amortissement est calculé& comme dans le système constant sur la base de la durée de vie
probable du bien.
Le taux d amortissement à appliquer est obtenu en appliquant au taux d amortissement
constant un coefficient ainsi qu il suit :
Durée de vie
3 à 4 ans
5 à 6 ans
+ de 6 ans
Coefficient
1,5
2
2,5
Lorsque l immobilisation est acquise au cours de l exercice, la première annuité est calculée
au prorata temporis, c'est-à-dire proportionnellement au nombre de mois entiers à courir depuis le
début du mois au cours duquel le bien a été acquis, jusqu à la fin de l exercice.
Lorsque l annuité dégressive devient inférieure à l annuité constante calculée sur la valeur
comptable nette en fonction du nombre d années d amortissement restant à courir, l entreprise
pratique un amortissement égal à cette annuité constante.
1.9.2. Immobilisations amortissables au systèmes dégressif
Seuls peuvent bénéficier de l amortissement dégressif :
les immobilisations dont la durée de vie est supérieure ou égale à 3 ans ;
les biens d équipement et bâtiments industriels à l exclusion des voitures de tourisme, les
machines à écrire, les bâtiments administratifs ou commerciaux ;
ces équipements doivent être neufs, ce qui exclut les biens d occasion.
APPLICATION
Immobilisation acquise au début de l année
Soit un matériel industriel acheté le 5 janvier N au prix de 5 000 000 FCFA et mis en service le
même jour (durée de vie du matériel 5 ans).
Présentez le plan d amortissement de ce matériel (système dégressif).
SOLUTION
Immobilisation acquise au début de l année
28
100
Vo = 5 000 000 ; n = 5 ans ; TL =
= 20%, TD = 20 x 2 = 40%.
5
Taux
Valeur nette
comptable
Années
Base à
Linéaire Dégressif
Annuités
Cumul des
amortir
amortissements
N
5 000 000
20%
2 000 000 2 000 000
2 000 000
3 000 000
N+1
3 000 000
20%
1 200 000 1 200 000
3 200 000
1 800 000
N+2
1 800 000
20%
720 000
720 000
3 920 000
1 080 000
N+3
1 080 000
20%
540 000
540 000
4 460 000
540 000
N+4
540 000
20%
540 000
540 000
5 000 000
0
Immobilisation acquise au cours de l exercice
Taux
Valeur nette
comptable
Années
Base à
Linéaire Dégressif
Annuités
Cumul des
amortir
amortissements
N(5mois)
5 000 000
20%
40%
500 000
500 000
4 500 000
N+1
4 500 000
20%
40%
1 800 000
2 300 000
2 700 000
N+2
2 700 000
20%
40%
1 080 000
3 380 000
1 620 000
N+3
1 620 000
50%
50%
810 000
4 190 000
810 000
N+4
810 000
100%
100%
810 000
5 000 000
0
1.9.3. Quelques formules de calcul
Soit le tableau d amortissement dégressif ci-après avec :
Vo = Valeur d origine
i = taux dégressif
100
Années
Base à amortir
Annuités
Valeur nette comptable
1ère
Vo
Voi
Vo(1-i)
2ème
Vo (1-i)
Vo(1-i)I = Voi (1-i)
Vo(1-i) - Voi (1-i)
= Vo((1-i)2
29
3è
Vo (1-i)2
Vo (1-i)2i = Voi (1-i)2
Voi (1-i)2
Nème
Vo (1-i)n-1
Voi (1-i)n-1
Voi (1-i)n
Les valeurs comptables nettes successives forment également une progression géométrique
décroissante de raison (1-i). A ce titre nous aurons
1ère année : VCN1 = Vo(1-i)
2ème année : VNC2 = VNC2 (1-i) = Vo (1-i)2
3ème année : VNC3 = VNC3 (1-i)2 = Vo (1-i)3
4ème année : VNC4 = VNC4 (1-i)3 = Vo (1-i)4
N° année: VNC n = VNC n-1 (1-i) = VNC1 (1-i)n-1 = Vo (1-i)n
1.10.
Amortissement dérogatoire
Définition
C est l amortissement ou fraction d amortissement ne correspondant pas à l amortissement
normal pour dépréciation et comptabilisé en application de textes particuliers.
Comptabilisation
La différence entre l amortissement normal de dépréciation et l annuité d amortissement,
considérée comme amortissement dérogatoire, est créditée au compte 151-Amortissements
dérogatoires, par le débit du compte 851 Dotations aux provisions réglementées.
Les amortissements dérogatoires sont classés en provisions réglementées (compte 15). Ils
figurent parmi les capitaux propres.
Ces amortissements ont un caractère de réserves.
Amortissement pour dépréciation
6813 Dotation aux amortissements sur immobilisations X
28 Amortissements X
Constatation de l annuité normale
Amortissement dérogatoire
851 Dotation aux provisions réglementées X
151 Amortissements dérogatoires X
Constatation de l amortissement dérogatoire
30
Sortie du bien de l actif ou reprise des amortissements dérogatoires
151 Amortissements dérogatoires X
861 Reprise des provisions réglementées X
Reprise des amortissements dérogatoires
APPLICATION
La société Sodip achète le 1er juillet N pour 6 000 000 FCFA un logiciel informatique dont la
durée d utilisation est de 3 ans. Elle désire pratiquer l amortissement dégressif sur le plan fiscal alors
que le plan d amortissement pour dépréciation a prévu le système linéaire. L entreprise décide
d utiliser la facilité fiscale lui permettant d amortir le logiciel en 12 mois.
Etablissez un tableau d amortissement faisant ressortir l amortissement fiscal, économique et
dérogatoire.
SOLUTION
A partir de ces données, on peut établir un tableau faisant ressortir pour chaque exercice :
- l amortissement fiscal (colonne b) ;
- l amortissement pour dépréciation (colonne b)
- la dotation aux amortissements dérogatoires (colonne c)
- la reprise sur amortissements dérogatoires (colonne d)
Exercice
Amortissement fiscal (a)
Amortissement
pour Amortissement
dépréciation
(économiquement dérogatoire
justifié)
Dotation
Reprises
s
D=(b)-(a)
C=(a)-(b)
N
6
1
6
2 000 000
6 000 000 x
= 3 000 000
6 000 000 x
x
=1 000 000
12
3 12
N+1
6
1
1 000 000
6 000 000 x
= 3 000 000
6 000 000 x
= 2 000 000
12
3
N+2
1
2 000 000
6 000 000 x
= 2 000 000
3
N+3
1
6
6 000 000 x
x
=1 000 000
3 12
31
Total
6 000 000
3 000 000
3 000 000
Ecriture à la clôture de l exercice N
681 Dotation aux amortissements d exploitation 1 000 000
2813 Amortissement des logiciels 1 000 000
Amortissement pour dépréciation
31/12/N
851 Dotation des provisions réglementées 2 000 000
151 Amortissement dérogatoires 2 000 000
Amortissements dérogatoires
Ecriture à la clôture de l exercice N+2
31/12/N
681 Dotation aux amortissements d exploitation 2 000 000
2813 Amortissement des logiciels 2 000 000
Amortissement pour dépréciation
31/12/N+2
151 Dotation des provisions réglementées 2 000 000
861 Amortissement dérogatoires 2 000 000
Amortissements dérogatoires
1.11.
Autres systèmes d amortissement
Les autres systèmes d amortissement sont :
l amortissement accéléré ;
l amortissement en série ;
l amortissement réel.
2. LA COMPTABILISATION DES AMORTISSEMENTS
32
Le compte 68-Dotation aux amortissements enregistre les charges calculées de la période. Ce
sont des amortissements économiques et comptables, non des amortissements fiscaux.
2.1.
Charges immobilisées
Le système comptable OHADA impose la pratique de l amortissement direct pour les charges
immobilisées.
ecomptable
Valeurnett
L annuité se calcule ainsi : a =
riodesres
Nombredepé
tan tàcouvrir
La dotation aux amortissements est enregistrée comme suit :
D 68.1 Dotation aux amortissements d exploitation C D 20 Charges immobilisées
C
X X
APPLICATION
Le 05/09/N, M. Ngamby crée une société dénommée Gab s et Fils. Pour la constitution de cette
société, les frais suivants ont été engagés :
- frais de constitution 300 000 FCFA.
- frais de publicité et de lancement 500 000 FCFA.
Passez les écritures d inventaire au 31/12/N ; taux d amortissement : 25%.
SOLUTION
Frais de constitution
4
300 000 x 25% x
= 25 000 FCFA
12
Frais de publicité
4
500 000 x 25% x
= 41N666 FCFA
12
Notons qu entre le 01/09/N et le 31/12/N, il y a exactement 4 mois écoulés.
681 Dotation aux amortissements d exploitation 66 666
2011 Frais de constitution 25 000
2013 Frais de publicité 41 666
Constatation de la dotation de l exercice
2.2.
Immobilisations incorporelles et corporelles
Pour ces éléments d actif, le système OHADA recommande un amortissement indirect.
33
Dotations récurrentes (activités ordinaires)
On passe :
D 68.1 Dotation aux amortissements d exploitation C D 28.1 à 28.4 Amortissement C
X X
APPLICATION
Cas 1 : LE 01/01/N, la société MAD a acheté un brevet 3 000 000 FCFA par chèque.
Passez les écritures d inventaire se rapportant au brevet (taux d amortissement pratiqué
20%) au 31/12/N
Cas 2 : Le 01/01/N, la société MAD a acquis un bâtiment industriel au prix de 20 000 000 FC ;
durée de vie : 20 ans.
Passez les écritures d inventaire au 31/12/N.
SOLUTION
Cas 1
- Calcul de l amortissement : 3 000 000 x 20% = 600 000 FCFA
- Ecriture d amortissement :
681 Dotation aux amortissements d exploitation 600 000
2812 Amortissement des brevets, licences 600 000
Concessions et droits similaires
Cas 2
- Calcul de l amortissement :
1
Taux d amortissement :
= 0,05 = 5%
20
Amortissement de l exercice : 20 000 x 5% = 1000 000 FCFA
- Ecriture d amortissement
681 Dotation aux amortissements d exploitation 1 000 000
2831 Amortissement des bâtiments industriels 1 000 000
Constatation de l amortissement
Dotations non récurrentes (hors activités ordinaires)
34
C est le cas d une dépréciation résultant d une destruction accidentelle ou d une restructuration
de l entreprise.
L écriture dans ce cas est la suivante :
D 85.2 Dotation aux amortissements HAO C D 28.1 à 28.4 Amortissements C
X X
CHAPITRE VI
LES SORTIES DES IMMOBILISATIONS DE L ACTIF
35
Les sorties des immobilisations de l actif peuvent se faire selon trois précédés qui sont :
la cession ;
la mise au rebut ;
l échange.
1. LA CESSION D ELEMENTS D ACTIFS IMMOBILISES
Une cession est classée en activité ordinaire lorsqu elle est faite par une
Entreprise qui, du fait de son activité, renouvelle fréquemment ses immobilisations (loueurs de biens,
transporteur, etc.).
La cession d éléments d actifs immobilisés peut être une activité ordinaire, c'est-à-dire
récurrente, ou hors activité ordinaire, c'est-à-dire exceptionnelle.
1.1. Cession d une activité ordinaire
Principe de comptabilisation
La comptabilisation se fait en quatre étapes : la première à la date de cession de
l immobilisation et les trois autres à la fin de l exercice pour régularisation.
1ère étape : Enregistrement du prix de cession
5. Comptes de trésorerie X
414 Créances sur cession d immobilisations X
754 Produits des cessions courantes d immobilisations X
4431 Etat, TVA facturée sur ventes X
Cession
Enregistrement d éventuels frais de cession
632 Rémunérations d intermédiaires et de conseils X
5. Comptes de trésorerie X
Frais de cession
2è étape : Régularisation de la cession en fin d exercice : dotations complémentaires
aux amortissements.
681 Dotation aux amortissements d exploitation X
36
28 Amortissements X
3è étape : Régularisation de la cession en fin d exercice : annulation du total des
amortissements jusque-là constatés
28 Amortissements X
654 Valeurs comptables des cessions courantes X
Annulation des amortissements jusque-là constatés
4è étape : Régularisation de la cession en fin d exercice : sortie d actif de la valeur
d origine
654 Valeurs comptables des cessions courantes X
2. Comptes d actifs immobilisés X
Annulation de la valeur d entrée de l immobilisation
APPLICATION
Le 30 novembre N, une entreprise de location de véhicule a cédé au prix de 1 616 000 FCFA
HT une Peugeot 405 acquise le 20 juillet N-2 à 4 000 000 FCFA HT à une entreprise située dans une
zone franche industrielle.
Procédez à la régularisation de la cession au journal.
SOLUTION
4000000x20 11
x
- Calcul des amortissements :
= 733 333
1200
- Amortissements déjà pratiqués ou amortissements antérieurs (A A) du 20/07/N-2 au 31/12.N-
4000000x20 18
x
1 : AA =
= 1 200 000
1200
- Total des amortissements : 1 200 000 + 733 333 = 1 933 333
- Valeur nette comptable : 4 000 000 1 933 333 = 2 066 667
- TVA initialement déduite : 4 000 000 x 19,25 % = 770 000
2
- TVA due : 770 000 x
= 308 000
5
Cession
37
5211 Banque SGBC 2 000 000
754 Produits de cession courante 1 616 000
4431 Etat, TVA facturée sur ventes 311 080
Cession de la Peugeot 405
Régularisation en fin d exercice
6813 Dotation aux amort. Des immo. Corporelles 733 333
2845 Amort. Matériel de transport 733 333
Dotation complémentaire de l exercice
2845 Amort. Matériel de transport 1 933 000
654 Valeur compt. De cession cour.d immo. 1 933 000
Amortissements cumulés
654 Valeur compt. de cession cour.d immo. 4 000 000
2451 Matériel automobile 4 000 000
Sortie de l immo. du patrimoine
654 Valeur compt. De cession courante d immo. 308 000
4441 Etat, TVA due
Pour régularisation TVA non amortie
En général, à la date de cession, le comptable n enregistre que les écritures de constatation de
la cession. Les autres écritures sont enregistrées à l inventaire.
Pour les cessions d immobilisations totalement amorties, l enregistrement comptable est le
suivant :
Sortie de l immobilisation
654 Valeur compt. De cession courante d immo. X
2. Comptes d actifs immobilisés X
38
Sortie de l immo. du patrimoine
Cession de l immobilisation
5 Comptes de trésorerie X
414 Créances sur cession d immobilisations X
754 Produits des cessions courantes d immo. X
4431 Etat, TVA facturée sur ventes X
Cession
1.2. Cession d une opération hors activités ordinaires
C est le cas général de la cession des titres de participation et des autres immobilisations
corporelles et incorporelles des entreprises dont l objet n est pas cette activité.
1.2.1. Cas des immobilisations corporelles et incorporelles
La comptabilisation se fait en cinq étapes.
Ière étape : Enregistrement de la cession
5. Comptes de trésorerie X
485 Créances sur cession d immobilisations X
82 Produits des cessions courantes d immo. X
4431 TVA facturée sur ventes X
Cession
2è étape : Dotation complémentaire
681 Dotation aux amortissements d exploitation
28 Amortissements
Dotation complémentaire aux amort.
3è étape : Annulation des amortissements complémentaires et antérieurs
39
28 Amortissements
81 Valeurs comptables des cessions d immo.
Annulation des amortissements cumulés
4è étape : Sortie de l immobilisation de l actif
81 Valeurs comptables des cessions d immo.
2. Immobilisations
Annulation des amortissements cumulés
5è étape : Enregistrement des frais de cession
83 Charges hors activités ordinaires
5. Comptes de trésorerie
Frais de cession
APPLICATION
Le 1er janvier N+3, date de sa création, la société Matalucam a acheté un matériel industriel au
prix de 20 000 000 FCFA HT, régulièrement amorti au taux de 20%. Le 1er juillet N, suite à la décision
de la société d abandonner la branche d activité non productive qu assurait ce matériel, il est cédé au
prix hors taxes de 8 000 000 FCFA.
Passez l écriture de cession
Passez l écriture d inventaire
SOLUTION
- Amortissement complémentaires du 01/01/N au 01/07/N
20000000x20x6
AC =
= 200000
1200
- Amortissements antérieurs du 01/01/N-3 au 31/12/N-1
20
AA=20 000 x
x3 = 12000000
100
- Valeur nette comptable : 20 000 000 14 000 000 = 6 000 000
- TVA initialement déduite : 20 000 000 x 19,25% = 3 850 000
40
1
- TVA due : 3 850 000 x
= 770000
5
Cession
485 Créance sur cession d immo. 9 540 000
822 Produits de cession d immo. corpo. 8 000 000
4431 Etat, TVA facturée sur ventes 1 540 000
Cession du matériel industriel
Régularisation de fin d exercice
681 Dotation aux amort. d exploitation 2 000 000
2841 Amort. du matériel et out. Com. 2 000 000
Dotation complémentaire de l exercice
2841 Amort. du mat. et out. Com. 14 000 000
812 Val. compt. des cessions d immo. 14 000 000
Annulation amort. antérieurs
812 Val. Comptables des cessions d immo. 20 000 000
2411 Matériel industriel 20 000 000
Sortie de l immo. du patrimoine
812 Val. Vomptables des cessions d immo. 770 000
4441 Etat, TVA due 770 000
Pour régularisation de la TVA non amortie
1.2.2. Cas des cessions des titres de participation et autres immobilisations financières
Enregistrement du prix de cession
5. Comptes de trésorerie X
485 Créances sur cession de titres de placement X
826 Produits de cession d immo. financières X
4431 TVA facturée sur ventes X
Cession
Sortie des titres de l actif
816 Valeurs comptables des cessions d immo. finan. X
41
26/274 Immobilisations financières X
Sortie des titres de l actif
Si une provision avait été constituée pour les titres, elle doit être annulée
296(7) Valeurs comptables des cessions d immo. finan X
796(7) Prov. Pour dépréciation des immo. finan X
1.2.3. Cas des cessions des titres de placement
Les titres de placement sont composés des titres, des biens, des actions et des obligations
détenus par l entreprise. Ils sont enregistrés dans le compte 50-Titres de placement et font partie de la
trésorerie.
Principe comptable
Préalablement à l enregistrement, il est important de calculer arithmétiquement le résultat
réalisé sur la cession des titres. Ce résultat est enregistré au crédit du compte 777-Gains sur cessions
de titres de placement, ou au débit du compte 677-Pertes sur cessions des titres de placement.
Ecriture comptable
Perte
CHAPITRE VII
LES PROVISIONS ET LES CHARGES PROVISIONNEES
1. LES PROVISIONS
Les provisions concernent généralement la constation comptable de la dépréciation probable
mais non irréversible du patrimoine de l entreprise.
Ce sont les dépréciations enregistrées des comptes de la classe 2 (comptes d immobilisations)
et les provisions financières pour risques et charges à long terme (classe 1).
1.1. Provisions financières pour risques et charges
42
Ces provisions correspondent à des charges ou pertes prévisibles à la clôture de l exercice,
précises quant à leur nature, leur objet, mais incertaines quant à leur montant ou à leur réalisation
prévisible à plus d un an.
1.1.1. Comptabilisation
Les provisions pour risques et charges sont comptabilisées selon l échéance du dénouement du
risque ou de la charge (moins d un an ou plus d un an). Les provisions sont comptabilisées en vertu
du principe de prudence.
Risques à moins d un an
6591 Charges provisionnées d exploitation pour risques à court terme X
6791 Charges provisionnées financières sur risques financiers X
839 Charges provisionnées HAO X
4991 Risques provisionnés sur opérations d exploitation X
4998 Risques provisionnés sur opérations HAO X
Risques à plus d un an
6911 Dotations aux provisions d exploitation pour risques et charges X
6912 Dotation aux provisions d exploitation pour grosses réparations
6971 Dotations aux provisions pour risques et charges
854 Dotations aux provisions pour risques et charges HAO
191 Provisions pour litiges
192 Provisions pour garanties accordées aux clients
193 Provisions pour pertes sur marchés à achèvement futur
194 Provisions pour perte de change
195 Provisions pour impôts
196 Provisions pour pensions et obligations similaires
197 Provisions pour charges à repartir sur plusieurs exercices
198 Autres provisions financières pour risques et charges
1.1.2. Les provisions pour charges
Elles correspondent à des charges prévisibles qui, étant donné leur nature et leur importance,
pourraient difficilement être supportées pour le seul exercice au cours duquel elles seront engagées.
Le plus souvent, il s agit de provisions constituées en prévision de grosses réparations.
APPLICATION
Suite à un affaissement de terrain, les murs d un important bâtiment commercial se fissurent et
devront être reconstruits dans les deux ou trois années à venir. La dépense liée à la réfection du
43
bâtiment est estimée approximativement à 15 000 000 FCFA. Le gérant décide d étaler la charge
future sur les trois années prochaines à raison de 5 000 000 FCFA par an.
Au cours de l année N+3, les travaux sont effectués et le 18 juillet la facture définitive est reçue.
Elle s élève à 18 000 000 FCFA hors taxes.
Passez les écritures d inventaire.
Passez l écriture de règlement de la facture
SOLUTION
Ecritures d inventaire
Les dotations aux provisions inscrites au 31/12/N et N+2 sont les mêmes.
6912 Dotations aux provisions d exp. pour grosses réparations 5 000 000
1971 Provisions pour grosses réparations 5 000 000
Dotation de l exercice
Enregistrement de la facture au 18/07/N+3
6241 Entretien et réparation des bien immo. 18 000 000
4454 Etat, TVA récup. Sur serv. Et autres charges 3 366 000
Créditeurs divers 21 366 666
Facture n°
Reprise sur les provisions car l objet est devenu au 31/12/N+3 : il faut reprendre les provisions
le 31/12/N+2, ensuite le 31/12/N+3 et les annuler en débitant le compte 1971 par le crédit du compte
797, pour 5 000 000 FCFA.
1.1.3. Les provisions pour risques
Elles sont destinées à couvrir les risques identifiés, inhérents à l activité de l entreprise tels que
ceux résultant des :
litiges avec les tiers (salariés, clients, fournisseurs
) ;
garanties données aux clients ;
pertes dues au change à la suite de fluctuation des cours des monnaies étrangères
amendes et pénalités.
APPLICATION
Au cours de l exercice N, la SGC a effectué une livraison à un client avec un retard de plus de
deux mois et cela malgré plusieurs rappels de sa part. le client a intenté contre la SGC une action en
dommages et intérêts auprès du tribunal de commerce. Le jugement n est pas encore rendu mais
l entreprise estime que le client obtiendra une indemnité de 1 200 000 FCFA. Après jugement le
04/05/N+1, la SGC se voit contrainte de verser par chèque la somme de 1 000 000 FCFA à son client.
Passez dans le journal de la SGC les écritures correspondantes.
44
SOLUTION
Provision sur la perte envisagée au 31/12/N
691 Dotations aux provisions d exploitation 1 200 000
191 Provisions pour litiges 1 200 000
Provisions pour risques et charges
Décisions du tribunal et paiement des dommages et intérêts
6511 Pertes sur créances clients 1 000 000
521 Banques locales 1 000 000
Dommages et intérêts versés aux clients
APPLICATION
Un litige opposant l entreprise à son employé trouvera son issue dans deux mois ; dépenses
probables : 500 000 FCFA.
Passez les écritures correspondantes
SOLUTION
6591 Charges provisionnées d exp. sur risques à C.T. 500 000
4991 Risques provisionnés sur opérations d exp. 500 000
1.2. Provisions pour dépréciation
Les provisions constatent la perte réversible de la valeur du bien. La provision pour dépréciation
se constate par une dotation qui diminue le compte de résultat et corrélativement le compte d actif
correspondant.
On peut constater la dépréciation d un élément d actif amortissable par une provision, si cette
perte de valeur est réversible.
Pour un élément d actif amortissable ou non, on constituera une provision pour constater une
perte réversible des éléments concernés, et un amortissement pour constater une perte irréversible.
Comptabilisation
Comptes d actif circulant
659 Charges provisionnées d exploitation X
839 Charges provisionnées HAO X
39 Dépréciation des stocks X
49 Dépréciation des tiers X
Comptes de trésorerie
679 Charges provisionnées financières X
839 Charges provisionnées HAO X
45
59 Dépréciation des comptes de trésorerie X
Comptes d actif immobilisé
69 Dotations aux provisions X
853 Dotations aux provisions pour dépréciation HAO X
29 Provisions pour dépréciation X
1.3. Reprise des provisions
La provision constituée en fin d exercice N entraînera à la fin de l exercice N+1 la reprise
systématique du montant à la fin de l exercice N et la création d une nouvelle provision ou bien son
annulation.
L écriture suivante sera enregistrée :
Comptes d actif circulant
39 Dépréciation des stocks X
49 Dépréciation des tiers X
759 Reprise des charges provisionnées d exploitation X
849 Reprise de charges provisionnées HAO X
Comptes de trésorerie
59 Dépréciation des comptes de trésorerie X
779 Reprises de charges provisionnées financières X
849 Reprises de charges provisionnées HAO X
Comptes d actif immobilisé
29 Provisions pour dépréciation
49 Dépréciation des tiers
79 Reprises de provisions
863 Reprises provisions pour dépréciation HAO
2. LES CHARGES PROVISIONNEES
Ce sont les dépréciations qui concernent les éléments de l actif circulant, les stocks, les
créances et la trésorerie.
2.1. Dépréciation des stocks
46
Les provisions sont constituées pour constater les dépréciations dont les causes ne sont pas
irréversibles. Les provisions pour dépréciation de stocks sont liées à chaque catégorie de stock.
La nature de la provision doit être certaine et l élément d actif concerné doit être individualisé.
Les provisions ne doivent concerner que l exercice que l on clôture.
Les provisions pour dépréciation doivent être constatées, même en l absence de bénéfices.
Elles sont portées à l actif du bilan en déduction des postes de stocks.
Principe
A la fin de chaque exercice, on procède à l inventaire des stocks puis à leur évaluation. Les
stocks sont évalués lors des écritures d inventaire à leur valeur d origine, c'est-à-dire :
au coût d achat unitaire pour les marchandises, matières et approvisionnements ;
au coût de production unitaire pour les produits finis ou les encours.
Mais lorsqu au jour de l inventaire, on constate que le prix de vente sur le marché des
marchandises en stock est inférieur à leur coût d achat, on pratique une provision égale à la différence
entre les deux valeurs.
Provision = Coût des stocks Prix de vente au jour de l inventaire, évalué au coût d achat
(ou coût de production) (ou valeur réelle)
Valeur réelle = Prix de vente - Décote forfaitaire représentant les frais de
au cours du jour Distribution et le bénéfice
Comptabilisation
L écriture suivante sera enregistrée
659 Charges provisionnées d exploitation X
839 Charges provisionnées HAO X
39 Dépréciation des stocks X*
APPLICATION
La SGS présente la situation suivante à l inventaire de ses deux derniers exercices.
Au 31/12/N+1, la valeur du stock de marchandises est de 780 000 FCFA. Les frais de
distribution et la marge bénéficiaire représentent respectivement 12 et 10% du prix de vente. Le prix
de vente de ces marchandises au jour de l inventaire est de 900 000 FCFA.
47
Calculez le montant de la provision à constituer et passez les écritures nécessaires.
SOLUTION
Calcul du montant de provision
On calcule la valeur du stock par rapport au prix de vente, soit :
900000 100
x
- 12
(
+10) = 702000
100
Cette somme étant inférieure au coût d achat, on pratique une provision pour :
702 000 780 000 = - 78 000 FCFA.
Comptabilisation
Constatation de la variation des stocks au 31/12/N+1 : lorsqu à la fin de l exercice la provision
dotée sur un élément d actif varie, seule la variation (augmentation ou diminution) est enregistrée dans
les comptes.
6593 Charges provisionnées d exploit. Sur stocks 78 000
391 Dépréciation de stocks en marchand. 78 000
Constatation de la provision
2.2. Dépréciation et risques provisionnés (risques)
Une entreprise constitue des provisions pour dépréciation de créances quand le jour de
l inventaire, la valeur économique réelle se trouve être inférieure à la valeur déterminée selon les
règles éditées par le système comptable OHADA.
La dépréciation doit être définitive, on irréversible, certaine quant à sa nature. L élément d actif
pour lequel on constitue une provision doit être individualisé et non vague.
La provision doit être constituée même en l absence de bénéfice (règle de prudence). La
provision doit se rapporter aux dépréciations subies à la clôture de l exercice donc pour les
dépréciations subies sur l exercice antérieur ou par l exercice courant. Les événements survenus
après la date de clôture de l exercice ne sont pas pris en compte pour le calcul des provisions dudit
exercice.
La dépréciation correspond à la partie des créances que l on risque de ne pas recouvrer
lorsqu un client a des difficultés de règlement. Les provisions sont dans ce cas calculées sur les
créances hors TVA. Si une créance est impayée, l entreprise a le droit de récupérer auprès de
l administration fiscale la TVA qui avait été collectée.
2.2.1. Notion de « créance douteuse ou litigieuse »
les créances douteuses sont celles sur lesquelles pèsent des risques de non-recouvrement,
en raison des difficultés financières du débiteur.
Les créances litigieuses sont celles pour lesquelles des litiges, portant sur l exercice ou sur le
montant de créance, opposent l entreprise débitrice à un client.
48
2.2.2. Notion de créance irrécouvrable
Une créance est considérée comme irrécouvrable lorsqu une procédure régulière de
recouvrement a été engagée et a échouée.
2.2.3. Comptabilisation
Cette opération s effectue en deux étapes :
transfert de la créance dans un compte distinct ;
constatation de la provision
Transfert de la créance dans un compte distinct
Le montant de la créance dont le recouvrement est incertain doit être viré au débit du compte
416-Créances clients litigieuses et douteuses. On passe l écriture suivante :
D 416 Créances clients litigieuses ou douteuses C D 411 Clients C
X
X
Constatation de la provision
- La dotation est récurrente
A la fin de l exercice, on constatera la provision par l écriture suivante :
D 659 Charges provisionnées d exploitation C
D 491 Dépréciation comptes des tiers C
X
X
La dotation est HAO
On passera l écriture suivante :
D 839 Charges provisionnées HAO C D 491 Dépréciation comptes clients C
X
X
Remarque sur le fonctionnement du compte 499-Risques provisionnés : les provisions
de la classe 4 sont généralement des provisions pour dépréciation (comptes 490 à 498).
Le compte 499, par contre correspond à une charge future, un risque.
APPLICATION
49
La Socami possède une créance de 3 577 500 FCFA, TVA comprise, sur le client Manex, qui se
trouve en cessation de paiement au 31/12/N.
Le client Manex informe la Socami qu il risque de ne pas pouvoir payer 50 % de sa dette. Le
montant de la créance HT est de 3 000 000 FCFA.
Evaluez la perte probable
Passez les écritures nécessaires
SOLUTION
Evaluation de la perte probable
Le calcul de la perte probable s effectue à partir du montant hors taxes de la créance (sur la
base d une estimation).
Calcul de la perte probable au 31/12/N : 3 000 000 x 50 % = 1 500 000
Ecritures
4162 Créances douteuses 3 577 500
411 Clients 3 577 500
Créance devenue douteuse de Manex
6594Charges prov. d exploit. sur créance 1 500 000
7594 Reprise charges prov. d exploit./créance 1 500 000
Clôture d exercice
A chaque clôture d exercice, on procède à une nouvelle évaluation des éléments du patrimoine.
Tout changement dans cette évaluation entrâine un ajustement de la provision. Trois situations
peuvent alors se poser :
cas d annulation de la provision ;
cas d ajustement de la provision ;
cas de perte définitive.
- Cas d annulation de la provision
Exemple : Vu les difficultés financières de Manex, la Socami décide de porter sa provision à 70
% à l année N+1.
Evaluation de la provision à enregisgtrer :
Créance HT = 3 000 000 ;
Perte probable : 3 000 000 x 70 % = 2 100 000
6594 Charges prov. d exploit. sur créance 600 000
50
4912 Dépréciation des comptes clients 600 000
Dotation de la provision sur la créance
du client Manex
- Cas d ajustement de la provision
Exemple (suite de l exemple précédent) : au 31/12/N+2, la situation du client Manex s est
améliorée et la Socami espère récupérer 60 % de sa créance.
Evaluation de la perte probable au 31/12/N+2
3 000 000 x 40 % = 1 200 000
Provision constatée au 31/12/N+1 : 2 100 000
Provision constatée au 31/12/N+2 : 1 200 000
4912 Dépréciation des comptes clients 900 000
7594 Reprise charges prov. d exploit./créance 900 000
Reprise de la provision/créance du client Manex
- La perte définitive
C est le cas lorsque la perte probable est devenue certaine. La provision doit être annulée et la
totalité de la créance non recouvrée doit être virée au compte 6511-Pertes sur créances clients.
La perte définitive est limitée au montant hors TVA de la créance, car l Etat régularise la TVA
déjà collectée.
Exemple (suite de l exemple précédent) : Au 31/12/N+3, le client Manex est en faillite et a cessé
toute activité.
- Provision 1 500 000 FCFA
- Perte certaine (TTC) 3 577 500 FCFA
- Montant global de la créance irrécouvrable (HT) 3 000 000 FCFA
- TVA collectée remboursable par l Etat 577 500 FCFA
6511 Pertes/créances clients 3 000 000
4431 Etat, TVA facturée sur ventes 577 500
4162 Créances douteuses 3 577 500
Pour solde du compte Manex
4912 Dépréciation des comptes clients 1 500 000
7594 Reprise de la provision 1 500 000
51
Créance du client Manex
2.3. Dépréciation et risques provisionnés (titres de placement)
Les titres détenus en portefeuille par une entreprise sont évalués à la clôture de chaque
exercice.
Il y a lieu de faire une provision si la valeur d inventaire des titres est inférieure à leur valeur
d acquisition.
2.3.1. Principe
Les titres sont évalués à la valeur actuelle déterminée en tenant compte du cours moyen du
mois de décembre pour les titres cotés et/la valeur actuelle (valeur probable de négociation) pour les
titres non cotés.
Pour les titres en hausse, aucune constatation comptable n est à faire. Ne pas faire la
compensation entre plus-value et moins-value de titres.
Un événement exceptionnel tel que la faillite peut justifier la constitution de provisions
pour dépréciation de titres.
2.3.2. Comptabilisation
Il convient de débiter le compte 679-Charges provisionnées financières, et de créditer le compte
590-Dépréciation des titres de placement.
D 679 Charges prov.financières C D 590 Dépréciation des titres de placement C
X X
APPLICATION
La société Madubo a, au cours des trois derniers exercices, provisionnés des titres de
placement :
- au 31/12/N-2, la dépréciation constatée a été de 1 000 000 FCFA
- au 31/12/N-1, la provision a augmenté, passant à 1 500 000 FCFA
- au 31/12/N, le dépréciation constatée s élève à 700 000 FCFA
Enregistrez les écritures nécessaires.
SOLUTION
Enregistrement de la provision au 31/12/N-2
679 Charges provisionnées financières 1 000 000
590 Dépréciation des titres de placement 1 000 000
Perte probable sur titres
52
Augmentation de la provision au 31/12/N-1
679 Charges provisionnées financières 500 000
590 Dépréciation des titres de placement 500 000
Ajustement de la provision
Provision au 31/12/N
590 Dépréciation des titres de placement 800 000
779 Reprise des charges prov. financières 800 000
Reprise de la provision antérieure
CHAPITRE VIII
LA REGULARISATION DES CHARGES ET DES PRODUITS
La convention de l indépendance des exercices, ou principe d autonomie des exercices,
recommande de rattacher à chaque exercice les charges et les produits le concernant. Le respect de
ce principe conduit en fin d exercice, avant le calcul du résultat final, à des réajustements de charges
et des produits.
1. LA REGULARISATION DES COMPTES DES CHARGES
Cette régularisation concerne les charges à payer et les charges comptabilisées d avance.
1.1. Charges à payer
Ce sont des charges qui ont leur origine dans l exercice, mais pour lesquelles les documents
justificatifs ne sont pas parvenus à l entreprise à la date d inventaire.
Ces charges sont enregistrées dans les comptes de charges appropriées par le crédit d un
compte de tiers se terminant par 8 :
408-Fournisseurs, factures non parvenues ;
428-Personnel, charges à payer et produits à recevoir ;
438-Organismes sociaux, charges à payer et produits à recevoir ;
448-Etat, charges à payer et produits à recevoir.
Exemple : au cours des derniers jours de l exercice, des marchandises d une valeur de 135 000
FCFA HT sont livrées. Les factures correspondantes ne sont pas encore parvenues.
601 Achats de marchandises 135 000
4455 TVA récupérable/facture non parvenue 25 987
53
408 Fournisseurs, facture non parvenue 160 987
Charges à payer
Au début de l exercice suivant (N+1), on contre-passe les écritures constatant les
charges à payer à la fin de l exercice précédent. A l arrivée du document justificatif, on
enregistre normalement l écriture.
1.2. Charges constatées ou comptabilisées d avance
Ce sont des charges enregistrées au cours de l exercice qui s achève mais qui concernent en
partie ou en totalité l exercice ou les exercices suivants. Il est normal de les retrancher des charges de
l exercice qui s achève pour leur montant hors taxes. Pour ce faire, on crédite le compte de charges
correspondant et on débite le compte 476-Charges constatées d avance.
476 Charges constatées d avance X
6 Comptes des charges X
Au début de l exercice suivant, on procède à une contre-passation des écritures pour
que cet exercice supporte la charge correspondante.
APPLICATION
Le 1er août N, l entreprise Sodip a réglé une prime annuelle d assurance de 1 200 000 FCFA
dont l effet couvre la période du 01/08/N au 31/07/N+1 à minuit.
Passez l écriture du 31/13/N au journal.
SOLUTION
La partie de la prime constatée d avance va du 01/01/N+1 au 31/07/N+1, soit 7 mois.
Graphique à inserer
Calcul du montant de la charge constatée d avance
7
1 200 000 x
= 700 000
12
476 Charges constatées d avance 700 000
625 Primes d assurance suivant état d inventaire des charges 700 000
1.3. Rabais, remises et ristournes à accorder
Les rabais, remises et surtout les ristournes accordés aux clients en fin d exercice sur le chiffre
d affaires annuel doivent être enregistrés même si l avoir n est pas établi. On débite le sous-compte
intéressé du compte 70 (701, 702, 703, 704) par le crédit du compte 4198-Rabais, remise, ristournes
et avoirs accordés pour le montant hors taxes.
APPLICATION
Les Brasseries du Cameroun ont réalisé un chiffre d affaires de 150 000 000 FC avec le client le
Bar des Amis. Une ristourne de 1% doit lui être accordée mais l avoir n est pas encore établi.
Calculez et enregistrez cette ristourne
54
SOLUTION
Calcul de la créance
R = 150 000 000 x 1/100 = 1 500 000
Enregistrement
702 Ventes de produits finis 1 500 000
4198 RRR et autres avoirs à accordés 1 500 000
Ristournes à accorder
Cette écriture sera contre-passée à la réouverture des compte (le 01/01/N+1)
1.4. Intérêts à payer sur emprunts et dettes financières
Les intérêts des emprunts et dettes étant généralement payables à terme échu, on les
régularise à l inventaire.
Ils sont calculés sur le capital non remboursé pour la période allant du dernier remboursement à
la date de l inventaire.
La charge est enregistrée au débit du compte 67 par le crédit du compte :
166, s il s agit d un emprunt ou d une dette assimilée ;
176, s il s agit d un crédit-bail ;
183, s il s agit des dettes liée à des participations ;
408, (plus précisément 4086), s il s agit de dettes de fournisseurs ;
462, pour les intérêts des comptes courants d associés ;
506, pour des intérêts sur titres de placement ;
566, pour des intérêts sur découverts bancaires.
APPLICATION
Le 1er septembre N, Sodip a contracté un emprunt de 20 000 000 FC à 15% l an. Intérêts
payables le 31 aout de chaque année.
Calculez l intérêt couru au 31/13/N et passez les écritures au journal.
SOLUTION
Calcul des intérêts
15
4
20 000 000 x
x
= 1 000 000
100 12
Comptabilisation
671 Intérêts des emprunts 1 000 000
166 Intérêts courus 1 000 000
55
Prise en compte des intérêts
2. LA REGULARISATION DES COMPTES DES PRODUITS
2.1. Produits à recevoir
Ce sont des produits ayant leur origine dans l exercice qui s achève, qui rapportent à cet
exercice, mais dont les pièces justificatives ne sont pas parvenues à l entreprise au moment de
l inventaire avant d arrêter les comptes. Il convient de les ajouter aux produits de l exercice ; pour cela,
on doit :
Créditer le compte de produits intéressé ;
débiter un compte de tiers se terminant par 8 ;
41-8 Clients produits à recevoir,
428-Personnel, charges à payer et produits à recevoir,
438-Organismes sociaux, charges à payer et produits à recevoir,
448-Etat, charges à payer et produits à recevoir,
475-Créances sur travaux non encore facturés.
APPLICATION
L entreprise Sodip a livré des marchandises au client Mbock le 29 décembre N pour un montant
de 2 500 000 FC HT. Au 31/12/N, la facture n est pas encore établie et on doit arrêter les comptes.
Enregistrez cette facture chez Sodip
SOLUTION
- Calcul de la TVA : 2 500 000 x 19,25% = 481 250
4181 Clients, factures à établir 2 981 250
701 Ventes des marchandises 2 500 000
4435 TVA sur factures à établir 481 250
Clients Mbock
Au début de l année N+1, les écritures ci-dessus sont contre-passées.
2.2. Produits perçus ou comptabilisés d avance
La quote-part des produits qui ne concerne pas l exercice en cours doit être corrigée par
soustraction des produits en trop par le débit d un compte de produits et par le crédit du compte 477-
Produits constatés d avance pour le montant hors taxes.
7. Produits X
4477 Produits constatés d avance X
Au début de l exercicie suivant, les écritures de régularisation doivent être contre-
passées.
56
APPLICATION
le 31/12/N, la société Sodip a envoyé au client Diouf une facture pour vente de marchandises
de 500 000 FC HT. Mais ces marchandises ne sont pas encore livrées. Elles ne le seront qu en janvier
N+1.
La facture est déjà comptabilisée chez Sodip.
Passez l écriture
SOLUTION
701 Ventes de marchandises 500 000
477 Produits constatés d avance 500 000
2.3. Intérêts à recevoir
, les intérêts sur prêts et créances sont payés à terme échu. A l inventaire, il convient de calculer
les intérêts sur le capital prêté non remboursé pour la période qui va du dernier remboursement des
intérêts jusqu à la date d inventaire.
Ces intérêts sont comptabilisés au :
crédit du compte 77-Revenus financiers et produits assimilés ;
débit du compte 276-Intérêts courus lorsqu il s agit d intérêts résultant :
des prêts et créances non commerciaux,
des prêts au personnel,
des créances sur Etat,
des titres immobilisés,
des dépôts et cautionnements versés,
des créances rattachés à des participations,
des immobilisations financières diverses ;
418-Clients produits à recevoir lorsqu il s agit d intérêts résultant des créances sur clients ;
506-Intérêts courus lorsqu il s agit d intérêts résultant des créances sur clients :
des titres du trésor et bons de caisses à court termes,
des actions,
des obligations ;
526-Banques intérêts courus pour les intérêts provenant des banques ;
536-Etablissements financiers, intérêts courus, pour les intérêts provenant des établissements
financiers.
2.4. Rabais, remises, ristournes à obtenir
57
Les fournisseurs peuvent devoir à l entreprise des rabais, remises et ristournes dont les avoirs
ne sont pas parvenus à la date de l inventaire.
Ces rabais, remises, ristournes à obtenir sont enregistrés :
au crédit d un compte d achat concerné (601, 602, 604, 605, 608) ;
au débit du compte 409-Fournisseurs débiteurs ou plus précisément 4098-RRR et autres
avoirs à obtenir.
Cette écriture tient compte de la TVA
409 ou Fournisseurs débiteurs ou RRR et autres avoirs X
4098
60 Achats de marchandises ou RRR obtenus X
4455 TVA sur factures non parvenus X
APPLICATION
Le 31/12/N, Sodip n a pas encore reçu la facture d avoir de son fournisseur, relative à la
ristourne du premier semestre. Néanmoins, elle sait qu elle est de 100 000 FC HT.
Enregistrez cette ristourne à obtenir.
SOLUTION
4098 RRR à obtenir 119 250
6019 RRR obtenus 100 000
4455 TVA récupérable sur factures non parvenues 19 250
Ristourne à obtenir
58
CHAPITRE IX
COMPTES DE GESTION
Ils sont regroupés dans les classes ci-après :
classe 6 : comptes de charges des activités ordinaires ;
classe 7 : comptes des produits des activités ordinaires ;
classe 8 : comptes des autres charges et autres produits.
Les comptes des charges des activités ordinaires
Ils augmentent au débit et diminuent au crédit :
D Numéro et nom du compte C
Des emplois définitifs de ressources
Des diminutions d emplois définitifs de
Ressources
Leur solde est débiteur ou nul ; il ne peut jamais être créditeur.
Les comptes de produits des activités ordinaires
Ils diminuent au débit et augmentent au crédit :
D Numéro et nom du compte C
Des diminutions internes de ressources
Des créations internes de
Ressources
Leur solde est créditeur ou nul, il ne peut jamais être débiteur.
1. LES SOLDES SIGNIFICATIFS DE GESTION
L analyse des charges et des produits (article 31) permet d obtenir en fin d exercice neuf soldes
qui apparaissent dans le compte de résultat prévu par le système comptable OHADA.
59
Les soldes présentent pour la plupart un grand intérêt pour l analyse de la gestion. Ces
différents soldes sont :
la marge brute sur marchandises ;
la marge brute sur matières ;
la valeur ajoutée ;
l excédent brut d exploitation ;
le résultat d exploitation ;
le résultat financier ;
le résultat des activités ordinaires ;
le résultat hors activités ordinaires ;
le résultat net.
Ils sont regroupés en trois catégories :
les soldes provenant des activités d exploitation ;
, les soldes provenant des activités financières ;
les soldes liés aux opérations hors activités ordinaires.
1.1. Marge brute (MB)
La marge brute est déterminée de manière différente selon qu il s agit :
d une entreprise commerciale ;
d une entreprise industrielle ;
d une entreprise mixte.
1.1.1. Dans l entreprise commerciale
La marge brute sur marchandises est déterminée par le compte 1321, qui est la différence entre
les ventes de marchandises et le coût d achat des marchandises vendues dans l exercice.
,
SODIP
Facture n° 719 Doit :
Date : le 22/02/N Dobili
60
Marchandises
200 000
Escompte 2%
4 000
TVA 19,25%
37 730
Port
20 000
Net à payer
253 730
SODIP
Facture n° 719 Doit :
Date : le 22/02/N Dobili
Marchandises
200 000
Escompte 2%
4 000
TVA 19,25%
37 730
61
Port
20 000
Net à payer
253 730
SODIP
Facture n° 721 Doit :
Date : le 22/02/N Mboma
Marchandises
150 000
Escompte 1%
1 500
148 500
TVA 19,25%
25 586
Net à payer
177 086
