Guide de formation sur le commerce electronique et protection du consommateur
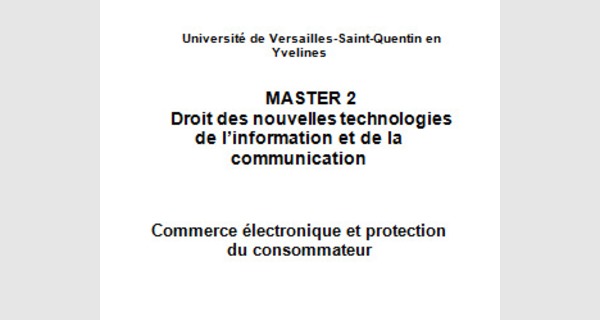
Guide de formation sur le commerce électronique et protection du consommateur
…
Internet permet aussi le développement de nouveaux acteurs que sont les sites de ventes aux enchères ou de petites annonces, juridiquement appelés plate-formes de courtage en ligne, qui offrent aujourd'hui la possibilité à des particuliers de développer une activité de commerce électronique. Selon le rapport publié par le Forum des droits sur l'Internet en novembre 200 , plus de 5 millions de Français utilisent aujourd'hui ces plates-formes.
Les principales difficultés rencontrées par ce qu’on appelle les « pure players », c’est à dire les opérateurs n’agissant que par le biais d’internet, et qui représentent 40% du secteur, sont principalement imputables à des problèmes de recrutements de clients, une vision trop optimiste de leurs résultats, un absence de stock et un coût trop élevé de leur chaîne logistique. A l’inverse, les « clics magasins », c'est-à-dire les entreprises qui vendaient à l'origine en magasins spécialisés ou grandes surfaces et qui ont par la suite choisi d'élargir leur forme de vente à Internet et ont déjà une bonne maîtrise de leur chaîne logistique, peuvent profiter pleinement de leur expérience . C’est particulièrement vrai pour les détaillants ayant une activité dans le secteur de l’habillement.
Se développent aussi très rapidement les « Absolute players », c’est à dire les acteurs nés avec l'Internet et dont l’activité est totalement dématérialisée. Nés avec l'Internet, le modèle de ces acteurs est 100 % Internet : pas de réseau de distribution physique, pas de stock. Dans cette catégorie se placent différents types d'acteurs, à la virtualité absolue : les comparateurs (Kelkoo, Assurland, Easyvoyage…), les courtiers en ligne (Boursorama…), les moteurs de recherche ou les annuaires (Google, Yahoo…), les sites d'enchères (eBay…), les plate-formes de téléchargement musical payantes ou peer-to-peer (OD2, Kazaa…), certaines agences de voyage en ligne (Partirpascher, Expedia…), les médias en ligne (le JDN, par exemple …), les spécialistes des liens sponsorisés (Overture…), certains sites de petites annonces, les places de marché, ou encore les sites communautaires (Friendster…). Certains de ces absolute players ont transposé un business-model existant (courtiers), d'autres en ont inventé un (Google). Les revenus reposent essentiellement sur le prélèvement de commissions ou sur la publicité.
Cette nouvelle famille d'acteurs, malgré son hétérogénéité, dispose de plusieurs caractéristiques communes. En termes d'offre, leur production est circonscrite à des biens purement informationnels, par définition dématérialisés, ou à des services d'intermédiation. Les flux engendrés sont financiers et/ou électroniques, et la valeur créée repose la plupart du temps sur la constitution de bases de données. Ils sont ainsi les plus "purs représentants" de la société de l'information, et participent du développement des activités tertiaires de type informationnel.
En termes de coûts, leurs activités demandent des investissements essentiellement immatériels, comme la recherche et le développement logiciel, le marketing ou la publicité. De ce fait, ce sont plutôt des structures de coûts fixes, ce qui permet de maximiser les marges.
L’apparition de ce nouveau vecteur a aussi pour conséquence aussi de remettre en cause la pertinence et l’efficacité de nombreuses règles de droit . La dématérialisation des échanges et leur indépendance par rapport à la géographie et aux frontières constituent autant d’obstacles à l’applications des concepts traditionnels du droit basés sur la territorialité de l’application du droit et le formalisme contractuel. Comment en effet, concilier les règles de preuve de l’article 1341 et les mécanismes de transaction par clic ou double clic ? Comment s’assurer de l’identité de son interlocuteur ? Comment définir la loi applicable ? Quel sera le juge compétent en cas de conflit ? En d’autres termes, comment maintenir le même niveau de sécurité et d’échange dans les relations contractuelles dématérialisées que dans les relations de l’économie réelle ?
De même, ces éléments nouveaux modifient les rapports de force traditionnels entre le professionnel et le consommateur . En lui permettant de contracter avec des opérateurs situés sur l’ensemble de la planète, en lui offrant, de chez lui, une gamme de produits jusque là inégalée, internet contribue assurément améliorer la liberté de choix du consommateur. Mais, d’un autre côté, celui-ci entre en relation avec des opérateurs sur lesquels les lois consuméristes n’ont aucune prise. Si l’ouverture au monde que permet internet démultiplie les capacités d’action des consommateurs, elle favorise tout autant les actions frauduleuses d’opérateurs peu scrupuleux et les risques d’abus. Les règles consuméristes actuellement en vigueur doivent donc être regardées sous des angles nouveaux pour s’assurer de leur pertinence au regard de la dématérialisation et de l’internationalisation des échanges .
La création d’entités commerciales purement virtuelles conduit aussi à l’élaboration de relations contractuelles innovantes. Il est bien évident que la réalisation d’une galerie marchande virtuelle ne nécessite pas de passer des contrats de promotion immobilière ou des baux commerciaux, mais doit conduire à s’interroger sur la nature des relations qui vont unir plusieurs sites reliés entre eux par des liens hypertexte. Les « pure players » évoqués ci-dessus doivent aussi monter des réseaux logistiques spécifiques, souvent en partenariat avec d’autres opérateurs spécialisés. Le développement de l’internet s’accompagne aussi de celui des transporteurs et des centres de gestion de la relation client.
C’est peu dire que le commerce électronique offre au juriste un terrain expérimental considérable qui nécessite de sa part imagination et créativité. Peu à peu s’étoffe le corpus juridique applicable à ce nouveau secteur :
- les articles L 121-20 du code de la consommation sur la vente à distance,
- la loi du 13 mars 2000 sur la preuve et la signature électroniques,
- la loi du 1er août 2000 sur la responsabilité sur internet,
- la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
- les directives communautaires, celle du 20 mai 1997 sur la protection des consommateurs dans le domaine de la vente à distance, celle du 8 juin 2000 sur le commerce électronique
Ainsi, est en train d’émerger un droit nouveau issu aussi en grande partie de la pratique contractuelle , de la coutume et de la jurisprudence .
La rédaction et la diffusion de contrats types, tel que ceux, par exemple, élaborés par la chambre de commerce et d’industrie de Paris, contribuent à l’édification de normes de références communes à de nombreux acteurs économiques.
Le juge, de son côté, face au silence de la loi, puise bien souvent dans les ressources que lui offrent les concepts traditionnels du droit des contrats, qui se caractérisent par leur souplesse et l’absence de formalisme rigide, surtout en droit commercial, pour régler au cas par cas et de façon pragmatique les litiges qui lui sont soumis, prouvant ainsi que la modernité d’internet ne lui confère pas une singularité telle qu’elle le ferait échapper par principe aux critères traditionnels de résolution des litiges .
Je vous propose donc, au sein de ce séminaire, d’explorer l’ensemble des questions de droit de la consommation qui se posent dans le commerce électronique.
La protection du consommateur sur internet
Le commerce électronique se partage entre le B to B (business to business) et le B to C (business to consumer). Le premier est très largement dominant, le second beaucoup plus médiatisé .
Ces deux types de relations se ressemblent et s’éloignent à la fois. Il s’agit à chaque fois de contrats réalisés à distance en empruntant les réseaux électroniques. En cela, ils ne se distinguent pas des relations contractuelles passées au moyens des modes traditionnels de contractualisation à distance tels que le courrier, le téléphone, le télex ou la télécopie. L’utilisation des réseaux électroniques les différencient cependant en ce qu’elle aboutit à une dématérialisation des supports papiers utilisés lors des transaction, sans pour autant qu’il y ai de modification quant à la nature juridique des opérations en cause qui demeure inchangée. Les supports traditionnels, reposant sur l’écrit, sont substitués par des supports nouveaux qui privilégient l’information sur la forme, de sorte que les questions relatives à la sécurité et à l’authentification des transactions s’en trouve renforcées.
L’internationalisation inhérente aux échanges sur internet constitue aussi une caractéristique forte qui distingue le commerce électronique du commerce traditionnel. (étant observé qu’il existe aussi un commerce électronique " de proximité "), en ce sens qu'il ne s'agit pas seulement d'un commerce trans-frontières mais d'un commerce évoluant dans un espace sans frontières, ignorant des frontières si l'on préfère, là où nos droits restent conçus territorialement, c'est à dire dans des espaces délimités par des frontières
Mais avec le B to B, qui reste profondément marqué par le contexte des affaires et privilégie la liberté et les usages, il s’agit davantage d’un changement de vecteur que d’autre chose. Autrement dit, le contrat passé par le canal des réseaux et de l’internet reste substantiellement semblable à tout autre contrat analogue qui aurait emprunté un canal plus classique pour sa conclusion. Des particularités peuvent évidemment surgir lorsque le contrat peut être exécuté en ligne comme il en va quand son objet est de l’information. Mais la marque du contexte d’affaires demeure. Le régime de la liberté de la preuve est la règle. Les contrats échappent aux cadres rigides du consumérisme et sont négociés en fonction des situations d’espèce.
Dans le B to C, il n’y a pas non plus de résolution. Un contrat de vente via internet demeure un contrat de vente. Mais, dans la mesure où l’opération est ouverte sur le grand public et où il n’est donc pas possible de s’appuyer sur les règles non écrites d’un milieu relativement clos, les relations contractuelles nécessitent d’être encadrées par des dispositions spécifiques qui garantissent la protection du consommateur dans les mêmes conditions que si elles avaient été conclues par des voies classiques.
Bien que moins dangereux pour le consommateur que beaucoup de méthodes de vente traditionnelles, puisque celui-ci ne fait pas l’objet d’une intrusion agressive à son domicile mais, au contraire, a l’initiative du moment de l’achat, le commerce électronique n’est cependant pas sans risque. A cet égard, la distance est la meilleur manière d’éviter les abus de faiblesse parce qu’il est plus facile de dire non à distance qu’en face . Le véritable danger vient de ce que le consommateur, qui choisit l’objet de la vente à travers un écran d’ordinateur, n’en a pas la maîtrise physique avant la livraison. Le contrat de vente est donc conclu avant qu’il ait pu réellement se faire une idée des qualités réelles de la chose, d’où il résulte parfois une déception de l’acheteur. D’autre part, l’acheteur paie avant la livraison, ce qui n’est pas sans risque lorsque l’entreprise de vente par correspondance est située à l’étranger ou n’est pas solvable.
L’internaute se trouve aussi parfois lié par un contrat dont l’ensemble des termes n’a pas été toujours porté à sa connaissance, ou rédigé dans une langue qu’il ne connaît pas, ou qu’il fasse référence à une législation qui lui est étrangère. La facilité avec laquelle le consommateur effectue ses achats sur internet peut parfois aussi dénaturer son consentement ou même le transformer en simple réflexe.
Le commerce électronique a d’ailleurs fait l’objet le 4 décembre 1997 d’un avis du conseil national de la consommation .
Il n’existe pas de véritable droit de la consommation des nouvelles technologies de l’information et de la communication distinct et opposable au droit commun. L’ensemble des règles de protections du consommateur a vocation à s’appliquer dans le commerce électronique, même si, depuis peu, apparaissent des règles spécifiques aux contrats conclus à distance et qui s’appliquent plus particulièrement aux contrats conclu par le biais d’internet.
Depuis octobre 2000, la DGCCRF a mis en place un centre de surveillance du commerce électronique (CSCE), situé à Morlaix . Celui-ci a déposé en mars 2004 son troisième rapport sur le respect des codes de la consommation et du commerce, par les sites de commerce électronique français . En un an, le CSCE a reçu plus de 7.500 messages électroniques et a effectué 1.514 contrôles révélant 410 infractions présumées, contre 402 en 2002
Dans un marché marqué par une croissance à deux chiffres (+80 % par rapport à 2002), les agents du ministère des Finances ont constaté une baisse régulière du « taux infractionnel » (nombre d'infractions présumées rapporté au nombre de contrôles effectués) lié au commerce électronique. Quand celui-ci s'élevait en 2001 à 31,5 %, il n'est plus en 2003 que de 27 %. Et encore, au second semestre 2003, ce taux s'établit à 23 %.
Pour la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), cette tendance devrait se confirmer en 2004, notamment grâce à l'entrée en vigueur de la loi sur la confiance dans l'économie numérique. Selon DGCCRF, « le développement du commerce électronique se caractérise par l'arrivée en continu de nouveaux intervenants, qui ne sont pas toujours au fait de leurs obligations » . La quasi-majorité des infractions se révèle en effet être des manquements aux textes qui réglementent les informations obligatoires sur les sites. Suivent ensuite les cas de non-respect des règles de publicité de prix (16,5%) et de publicité trompeuse (14,5%), d'ailleurs en augmentation.
Parmi les domaines les plus exposés, les secteurs de la distribution (taux infractionnel de 32,2%), de la vidéo-TV (44,2%), des concours-loterie (40%) et des biens et services culturels (38,3%). Ces sites touchent une cible à l'achat plus impulsif, et donc moins prudente en terme de réglementation d'achat. Si les sites financiers sont classés par le CSCE dans les secteurs en amélioration, le taux d'infraction reste de 35,5%. Les secteurs plus sages sont ceux de l'immobilier (18,4%), de la décoration et du bricolage (20,8%), des jeux et jouets (18,4%).
La DGCCRF s’est aussi employée à contrôler la sécurité du consommateur, en vérifiant la présence sur le Web d'articles non conformes à la législation. Ont ainsi été identifiées des sociétés qui procédaient à des envois massifs de publicités pour des dispositifs antiradar, des pointeurs laser interdits ou des articles de bain pour bébés non conformes à la réglementation en vigueur.
Parmi les nouveautés, on notera également l'apparition dans le rapport 2003, des « liens promotionnels au clic par clic » ou liens sponsorisés, l'idée étant ici de vérifier les concordances entre les mots achetés par les annonceurs et les contenus réels des sites.
Comme pour les années précédentes, la DGCCRF a privilégié une approche pédagogique pour permettre aux sites concernés de régulariser leur situation. Si l'envoi d'avertissements, sous forme de rappels de réglementation, a ainsi été privilégié pour les infractions les moins graves, 27 procès-verbaux ont cependant été transmis au parquet, contre seulement 18 en 2002.
De son coté, le Forum des droits de l’Internet a constitué en son sein un « Observatoire de la cyber-consommation » qui recense les avis des consommateurs dont les principales critiques concernent les délais de livraison ou la non-conformité du bien livré .
C’est dire que la question du droit de la consommation s’impose en matière de commerce électronique.
Mais avant d’aborder cette question et la définition du droit de la consommation, il convient au préalable de déterminer la loi applicable.
Chapitre préliminaire : La détermination de la loi applicable .
Ainsi qu’il a déjà été rappelé, l’une des caractéristiques du commerce électronique, c’est qu’il n’est pas ancré dans un territoire déterminé. La complexité de la question vient du fait qu’une ou plusieurs des parties à la transaction – y compris des utilisateurs de l’Internet, des prestataires de services et fournisseurs de contenu, des acheteurs, des vendeurs, des entreprises, des systèmes technologiques et des serveurs informatiques – peuvent se situer dans différents pays. L’incertitude peut alors s’installer non seulement quant à savoir où les activités pertinentes ont lieu, mais aussi – parce que les activités elles-mêmes peuvent avoir des conséquences voulues et non voulues dans le monde entier – quant à savoir où situer le lieu du litige, comment déterminer le droit applicable et quel système juridictionnel peut être saisi du litige.
En ce sens, la première question à résoudre consiste à déterminer la loi applicable.
Section I Les règles générales
A Le principe
Les États membres de la Communauté économique européenne ont adopté la Convention de Rome du 19 juin 1980 afin d'instaurer des règles communes de désignation de la loi applicable aux obligations contractuelles .
La Convention de Rome consacre le principe fondamental de la "loi d'autonomie" : les parties sont en principe libres de choisir la loi de fond qui régira leurs relations contractuelles, et ce même si la loi qu'elles désignent n'a aucun lien avec le contrat , sous réserve d'une fraude à la loi , et de l'application par le juge saisi de ses lois de police ou d'ordre public. Ce choix peut être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.
A défaut de choix des parties sur la loi applicable à leur contrat, la Convention de Rome désigne la loi "du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits" (article 4 alinéa 1er).
L'article 4 alinéa 2 présume que "le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale ».
Toutefois, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé son principal établissement ou, si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un établissement autre que l'établissement principal, celui où est situé cet autre établissement".
Dans un contrat de vente par voie électronique, la prestation caractéristique sera toujours la livraison du bien par le vendeur. La loi applicable sera donc celle du pays de son domicile au moment de la conclusion du contrat.
Mais la présomption posée à l’article 4 n’est qu’une présomption simple qui peut être écartée « lorsqu’il il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays » , ces circonstances pouvant résulter de la langue de rédaction, de la référence à des droits correspondant à un ordre juridique déterminé, de la monnaie utilisée ou encore de l’indication d’un usage reconnu sur une place identifiée.
S’agissant des lois de forme, l’article 9-2 de la convention prévoit que le contrat est valable s’il répond aux conditions de forme qui le régit au fond ou de la loi de l’un des pays dans lequel il a été conclu.
B Loi applicable aux contrats conclus avec les consommateurs
Règles dérogatoires à la désignation de la loi de forme
L’article 9-5 de la convention de Rome dispose tout d’abord que le consommateur qui conclut un contrat à distance bénéficie, pour les règles de forme, de l’application de la loi du pays dans lequel il a sa résidence.
Règles dérogatoires à la désignation de la loi de fond
Conditions de la dérogation
S’agissant des règles de fond, les articles 5.2 et 5.3 introduisent une dérogations aux principes édictés aux articles 3 et 4, si le contrat a été souscrit dans l’une des circonstances suivantes :
- 1°) la conclusion du contrat a été précédée dans le pays du consommateur d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité et le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat,
ou
- 2°) le cocontractant du consommateur ou son représentant a reçu la commande dans ce pays.
ou
- 3°) si le contrat est une vente de marchandises et que le consommateur s’est rendu de ce pays dans un pays étranger et y a passé la commande, à la condition que le voyage ait été organisé par le vendeur dans le but d'inciter le consommateur à conclure une vente.
Appliqué au commerce électronique, ce texte conduit d’abord à s’interroger sur les circonstances qui peuvent caractériser, sur internet, une proposition ou une publicité au sens de la convention visé au 1°) . L’article 5.2 ne vise en effet que le consommateur qui, alors qu’il n’a rien demandé, a fait l’objet d’une sollicitation. Celui qui, au contraire, a lui-même initié le processus commercial en allant chercher le professionnel à l’étranger ne peut opposer le droit de la consommation de son propre pays . Or, sur l'Internet, il est très délicat de déterminer dans quelle mesure la conclusion du contrat en ligne a été précédée dans le pays du consommateur d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité par voie électronique.
Le fait est qu’une proposition peut être spécialement faite via le net au moyen d’une page ou d’un site. C’est la technique du « pull ». Une publicité peut l’être aussi par la technique du push, c’est à dire la technique qui consiste à adresser une offre directement au consommateur par un courrier électronique.
Certains insistent sur le fait qu'en naviguant sur le Web, le consommateur se rend lui-même sur le site où s'opère la transaction et décide d'y conclure un contrat, ce qui constitue donc pour le consommateur une attitude active et pour le prestataire une attitude "passive" qui échappe à l'application de l'article 5.2 de la Convention de Rome. Ils limitent dés lors l’application des dispositions de l'article 5.2 aux offres non sollicitées envoyées par courriers électroniques (le prestataire adopte alors une attitude "active") .
D’autres considèrent au contraire que le simple fait de se rendre volontairement sur le site Web d'un fournisseur est insuffisant à caractériser une prestation "active" du consommateur et permettre au professionnel d’échapper à l’application de l’article 5.2. Au contraire, le site web d’un commerçant peut être considéré comme une publicité dirigée vers les consommateurs d’un certain pays et justifier ainsi l’application de la loi de ce pays.
A titre illustratif, un prestataire peut, avec l'aide d'une société de marketing spécialisée en la matière, faire en sorte qu'une bannière renvoyant directement à son site transactionnel apparaisse à l'écran d'un moteur de recherche lié à la société de marketing, chaque fois qu'un internaute introduit un mot clé évocateur des services offerts par le prestataire dans la fenêtre de soumission du moteur.
Il nous semble que cette technique, de plus en plus couramment utilisée, relève de l'attitude active du vendeur visée à l'article 5.2 de la Convention de Rome . En effet, l'internaute n'est initialement pas demandeur du service proposé et c’est par l’effet des mécanismes des liens mis en place par le vendeur qu’il se trouve invité à contracter.
Plus délicat encore est le point de trancher sur le fait de savoir si on peut considérer qu’en pianotant sur son clavier, le consommateur accomplit dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat. de quel sens investir ce geste ?
D’après le professeur Lagarde, Peu importe où le contrat a été juridiquement conclu, du moment que c’est dans le pays de sa résidence habituelle que le consommateur a signé les papiers qui lui étaient présentés ou a envoyé sa commande au fournisseur .
