Tutoriel ALM : Introduction à la Gestion Actif Passif et Solvabilité
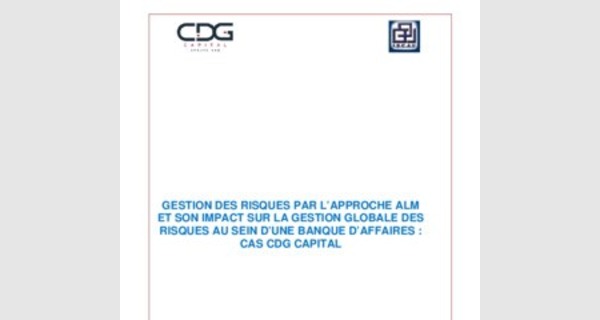
GESTION DES RISQUES PAR L’APPROCHE ALM
ET SON IMPACT SUR LA GESTION GLOBALE DES RISQUES AU SEIN D’UNE BANQUE D’AFFAIRES :
CAS CDG CAPITAL
REALISE PAR :ENCADRE PAR :
AZIZI Jaafar                    M. BENDRIOUCH
2008/2009
          Sommaire
Dédicaces……………………………………………………………………… ……………..5
Remerciements……………………………………………………………….. ……………..6
Introduction .. ……………7
Préambule………………………………………………………………………………………9
Première partie : Généralités sur l’ALM, techniques de mesure etinstruments de couverture des risques…………………………………….. 11
Chapitre 1 : De la gestion des risques ……………………………………………………….12 Section 1 : les risques usuels ………………………………………………………………….12
Section 2 : nécessité de la gestion des risques ………………………………………….……..14
Chapitre 2 : Intérêt et démarche de l’ALM …………………………………………………. 16   
Section 1 :définition et objectifs ………………………………………………….…………… 16
Section 2 : Risques de liquidité , de taux dans l’ALM…………………………………………….18
. A.Présentation :………………………………………………………………………..……..18
B .Facteurs de risque de taux et de liquidité :……………………………………………..……19 Section 3 : Enjeux pour l’organisation dans une banque d’affaires …………………………..…..23
Chapitre 3 : outils et techniques en ALM………………… .……………………………………24
Section 1 : les recommandations du comité de Bale………………………………………………..25 Section 2 : L’approche statique…………………………………………………………………….27
A. la mesure du volume……………………………………………………………………………………….28
B. la mesure de la marge : sensibilité aux taux………… …………………………………………………30  C. la mesure de la valeur……………………………………………………………………………..……….31
Section 3 : L’approche dynamique : les simulations………………………………………………33
A. Scénario central……………………………………………………………………………………………..34
B. Scénario contrasté…………………………………………………………………………………………..34
C. Simulations et besoins d’informations ……………………………………………………… …………38
Chapitre 4 : techniques de dédication…………………………………………………………..39
Section 1 : Cash flow matching .40
  A. Dédication d'un portefeuille d'obligations ………………………………………………….…………40  B. Optimisation :……………………………………………………………………… …………………….41
C. Limites du cash flow matching:…………………….…………………………………………………….42
Section 2 :Immunisation……………………………………………………………………….42
Chapitre 5: Instruments en ALM pour la couverture………………..… . ……………………..44
Section 1 : Typologie des instruments de couverture………………………. ……………………44
Section 2 : Couverture du risque de taux………………………..……… ………………………45
Chapitre 6 : la gestion du risque de change………..…………………………………………….46
Section 1 :la mesure du risque de change……………………………..…………………………46
  A.Les sources du risque de change……………………………………………………………………….46
  B.les techniques de mesure du risque de change…………………………………………………………47  C .les fonds propres et le risque de change…………………………………………..……………………48 Section 2 : les techniques de couverture……………………………………………………….49
  A. La couverture du risque de transition………………………………………… ………………………49  B. La couverture du risque de traduction……………………………………………………….…………50
Chapitre 7 : La mise en œuvre de la Gestion Actif-Passif……………..… …………….……..50
Section 1 : Le contrôle des risques…………………………………………………………………….50
Section 2 : La flexibilité du bilan……………………………………………………………….……..52
Section3 : construire l’entité actif passif……………………………………………………………..56
A. Rôle du comité actif passif………………………………………………………………..57
B. Rôle de la cellule technique……………………………………………………………………………….57
  C.Cahier de charge de la gestion financière…………………………………………………………… ..58
Conclusion de la premiére partie …………………………………………………………..……59
Deuxième partie : Cas pratique………………….………………………………60
Chapitre 1. la méthode des gaps……………………………………………………….…………64 Chapitre 2 .l’Earning at risk………………………………………………………………………65
Chapitre3 : Le Ratio de Sensibilité des taux……………………………………………………..66
Chapitre 4 : Exigences en fonds propres……………………………………………………..….67 Section 1 :Les éléments pris en compte………………………………………………………….68
Section 2 Application de la méthode de calcul……………………………………………………69
Chapitre 5 : Recommandations………………………………………………………………..….71
Conclusion…………………………………………………………………….…72
Bibliographie…………………………………………………………………… 73
Webographie………………………………………………………………… 74
Dédicaces
Je dédie ce modeste travail :
A ma très chère mère, pour sa compréhension, son amour et sa confiance
Remerciements
Mes remerciements s’adressent tout d’abord à mon encadrant au sein de la CDG Capital Mr Mohamed M’hajri pour son aide, son assistance et ses précieux conseils.
Mes remerciements s’adressent également à Monsieur Amine Filali, responsable financier au sein du département risques et ALM de la CDG Capital pour sa disponibilité et ses encouragements
Je voudrais également présenter les marques de ma reconnaissance à tous les enseignants de l’ISCAE, qui m’ont apportée leur soutien et leur aide afin que ce travail aboutisse dans les meilleures conditions.
Introduction
De plus en plus, la banque d’affaires ressemble à une « machine de risques ». Elle prend les risques, les transforme et les incorpore aux services et aux produits bancaires. Techniquement, la gestion des risques n’était pas réalisable avec l’ampleur et l’efficacité d’aujourd’hui. Les principes et les logiques n’en étaient pas universellement admis. La réglementation, en pleine transformation, ne permettait pas de savoir comment les risques seraient contrôlés par la tutelle, ni quels risques feraient l’objet des contraintes les plus strictes. Les instruments financiers, nécessaires pour moduler les risques du bilan, n’étaient pas suffisamment développés. Certains risques bancaires ne pouvaient être évalués efficacement faute d’un système d’information adapté. Aujourd’hui, tous ces obstacles sont levés ou vont l’être. Ce contexte réunit toutes les conditions pour qu’une nouvelle gestion des risques devienne une nécessite. Le développement de la gestion actif-passif s’est donc effectué parallèlement au développement des techniques de gestion des risques lorsque les banques se sont vues dans l’obligation de mettre en place de véritables outils de gestion de ces risques. En effet, de nouvelles contraintes leur ont été imposées par la pression concurrentielle et par la nouvelle réglementation prudentielle. La mise en place en 1974 du Comité de Bâle par les banques Centrales d’une dizaine de pays a permis aux banques et aux autorités de tutelle nationales de mettre au premier plan l’importance d’une gestion active des risques financiers.
Par conséquent, la gestion actif passif ou Asset Liability Management (ALM) connait un remarquable essor depuis quelques années. Initialement technique proche de l’actuariat et des pratiques d’adossement, réservée à quelques spécialistes des banques, la gestion actif passif s’impose désormais comme un cadre conceptuel de la gestion financière.
L’ALM fournit des indicateurs en termes de risque et de rentabilité attendus sur les différents produits du bilan. Cette gestion doit permettre de disposer des règles afin de limiter l’exposition du bilan de la banque au risque de taux et de gérer de façon optimale ses positions pour, finalement, mettre en place les couvertures adaptées grâce à des produits de horsbilan. Une gestion active du bilan doit assurer une visibilité suffisante sur les résultats futurs de l’établissement et sur les aléas qui les affectent. L’ALM est la plupart du temps assimilée aux techniques relatives à la gestion du risque de taux. L’objectif est en effet de maîtriser la sensibilité globale du résultat de la banque à l’évolution des taux. C’est donc un objectif de gestion du risque de taux pour préserver la marge d’intérêts dégagée par les opérations d’exploitation mais aussi d'optimiser le résultat de l’établissement. Par conséquent, la démarche ALM est une démarche d’identification, de mesure et de contrôle des risques financiers du bilan.
Après un aperçu portant sur le Groupe CDG et la CDG Capital, la première partie sera consacrée à une présentation des différents apports théoriques de l’ALM. La deuxième partie abordera une étude de cas réalisée au sein de la CDG Capital.
. En effet, comment mesurer et améliorer l’efficacité d’une machine de risques telle qu’une banque d’affaires alors que les risques sont davantage perçus comme un aléa intangible que comme un objet qui se prête à mesure et quantification ? Face à une multitude d’innovations et de techniques financières, comment mener à bien une analyse qui puisse s’adapter aux nouvelles exigences notamment Bale II ? Et enfin quel est l’impact de l’ALM sur la gestion globale des risques tout en prenant en considération les obstacles de sa mise en œuvre dans les pays du Maghreb et plus particulièrement le Maroc ?
Préambule
. La CDG Capital présente les lignes de métiers suivants :
Salle de marchés :
Elle a pour missions de :
• Exercer l’ensemble des métiers d’une salle de marchés (trading, market making, intermédiation et vente).
• Offrir une large gamme de produits de placement et d’investissement adaptée aux besoins d’une clientèle institutionnelle et corporate.
• Placer des émissions obligataires privées.
• Les activités boursières sont prises en charge par SAFABOURSE, filiale à 100 % de la CDG rattachée à la CDG Capital.
Chiffres clés
• Part de marché primaire sur le marché bons du trésor : 30 %
• Part de marché secondaire : 28%
Asset Management :
Ses principales missions :
• Gestion des portefeuilles de marchés pour compte propre. • Gestion des portefeuilles de marchés sous mandat pour compte de tiers.
• Gestion collective.
Chiffres clés ( 2007)
• Portefeuilles gérés, hors gestion collective 79 GMAD
• Portefeuilles propres(y inclus ceux de la CDG) 35 GMAD
• Portefeuilles de tiers 44 GMAD
• Gestion Collective (CD2G) 14 GMAD
Direction des Services bancaires et financiers:
Ses principales missions :
  Développer pour le compte d’une clientèle institutionnelle et corporate, de sociétés de gestion d’OPCVM, et d’émetteurs, des offres sur mesure combinant :
• Les activités de services bancaires (tenue de comptes, moyens de paiement, gestion de trésorerie, opérations de financement, etc…).
• Les activités de services financiers (custody et conservation d’actifs pour tout types d’instruments financiers,dépositaire OPCVM,centralisation des services aux émetteurs,agents financiers ,etc…).
Chiffres clés
• + de 4,5 GMAD de dépôts
• + de 135 GMAD de titres en conservation (près de 25% de part de marché) Organisation,Financements structurés et Conseil :
Elle a pour missions de :
• Conseiller une clientèle institutionnelle et corporate sur les problématiques d’investissements, de financements et de restructuration de bilan.
• Monter des émissions, des opérations de restructuration de dette ou des financements adaptés aux besoins.
• Origination : (obligataire) Développement du courant d’affaires avec Lydec, ONE, ONCF, TASLIF, SOMEPI, MAROC LEASING,…..
• Syndication : Conduite de syndicats de placements pour le compte de : ONCF, LYDEC, TASLIF, STL, ONE et SOFAC CREDIT.
• Conseil : TMSA (en collaboration avec CDC IXIS), AL MANAR DEVELOPPEMENT COMPANY, ADM, PAPELERA DE TETOUAN, CIH.
Organigramme de la CDG Capital :
d'éventualités. Ainsi Joel Bessis, définit le risque comme « l’incertitude qui pèse sur les résultats et les pertes susceptibles de survenir lorsque les évolutions de l’environnement sont adverses ».
La gestion des risques s’adresse d’abord aux risques quantifiables. Il s’agit surtout des risques financiers qui naissent des aléas des marchés financiers. Ils se concrétisent par des évolutions défavorables de la situation financière ou des résultats d’un établissement à la suite des mouvements du marché. Plusieurs risques que les banques doivent les analyser avec soin. En effet, il s’agit de :
Risque de contrepartie:
Cette catégorie comporte le risque de crédit aux particuliers et entreprises, le risque de règlement, le risque environnemental et le risque pays. Ce type de risque est d'ailleurs le plus ancien, mais il constitue aujourd'hui encore le principal risque pour les établissements de cré est relatif au non remboursement à l'échéance par un particulier, une entreprise ou un emprunteur institutionnel des intérêts et/ou du principal. Ce risque de défaut de remboursement des prêts, est enregistré dans le bilan. Mais le risque de crédit /contrepartie peut porter également sur l'incapacité d'honorer à terme un engagement de livraison de fonds, de titres, de garantie ou de caution.
Au début des années 90, la crise majeure qui a secoué l'Asie et particulièrement le Japon trouve son origine dans le risque de crédit du fait des pertes importantes sur crédits bancaires. Découlant des choix des marchés et des clients, le risque de crédit présente un aspect commercial bien qu'il ait un impact financier important. Au sens large, ce risque tient compte de la « dégradation de la situation financière d'un emprunteur, dégradation qui accroît la probabilité de défaut, même si le défaut proprement dit ne survient pas nécessairement »
Au demeurant, quelle que soit la contrepartie, le risque de crédit ou de contrepartie revêt les trois formes suivantes :
• Le risque sur l'emprunteur à travers les crédits accordés ou les placements effectués ;
• Le risque sur le prêteur eu égard aux lignes stand-by ;
• Le risque de contrepartie sur instruments dérivés.
Risque de liquidité:
Il est considéré comme un risque majeur, mais il fait l’objet de diverses acceptations :
- Une situation d’illiquidité extrême entraîne la faillite d’un établissement .En ce sens, le risque de liquidité peut être fatal. Toutefois, une telle éventualité extrême trouve son origine dans d’autres causes que la liquidité comme les pertes importantes qui résultent des défaillances des contreparties ou d’évolution des marchés, pouvant susciter des inquiétudes sur la solvabilité de l’établissement.
- Selon une autre acceptation courante du risque de liquidité, le risque est plutôt celui de disposer de liquidités bancaires insuffisantes, c’est à dire que les actifs liquides disponibles ne semblent pas suffisants pour faire face à des besoins inattendus .Dans cette optique, la liquidité est plutôt un coussin de sécurité pour gagner du temps en présence de difficultés.
- Enfin le risque de liquidité désigne l’éventualité de difficultés d’accès à des sources de fonds pour faire faire face aux besoins .La liquidité désigne dans ce cas la capacité d’un établissement à lever des capitaux à un coût « raisonnable » en permanence .
La situation de liquidité d’un établissement est caractérisée par le profil d’évolution au cours du temps de ses besoins de financements prévisionnels. Leur ampleur, leur régularité et leurs montants donnent une image globale de la situation de liquidité.
Risque de solvabilité :
L'écart entre le risque de liquidité et le risque de solvabilité est très mince. Ce dernier désigne la situation où les pertes excèdent les fonds propres. C'est donc le risque de ne pas disposer de fonds propres suffisants pour absorber des pertes éventuelles.
Risque de taux d’intérêt :
C’est le risque de voir les résultats affectés défavorablement par les mouvements des taux d’intérêts. Il est un risque essentiel pour les banques car la quasi-totalité de leurs encours du bilan engendre des revenus et des charges qui sont, à plus ou moins terme, indexés sur les taux du marché, c’est-à-dire, évoluant dans le même sens. Les taux de marché sont instables et cette instabilité se répercute sur les résultats. Le risque de taux concerne tous les intervenants, financiers ou non, dès qu’ils sont emprunteurs ou prêteurs sur les marchés. Un prêteur à taux variable court le risque de voir ses revenus diminuer si les taux baissent .Un emprunteur à taux variable court le risque de voir ses charges augmenter si les taux montent. Leurs résultats peuvent évoluer défavorablement, donc ces positions sont risquées, mais, en contrepartie, la possibilité de gains existe aussi.
Risque de change :
Le risque de change est analogue au risque de taux. C’est le risque d’observer des pertes à cause des évolutions des taux de change. L’analyse du risque de change est un domaine classique de la finance internationale, tant pour les entreprises non financières que pour les établissements financiers. Toutefois, les établissements financiers ayant des activités internationales ont à la fois des risques de taux d’intérêt, libellés dans différentes devises, et des risques de change .Les corrélations entre taux d’intérêt des différentes devises et taux de change entre couple de devises créent des interactions entre risque de taux et risque de change.
Section 2 . la nécessité de la gestion des risques
Après l’analyse des différents risques usuels que courent les banques, on peut dire que le management ou gestion du risque est « l'ensemble des outils, des techniques et des dispositifs organisationnels qui permettent de mesurer et de contrôler les risques». La réglementation prudentielle, qu'elle soit nationale ou internationale, impose aux banques et établissements financiers une meilleure gestion des risques afin de préserver la stabilité du système bancaire et financier.
En effet, « jusqu'aux années 60, aux Etats-Unis, le manque de compétition et la réglementation permettaient aux banques de gérer leur bilan suivant la règle du 3-6-3 : payer 3% pour les dépôts, consentir des prêts à 6% et partir pour le golf à 3 heures de l'après midi ». Une étude, réalisée en 2004, par la Banque des Règlements Internationaux, a prouvé que les principales causes des crises bancaires récentes dans les économies matures (pays du G10) sont à rechercher dans la mauvaise gestion du risque de crédit (85%), du risque de marché (31%) et du risque opérationnel (38%).
S'il est avéré que « le risque augmente de façon exponentielle avec le rythme de l'évolution, mais que les banquiers sont lents à corriger leur perception du risque», alors pour une banque, ne pas gérer parfaitement son risque, c'est courir également le risque de se laisser distancer, avec le temps, par la concurrence lorsque les turbulences défavorables de l'environnement se réalisent. C'est pourquoi « une gestion des risques n'a pas de sens indépendamment des performances attendues et son objectif est d'optimiser le couple risque/rentabilité » car la gestion des risques et la rentabilité vont de pair.
Par ailleurs, une saine gestion des risques permet aux banques :
De mieux comparer et contrôler entre elles des entités telles que les centres de responsabilité, les produits ou activités et les clients par intégration du risque au reporting interne des performances ;
De mieux définir leurs politiques de mobilisation de ressources ;
D'affiner leurs politiques commerciales ;
De bien élaborer les éventuelles politiques correctives. C'est par exemple le cas lorsque l'on réoriente les portefeuilles d'engagement vers les opportunités les plus rentables au regard de leur profil de risques ;
De maximiser la valeur des investissements puis celle de l'établissement et mieux rémunérer les actionnaires à travers une plus grande création de valeur.
Chapitre 2 : intérêt et démarche de l’ALM
Toute organisation (société, banque, administration, association) peut être perçue comme un portefeuille de vulnérabilités et d'opportunités combinées pour atteindre les objectifs d'une stratégie déterminée par les instances dirigeantes. En assimilant les vulnérabilités aux « risques négatifs » et les opportunités aux « risques positifs », on peut déduire que l'univers de l'organisation, et à fortiori de la banque d’affaires, est pavé de risques. Mais si le risque est inhérent à l'activité de la banque, force est de reconnaître que cette dernière ne saurait s'accommoder de risques qui mettent en jeu sa liquidité, sa solvabilité, sa rentabilité et en définitive sa pérennité. Il lui revient donc de gérer au mieux l'ensemble de ses risques et en particulier son risque négatif (downside risk), c'est-à-dire le risque de voir chuter ses résultats.
En la matière, différentes méthodes de couverture contre le risque existent. Mais ces dernières années, les entreprises et singulièrement les banques ont eu recours à l'Asset and Liability Management (ALM) ou Gestion Actif/Passif qui est un outil de gestion des risques financiers.
Section 1 : Définition de l’ALM
Définition de l’ALM
Apparue aux Etats-Unis au début des années quatre-vingt, la Gestion Actif/Passif est aujourd’hui reconnue, dans l’ensemble des établissements financiers, comme une composante indispensable pour une gestion financière permanente.
ALM ou gestion actif passif se définit comme étant :
« un ensemble des techniques et outils de gestion permettant de mesurer, suivre et contrôler les
risques financiers en les gérant d’une façon plus active ».
« La gestion actif passif ou ALM (Asset and liability management), désigne un mode degestion des affaires visant à coordonner les décisions relatives à l’actif et au passif ; il
s’agit donc d’un processus continu, impliquant la formulation, la mise en oeuvre, le
contrôle et la révision de stratégies se rapportant à l’actif et au passif dans le butd’atteindre des objectifs financiers, compte tenu d’une certaine tolérance au risque et decertaines contraintes. La gestion actif passif est cruciale pour tout établissement devant placer des capitaux pour faire face à ses engagements et désireux de garantir une gestion
financière équilibrée. »
la société des actuaires canadienne
L’ALM est donc le fruit de la gestion quantitative et planifiée des outils et dispositifs nouveaux nés de la déréglementation des activités bancaires, de la concurrence intensifiée et élargie et de la nouvelle réglementation prudentielle mise en place par les autorités de tutelle
La gestion actif passif ou Asset Liability Management (ALM) connaît un remarquable essor depuis quelques années. Initialement technique proche de l’actuariat et des pratiques d’adossement, réservée à quelques spécialistes des banques, la gestion actif passif s’impose désormais comme un cadre conceptuel de la gestion financière. Le développement de la gestion actif-passif s’est donc effectué parallèlement au développement des techniques de gestion des risques lorsque les banques se sont vues dans l’obligation de mettre en place de véritables outils de gestion de ces risques. En effet, de nouvelles contraintes leur ont été imposées par la pression concurrentielle et par la nouvelle réglementation prudentielle développée par les autorités de tutelle.
Les objectifs de l’ALM
L’ALM a pour objet de définir quantitativement les grands équilibres des bilans en fonction :
• Contraintes de financement ;
• Contraintes prudentielles ; • Limites globales des risques ;
• Objectifs de performance.
Les fonctions de la gestion des risques, englobant l’ALM plus la gestion interne, sont mises en place pour assurer une visibilité suffisante sur les résultats futurs et les aléas qui les affectent. Il s’agit d’un outil de pilotage et d’un facteur concurrentiel de première importance. Néanmoins, les visions divergent quelque peu sur le but final de la gestion actif-passif selon les auteurs.
Pour J. W. Bitner, les objectifs d’un gestionnaire actif-passif sont de :
• gérer le risque de taux pesant sur le bilan de la banque,
• gérer les besoins de liquidité relatifs à l’activité bancaire,
• préserver le capital de la banque,  
• augmenter le résultat de la banque.
Par conséquent, selon la définition et les objectifs que se donnent les responsables ALM de la banque, chacun n’aboutira pas à la même politique de risque pour celle-ci. Par exemple concernant le risque de taux, la gestion ALM doit s’efforcer d’associer des problématiques de risque et de rentabilité. En effet, l’ensemble des postes du bilan est largement influencé par les mouvements des taux d’intérêt puisque la quasi-totalité des actifs et passifs bancaires engendre des revenus ou des charges indexés sur les taux de marché. Par conséquent, l’instabilité des taux d’intérêt génère une instabilité du résultat bancaire.
Donc, que ce soit l’ALM ou la gestion des risques, les deux assurent le même objectif étant l’optimisation des risques, des performances et par conséquent son financement.
Section 2 :Les risques de liquidité et de taux en ALM :
A. Présentation :
L’ALM fournit des indicateurs en termes de risque et de rentabilité attendus sur les différents produits du bilan. Cette gestion doit permettre de disposer de règles afin de limiter l’exposition du bilan de la banque au risque de taux et de gérer de façon optimale ses actifs pour, finalement, mettre en place les couvertures adaptées grâce à des produits de hors-bilan.
Une gestion active du bilan doit assurer une visibilité suffisante sur les résultats futurs de l’établissement ainsi que sur les aléas qui les affectent. L’ALM est souvent confondue avec les techniques relatives à la gestion du risque de taux. L’objectif est en effet de maîtriser la sensibilité globale du résultat de la banque à l’évolution des taux. Par conséquent, la démarche ALM est une démarche d’identification, de mesure et de contrôle des risques financiers pouvant peser sur le bilan de la banque d’affaires.
Nous définissons ici les risques de liquidité et de taux et identifions les facteurs qui les génèrent : les mouvements de la courbe des taux et les aléas du comportement de la clientèle.
Le risque de taux d’intérêt est le risque de voir ses résultats affectés défavorablement par les mouvements de taux d’intérêt. Ce risque peut avoir diverses origines.
En ce qui concerne le risque de liquidité, on peut, conformément au document du Comité de Bâle, définir la liquidité d’une banque comme la capacité de financer ses actifs et de rembourser les engagements pris au moment où ces financements ou remboursements apparaissent.
Le risque de liquidité se traduit donc à travers l’impossibilité de satisfaire ses engagements. Il apparaît lorsque des besoins inattendus sont subis par la banque et qu’elle ne peut y faire face à partir de ses actifs liquides. Un dernier aspect du risque de liquidité peut aussi être vu à travers l’incapacité temporaire de la banque à lever des capitaux à un coût raisonnable. Il est donc nécessaire de considérer différents aspects du risque de liquidité. Ce risque peut tout en effet être fatal en cas d’illiquidité extrême puisqu’il peut alors provoquer la faillite d’un établissement. Le risque de liquidité est donc fondamental du point de vue d’une banque.
Comme le suggère la définition, une liquidité mal maîtrisée peut engendrer :
Soit une perte d’opportunité par incapacité de financement du développement de l’activité Soit une crise de liquidité par incapacité à honorer les engagements contractés.
B. Facteurs de risque de taux et de liquidité :
Le risque de taux et le risque de liquidité trouvent leur origine, d’une part, dans le caractère aléatoire des mouvements de taux d’intérêt et, d’autre part, dans celui du comportement des clients de la banque.
1.Mouvements des taux d’intérêt :
Le risque de taux est un facteur important d’instabilité du résultat d’une banque d’affaires. Par contre, l’exposition au risque de taux de la banque est une condition nécessaire à l’obtention d’un certain niveau de rentabilité. Néanmoins, une trop grande exposition aux mouvements des taux d’intérêt peut générer d’importantes pertes. Ces mouvements ont une influence sur les rémunérations et les coûts générés par les produits et instruments financiers (actifs, passifs et instruments de hors bilan) dont dispose la banque. Par conséquent, leurs mouvements ont un impact direct sur le résultat généré mais aussi sur la valeur actuelle des différents revenus futurs. Il est donc nécessaire d’appréhender correctement de quelle façon les mouvements de la courbe des taux peuvent impacter les marges de la banque.
Les trois risques les plus importants sont :
1. Le risque de translation de la courbe des taux, 2. Le risque de déformation de la courbe des taux,
3. Le risque de base.
Ces risques trouvent véritablement leur origine dans les mouvements de taux d’intérêt à travers le fait que:
Les volumes d’actifs ou passifs ayant le même taux d’indexation ne sont pas les mêmes, Les actifs et passifs ne sont pas indexés sur les mêmes taux
Le risque de translation de la courbe des taux correspond tout d’abord au risque d’une hausse ou d’une baisse générale des taux. Il apparaît lorsque actifs et passifs ne sont pas parfaitement adossés.
Exemple 1:
Les mouvements de taux d’intérêt ne sont pas toujours uniformes et il est courant d’observer des changements de pente de la courbe des taux dans le temps mais aussi une déformation de cette courbe. Ces mouvements correspondent au risque de déformation de la courbe des taux. Selon le type de placement ou d’emprunt effectué par la banque sur les marchés, les intérêts payés ou reçus pour ceux-ci n’évolueront donc pas de la même façon.
Exemple 2 :
Imaginons le cas, simpliste, d’une banque ne disposant pour ressources que des dépôts à vue des particuliers et n’accordant pour crédits que des crédits immobiliers classiques. Les dépôts à vue étant, par définition, disponibles à tout instant pour les particuliers, la banque décidera de placer ces montants à court terme. Les crédits immobiliers ont par contre une durée contractuelle la plupart du temps assez élevée, par exemple 10 ans en moyenne. Par conséquent, la banque choisira d’emprunter ces montants à long terme. Ainsi, si les taux longs augmentent tandis les taux courts baissent (ou augmentent moins fortement) la banque verra son résultat se dégrader sans qu’elle ne puisse modifier les engagements
Enfin, une corrélation imparfaite dans les taux reçus et payés par la banque sur des produits financiers ayant par ailleurs les mêmes caractéristiques de repricing génère un troisième risque relatif aux mouvements de taux d’intérêt, le risque de base. Lors de mouvements des taux d’intérêt, il peut apparaître un spread non négligeable entre les taux reçus et payés sur les différents actifs et passifs de maturités équivalentes.
Le risque de base est donc le risque qui apparaît lorsque les taux reçus ou payés par la banque ne s’ajustent pas de la même façon sur les taux de marché. Pour une même maturité, les taux d’un actif et d’un passif bancaire peuvent en effet ne pas subir des impacts de même amplitude suite à un choc sur les taux de marché puisqu’ils peuvent être indexés sur le même taux d’intérêt sans pour autant que les corrélations de ces deux taux de rémunération avec l’index de référence ne soient les mêmes.
L’importance du risque de base n’est pas la même pour chacune des banques puisqu’il est lié étroitement à la composition de son bilan.
2 . Le comportement de la clientèle :
Il existe de nombreuses options implicites dans le bilan d’une banque. En effet, la clientèle dispose par exemple de l’option de rembourser par anticipation ses crédits ou de retirer tout ou une partie des montants placés sur son compte à vue. Les mouvements de taux d’intérêt influencent très fortement l’exercice de ces options par la clientèle. Ainsi, un risque de taux relatif au comportement de la clientèle apparaît dans le bilan : c’est ce qu’on appelle risque lié aux clauses optionnelles.
Exemple 3 :
Les aléas générés par les mouvements de taux d’intérêt et par le comportement de la clientèle pouvant sembler indépendants. Ils sont en réalité liés à travers le phénomène d’optionalité présent dans le bilan de la banque. On vient de donner un exemple où le comportement des clients combiné aux mouvements de taux d’intérêt régit le phénomène d’exercice des options dont ils disposent. Par conséquent, c’est la combinaison du caractère aléatoire des mouvements de taux d’intérêt et du comportement des clients qui engendre le risque relatif aux options cachées du bilan de la banque.
Section 3 : Enjeux pour l'organisation de la banque d’affaires :
Les études et analyses n'ont d'utilité que dans la mesure où la direction générale veille à l'insertion de la réflexion ALM dans le processus de décision technique et financier de la banque d’affaires. A cet égard, des mesures d'organisation sont indispensables (mais sans être forcément suffisantes).
Dès qu'un établissement financier ou un groupe bancaire atteint une certaine taille, il est nécessaire de créer les organes de la gestion ALM:
• Le comité actif passif (qui peut également être le comité financier dans les sociétés de taille moyenne) qui réunit périodiquement les directions intéressées (technique, finances, comptabilité. . .).
• Le responsable de la gestion actif passif, nommé parmi les membres du comité, et qui peut, pour les grandes organisations, exercer sa fonction indépendamment des directions opérationnelles.
• la cellule d'études Actif -Passif, qui alimente les organes précédents en études et informations.
Cette organisation n'a rien de complexe et ne conduit pas à un bouleversement complet des structures. L'expérience prouve cependant qu'elle peut être très difficile à mettre en œuvre dans les organismes où les directions techniques et financières, admettent difficilement l'intervention de tiers dans leur domaine réservé.
Chapitre 3 : Outils et techniques en ALM
Il est d’usage de chercher à connaître l’impact du risque de taux sur :
Les méthodes utilisées sont alors des méthodes de mesure de la marge reposant sur un principe d’amortissement dans le temps de la marge de transformation. Cette marge est déterminée comme la différence entre les conditions auxquelles les crédits seraient refinancés sur les marchés et les conditions auxquelles les ressources clientèle seraient replacées sur les marchés.
La valeur de la banque, c'est-à-dire sur sa Valeur Actuelle Nette.
Les méthodes de mesure de valeurs reposent sur le principe de l’actualisation.
On calcule la Valeur Actuelle Nette des flux financiers futurs certains à laquelle s’ajoute la valorisation d’options implicites ou explicites.
Ainsi, tous les ouvrages relatifs à l’ALM envisagent comme méthode d’appréhension du risque de taux, la méthode des gaps (relative à l’analyse des marges) et la méthode de la duration (relative à l’analyse de la valeur). La plupart des auteurs expliquent clairement les limites de ces deux méthodes et formalisent diverses méthodes plus appropriées à l’évaluation d’une véritable exposition du bilan au risque de taux : ce sont les méthodes de la 2èmegénération.
Le Comité de Bâle effectue par ailleurs des recommandations en terme de gestion du risque de liquidité et du risque de taux. Nous les présentons afin de pouvoir identifier les limites de chacune des méthodes proposées dans la littérature et de définir quels objectifs doivent être atteints si l’on souhaite effectuer une gestion efficace de ces deux risques.
Section 1 : Les recommandations du Comité de Bâle :
Grâce à ses réunions régulières, le Comité effectue un certain nombre de recommandations relatives à la gestion bancaire. Libre ensuite à chacune des autorités des pays de prendre les décisions correspondant le mieux à son système bancaire. Néanmoins, le Comité encourage les pays à adopter des décisions ayant une approche standard commune.
Ces décisions couvrent un large éventail de problématiques bancaires. Le document consultatif du Comité de Bâle de juin 2004 consacre un chapitre aux “Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk” ainsi qu’un autre aux “Principles for the Assessment of Liquidity Management in Banking Organisations”. Les recommandations effectuées dans ces documents fournissent un large éventail des facteurs qui doivent être envisagés en ALM ainsi qu’une description des pratiques qui peuvent être mises en œuvre afin d’obtenir une gestion saine du risque de liquidité et du risque de taux. La plupart des méthodes concernent en réalité le risque de taux mais permettent aussi d’évaluer le risque de liquidité de la banque.
Concernant la gestion du risque de liquidité, le comité recommande de définir une politique de risques regroupant des objectifs qualitatifs et quantitatifs afin d’atteindre les objectifs de la banque du point de vue de la protection de son capital mais aussi de sa capacité à faire face aux pires événements.
Le chapitre ”Principles for the Assessment of Liquidity Management in Banking Organisations” fournit quelques indicateurs qui pourront être calculés en ALM et pour lesquels la banque devra se fixer des limites suivant ses objectifs de gestion. Parmi ces indicateurs, on trouve le ratio de liquidité
:
taux. Par ailleurs, la méthode des gaps, en dépit de sa facilité d’utilisation, est limitée puisqu’elle ne donne qu’une vision statique de l’exposition de la banque au risque de taux.
Le Comité de Bâle recommande d’effectuer à la fois des évaluations d’écoulement “statique” et aussi “dynamique”. L’estimation de l’écoulement ”statique” revient à effectuer une estimation historique de l’écoulement moyen. L’estimation de l’écoulement ”dynamique” consiste en une prise en compte et une analyse des effets optionnels et intègre les prévisions de productions nouvelles pour le produit concerné. Le Comité de Bâle recommande enfin d’évaluer le lien entre le taux des différents produits et les taux de marché afin d’évaluer des écoulements en taux.
Section 2 : L’approche statique : Volume, marge et valeur
Le chapitre “Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk” du document consultatif du comité de Bâle en juin 2004 définit 4 types de risqué de taux :
Repricing risk : Risque de translation de la courbe des taux due au décalage dans les réajustements  des prix d’actifs et des passifs surtout lorsque les échéances à taux fixes et les réajustements à taux variables ne coïncident pas dans le temps. Le tableau suivant donne une illustration :      
      Tableau 1 : Existence du risque lié au repricing
|
Actif |
Passif |
Existence du risque de taux |
Exposition |
|
Taux fixe |
Taux fixe |
Si actif et passif sont de durées différentes |
Gap de durée |
|
Taux fixe |
Taux variable |
Oui |
Totalité des encours |
|
Taux variable (*) |
Taux fixe |
Oui |
Totalité des encours |
|
Taux variable |
Taux variable |
act et pas diffé durées |
Gap de durée |
(*) En considérant à taux variable les placements à court terme à renouveler fréquemment au cours d'une année.
Yield curve risk: Risque de déformation de la courbe des taux en modifiant la courbe des taux on aura toujours une incidence sur les résultats ou la valeur des instruments financiers de la banque. Les variations négatives de la gamme des taux traduisent le risque lié à la courbe des taux. Trois facteurs peuvent être en théorie à l'origine de telles modifications : les anticipations du marché sur les taux futurs, la préférence des agents économiques pour la liquidité ou théorie de la prime de risque et enfin les tranches de maturité des actifs.
Basis risk : Risque de base qui se manifeste lorsque la banque à recours à des indices de taux ou courbes de rendement non identiques pour évaluer ses actifs et ses passifs.
Optionality: Risque lié aux options cachées telles que le remboursement anticipé.
La mesure du risque de taux d'intérêt doit comprendre toutes les sources matérielles de risque de taux d'intérêt et doit suffire à permettre l'évaluation de l'impact des taux d'intérêt aussi bien sur les profits que sur la valeur économique. Deux types d'opérations sont généralement source du risque de taux : Les opérations du portefeuille de négociation dites « marked to market » ou opérations de marché valorisées au marché et fait l’objet d’un suivi particulier, et les opérations du portefeuille bancaire.
L'ALM gère les opérations du portefeuille bancaire en distinguant trois techniques de mesure selon que l'on s'intéresse à l'incidence de la fluctuation des taux :
A- La mesure de volume :
La gestion de la liquidité consiste d’abord à déterminer les besoins de financement et à mettre en place les montants nécessaires en temps utiles, ensuite, à s’assurer que les besoins de financement sont couverts en permanence. En pratique, la projection des besoins, comme le choix des solutions de financement, dépend aussi de considérations relatives aux taux d’intérêt, aux encours existants comme aux nouveaux financements à prévoir. Elle met en jeu l’ensemble des actifs et des passifs et s’inscrit d’emblée dans la perspective d’une gestion globale du bilan, ou gestion actif –passif.
Les impasses en liquidité mesurent les décalages prévisibles, aux différentes dates futures, entre l’ensemble des emplois et des ressources. Les projections d’impasses représentent les besoins en liquidité prévisionnels et constituent un outil de gestion de base. Les impasses sont les différences entre actifs et passifs à une date donnée ou impasse en « stocks », ou les différences entre leurs variations pendant une période donnée ou impasses en « flux ». Les impasses en liquidité sont établies en projection, car l’impasse est évidemment nulle à la date courante, l’équilibre en liquidité du bilan étant nécessairement réalisé en permanence.
La gestion des impasses consiste à mettre en place progressivement les financements requis. Lorsque le temps d’écoule, les profils des ressources et des emplois existants « glissent » vers le bas et il faut rééquilibrer le bilan en permanence. Les montants de financement requis dépendent des impasses qui se creusent à chaque période et d’un éventuel coussin de sécurité que l’on souhaite maintenir. Le choix des échéances, abstraction faite du taux d’intérêt, dépend du profil de consolidation choisi.
Ce profil « cible » fixe un niveau minimal pour la dette à chaque dette future. Si l’échéancier des actifs existants est au-dessus du profil minimal de la dette, il est possible de « déconsolider » le bilan en respectant les contraintes de liquidité. Si le profil d’amortissement des actifs existants est au- dessous du profil minimal de la dette, il faut surconsolider le bilan pour respecter les contraintes de liquidité. Dans ce cas, cette sur consolidation inévitable engendre une position de taux, car des financements sont contractés « en avance » sur les productions nouvelles futures.
Structurer la dette par échéances, sur la base de considérations de liquidité seulement, consiste  donc à se rapprocher du profil objectif de la dette. Ce rapprochement s’effectue par « couches » de financements successivement mises en place au fur et à mesure que le profil d’impasses glisse au cours du temps. Il n’est donc pas évident de dire quel est le meilleur choix. Tout dépend de la forme des profils de départ. Toutefois, cette analyse est simple car elle ignore le taux d’intérêt. C’est pour cette raison qu’on va s’intéresser à une analyse considérant le taux comme le principal élément. En effet, il s’agit de la mesure du gap de taux qui procède d'une démarche en plusieurs étapes portant sur les emplois et ressources à taux variable ou à taux fixe sur une période donnée. En effet, d'abord, il faut recenser à l'actif comme au passif du bilan tous les postes à taux variable ou à taux fixe à refinancer, en prenant soin de le faire sur une même période de référence sinon la distinction fixe-variable perd son sens. Ensuite, on calcule pour chaque période le total des encours à refinancer à l'actif et au passif. Enfin, on calcule le gap de taux par différence algébrique entre les totaux à l'actif et les totaux au passif (Gap = Actif - Passif) à taux variables. Notons que l'on peut calculer le gap par différence entre passifs et actifs (Gap = Passif - Actif) à taux fixe. Si l'on dispose de taux fortement corrélés avec un même taux de référence, on peut contourner cette difficulté en regroupant les lignes du bilan en encours dont les taux sont corrélés.
      Tableau 2 : Mesure de volume : Gap entre Actif et Passif
|
Période de refinancement (en mois) |
0 à 3 |
3 à 6 |
6 à 9 |
9 à 12 |
12 à 24 |
24 à 36 |
Insensible au taux d’intérêt |
|
Actif |
|||||||
|
Réserves à la Banque Centrale |
40 |
||||||
|
Prêts Hypothécaires |
30 |
30 |
30 |
30 |
140 |
90 |
|
|
Prêts aux entreprises |
200 |
50 |
50 |
||||
|
Actifs interbancaires |
50 |
50 |
100 |
50 |
|||
|
Bonds du gouvernement |
10 |
10 |
10 |
10 |
45 |
45 |
|
|
Actifs fixes |
30 |
||||||
|
Total Actif (1) |
290 |
140 |
190 |
90 |
185 |
135 |
70 |
|
Passif |
|||||||
|
Dépôt à vue |
500 |
||||||
|
Dépôt à terme |
150 |
150 |
|||||
|
Dépôts interbancaires |
100 |
140 |
|||||
|
Dette subordonnée |
25 |
||||||
|
Fonds propres |
35 |
||||||
|
Total Passif (2) |
600 |
290 |
150 |
25 |
35 |
||
|
Gap (1-2) |
-310 |
-150 |
40 |
90 |
160 |
135 |
35 |
|
Gap Cumulé |
-310 |
-460 |
-420 |
-330 |
-170 |
-35 |
Dans notre exemple, on constate que des actifs d'un volume de 290 seront refinancés à 3 mois alors que les passifs à refinancer sur la même période s'élèvent à 600 ce qui implique un gap négatif de (290 - 600) = - 310. De même, au second trimestre par contre, le gap est de (-150) ce qui entraîne un gap cumulé négatif de (-310) + (-150) = (-460). On remarque par contre que pour les échéances de 9 à 12 mois, on a un gap positif de 90, traduisant un excédent des emplois (90) sur les ressources (0), ce qui établit le gap cumulé à (-330). De même pour les échéances de 12 à 24 mois, on a un excédent des emplois (185) sur les ressources (25) ce qui établit le gap à 160 et le gap cumulé à (-170).
Lorsqu'on a un excédent des ressources sur les emplois, la banque est dite sur-consolidée ou en position longue en taux et le gap (Emplois - Ressources) est négatif. Cet excédent de ressources doit être replacé sur le marché à un taux incertain. Si les taux baissent, c'est la rentabilité de la banque qui diminue car les ressources sont réinvesties à un taux inférieur à leur coût d'acquisition.
Inversement, quand les emplois excèdent les ressources la banque est dite sous-consolidée en taux ou en position courte et le gap (Emplois - Ressources) est positif. La banque est courte en ressources et doit se refinancer à un taux incertain. Si les taux baissent, elle se refinance à un coût inférieur aux taux client et sa rentabilité augmente de ce fait. C'est pourquoi un gap positif est favorable en situation baissière des taux pour la banque. Par contre en situation haussière des taux, ce gap positif devient défavorable. Si le gap est nul, la banque est dite consolidée en taux.
?- La mesure de marge : Sensibilité au taux d’intérêt
Elle permet d'apprécier l'incidence de l'évolution des taux d’intérêt sur la marge et donc sur les résultats d'un établissement bancaire éclairant ainsi la décision du gestionnaire de risque. C’est pour cette raison que la simple mesure du gap est insuffisante.
La sensibilité de la marge aux fluctuations des taux d'intérêt apporte donc plus de lumière à l'analyse du risk manager et l'indicateur de mesure dont il dispose est le Earnings-At-Risk (EAR) encore appelé Income-At-Stake (IAS) ou Dollar-At-Risk (DAR). Il mesure la dégradation en valeur absolue de la marge d'intérêt suite à une fluctuation des taux d'intérêt avec la formule :
EAR = |gap cumulé|.Variation des taux d'intérêt.
Il ressort de cette formule que lorsque le gap cumulé est nul, l'EAR est aussi nul. Il y a alors un adossement parfait en taux et la marge est immunisée contre les variations de taux, ce qui n’est pas le cas en réalité. L'EAR étant mathématiquement calculé en valeur absolue, il ne faut pas perdre de vue pour autant qu'un gap (Emplois - Ressources) positif est défavorable en cas de hausse des taux si bien que la marge décroît avec la hausse des taux et elle se croît avec leur baisse. Inversement, un gap négatif représente une situation préoccupante en cas de baisse des taux car la marge se détériore alors qu'elle s'améliore si les taux croissent.
C - La mesure de valeur :
La valeur se mesure par la Valeur Actuelle Nette de la banque et pourra être utilisée lorsque les dirigeants souhaitent porter leur attention sur la valeur de marché de la banque et non sur une approche relative à son résultat à court terme. En effet, la VANa comme objet de mesurer l'impact défavorable de la fluctuation des taux d'intérêt sur la valeur patrimoniale de la banque dans le cas d'une activité à taux fixe.
Une autre technique de mesure du risque de taux peut se présenter tout en supposant que les actifs et passifs sont à taux fixes. En effet, cette méthode donne à la variable temps le plus d’intérêt dans le sens où c’est le profil d’échéances qui permettra de calculer l’indice du risque de taux.
On désigne par le profil d’échéances le tableau qui classe les actifs et passifs selon la date où le taux d’intérêt est révisé. L’étape qui suit l’établissement du profil d’échéance est bien c’est le calcul de l’indice du risque de taux par le calcul, pour chaque classe d’échéance, d’une impasse qui met en évidence le défaut de concordance des échéances. Enfin, il faut signaler que la banque est dite en position courte si la variation de ses emplois est inférieure à la variation de ses ressources, et ce à taux fixe. Le ratio qui permet de déduire la position est appelé RST et se calcule comme suit :
RST = Actifs sensibles aux taux d’intérêt/Passifs sensibles aux taux d’intérêt. S’il est <1, la position est courte donc favorable en cas de hausse des taux. S’il est > 1, elle est longue donc favorable en cas de baisse des taux.
  Tableau 3 : Le profil d’échéances et les indices du risque de taux : (en millions um)
|
Date de détermination des taux : d |
Passifs à taux fixe |
Actifs à taux fixe |
Impasses |
Impasses cumulées |
Coût d’une variation de taux de 1% |
|
1 semaine |
2700 |
2200 |
-500 |
-500 |
5 |
|
8 jours ? d < 1 mois |
2400 |
2000 |
-400 |
-900 |
9 |
|
1 mois ? d < 3 mois |
1800 |
2500 |
700 |
-200 |
2 |
|
3 mois ? d < 6 mois |
1800 |
1500 |
-300 |
-500 |
5 |
|
6 mois ? d < 1 an |
2000 |
1800 |
-200 |
-700 |
7 |
|
1 an ? d < 2 ans |
1500 |
1500 |
-700 |
7 |
|
|
2 ans ? d < 5 ans |
1200 |
1000 |
-200 |
-900 |
9 |
|
Plus de 5 ans |
2000 |
1500 |
-500 |
-1400 |
14 |
|
Total |
15400 |
11000 |
-1400 |
-5800 |
58 |
Le tableau nous donne une idée claire sur la position de la banque. Position courte sur toutes les échéances à l’exception de l’échéance 1 à 3 mois car les actifs sont inférieurs aux passifs. RST à 1 mois = (2200 + 2000) / (2700 + 2400)=0,8 < 1. On conclut que la position est courte. Si les taux baissent de 1%, le coût annualisé de cette baisse est pour la banque 58 millions (um).
A l'instar des impasses en liquidité, si la mesure du risque de taux par le biais des impasses ou gaps de taux est simple dans sa conception et dans son utilisation, elle présente des limites du fait de sa nature statique et du traitement de certaines lignes du bilan et cela en réduit l'efficacité. Outre ces lignes du bilan, il y a la question des flux d'intérêt payés, versés ou réinvestis au fil du temps ou à l'intérieur des périodes. Ces flux d'intérêt ont bien entendu un effet sur la marge. A cela s'ajoute également l'énigme de l'évolution des taux d'intérêt ; il n'y a pas qu'un seul taux et tous les taux n'évoluent pas tous en même temps, dans le même sens, avec la même amplitude et ne portent pas sur la même échéance : on parle dans ce cas de risque de base. Se pose alors le problème de leur indexation à des taux de référence dont la corrélation doit être établie.
Tableau 4 : Tableau comparatif des techniques de mesure des risques financiers
|
Mesure de volume |
Mesure de marge |
Mesure de valeur |
|
|
Objet |
Mesurer l’assiette du risque. |
Mesurer l’incidence des risques financiers sur la rentabilité. |
Mesurer l’incidence des risques financiers sur la valeur patrimoniale. |
|
Avantages |
Facilité de mise en œuvre ; Outil de décision ; Facilité de compréhension. |
Proches des notions comptables ; Permet la visualisation de la chronique des flux |
Caractère synthétique, permet d’intégrer les instruments optionnels, proches des valeurs de marché et utile pour une activité à taux fixe. |
|
Inconvénients |
N’intègre pas les instruments financiers optionnels ; |
Intègre difficilement les options. |
Difficulté de mise en œuvre. |
Section 3 : L’approche dynamique : Simulations
Les outils de l’approche classique limitaient l'analyse des risques financiers aux petites variations parallèles de la courbe des taux qui n'ont d'ailleurs pratiquement que peu d'influence sur le bilan d'une banque. Il faut simuler des chocs plus importants (forte hausse ou forte baisse des taux, krach boursier, etc.). Avec les modèles de simulation, il devient possible d'examiner un ensemble de scénarios beaucoup plus vaste.
Cette approche porte le nom de stress testing (scénarios contrastés) qui intéresse énormément les autorités de tutelle des professions financières. C'est en effet la solvabilité prospective qui est importante pour assurer la survie des institutions financières.
Dans tous les cas, l'approche par scénarios contrastés apporte de précieuses informations sur les conditions limites dans lesquelles l'activité financière reste viable et/ou rentable.
En principe, les simulations permettront de définir une politique de compromis raisonnable, assurant le maintien de la solvabilité de la banque dans différents scénarios qui lui sont défavorables et qui sont des modèles déterministes conçus pour simuler l'évolution du bilan et des résultats et ce en fonction de scénarios économiques exogènes. L'objectif d'un tel exercice est de mesurer la sensibilité du produit net financier, des profits et des fonds propres aux variations. Les simulations permettent d’explorer l’influence de plusieurs sources d’incertitude sur les différents paramètres retenus comme « cibles » dans la gestion des risques. En effet, il s’agit des marges d’intérêt, des valeurs de marché, de la structure du bilan, des ratios de fonds propres, etc. Leur objectif est de déterminer quelles sont les valeurs attendues des variables « cibles » de la politique de taux et quelle est leur incertitude (leur volatilité). Cependant, il s’agit d’une méthode fiable et flexible pour explorer toutes les possibilités futures qu’il faut explorer efficacement. En effet, simuler les configurations possibles permet de mesurer l’incertitude, d’optimiser les financements et assurer leur couverture.
Les scénarios envisageables sont innombrables car de nombreuses variantes peuvent être envisagées tant pour les hypothèses économiques et financières que pour les hypothèses de production et de comportement de la clientèle.
Il faut pourtant sélectionner un nombre limité de scénarios représentatifs afin de ne pas trop se compliquer la tâche, et par suite les résultats.
Le premier scénario qui vient à l'esprit est celui de la continuité des marchés financiers conservant leur tendance sans forte variation.
A. Scénario central :
C’est le cas d’une situation «moyenne» et stable des marchés financiers. Il sert comme référence pour mesurer la variation des résultats en fonction des scénarios contrastés étudiés ultérieurement.
Il existe une approche pour bâtir un scénario central qui consiste à établir un accord entre experts sur l'évolution probable de la conjoncture. Cependant, c’est un scénario de parfaite continuité (taux inchangés, croissance moyenne de la bourse) ce qui ne relève pas de la réalité. Donc, les stress testing peuvent remédier à ce problème.
B. Scénarios contrastés (stress testing) :
En ALM, il s'agit de projeter les résultats associés à des scénarios arbitraires dont certains peuvent être particulièrement défavorables. Cette approche est d'ailleurs utilisée par les gestionnaires des risques. Il s'agit des scénarios what if dont la fonction est d'évaluer les coûts et d'imaginer les réponses à apporter pour limiter les pertes.
Les projections de taux exigent de développer un véritable modèle du bilan ayant pour objet de quantifier l’évolution des taux d’intérêt sur les résultats en 2 étapes :
• Les projections de bilan ;
• La simulation des marges ;
*Les Projections de bilans :
Dans cette étape, pour mesurer la sensibilité des résultats futurs, l’ensemble du bilan, en plus des encours existants et productions nouvelles, est pris en compte. Le total donne les bilans prévisionnels. Ces projections de bilan requièrent 3 types d’informations sur les encours : L’échéancier de l’existant, les productions nouvelles et leurs amortissements.
Les productions nouvelles résultent directement des scénarios de développement de l’établissement et des projections commerciales. Elles peuvent commencer à s’amortir dès qu’elles entrent au bilan. Des projections sont requises pour le bilan clientèle d’une part, et pour les financements d’autre part. Le premier volet permet de déterminer les positions de liquidité et de taux induites par l’activité commerciale. Le second tient compte des financements déjà en place qui tombent et doivent être renouvelées. Cela donne l’échéancier «financier ».
Tableau 5 : Projections des positions de liquidité et de taux
|
Dates |
Année 1 |
|
Bilan clientèle |
|
|
Emplois taux non indexé |
22 |
|
Emplois taux indexé |
17 |
|
Total Actif |
39 |
|
Ressources taux non indexé |
20 |
|
Ressources taux indexé |
10 |
|
Total Passif |
30 |
|
Impasses de liquidité (total Passif – total Actif) |
-9 |
|
Impasse de taux (Emplois taux indexé – Ressources taux indexé) |
7 |
|
Echéancier financier |
|
|
Emplois (variation) |
|
|
Ressources (variation) |
-3 |
|
Impasse de liquidité |
-3 |
|
Impasse de taux |
3 |
Lorsque les emplois totaux sont supérieurs aux ressources totales, c’est-à-dire en cas de déficit, les impasses en liquidité et en taux globales cumulent les impasses du bilan clientèle et celles de l’échéancier financier.
Moyennant ces conventions, les positions prévisionnelles calculées à partir des données de départ sont récapitulées au tableau suivant :
Tableau6 : Impasses prévisionnelles en liquidité et en taux
|
Dates |
Année 1 |
|
Bilan clientèle |
|
|
Impasse de liquidité |
-9 |
|
Impasse de taux |
7 |
|
Echéancier financier |
|
|
Impasse de liquidité         -3 |
|
|
Bilan global |
|
|
Impasse de liquidité |
-12 |
|
Impasse de taux après financement (Impasse de taux du bilan clientèle (avant financement) + Impasse de liquidité du bilan global) |
-5 |
L’impasse en taux du bilan clientèle est positive avant financement. Le bilan clientèle est donc exposé favorablement à une hausse des taux. Toutefois, il s’agit d’une impasse avant financement. Le résultat s’inverse après financement si aucune solution de financement n’est encore arrêtée.
La position de taux après financement est en effet de -5. Elle s’obtient en ajoutant algébriquement l’impasse en liquidité de -12 à l’impasse en taux de +7 car en l’absence de couverture, ce financement est aujourd’hui incertain.
* Les Projections des marges :
L’objectif de cette démarche est de déterminer les valeurs possibles de la marge d’intérêt et sa volatilité en fonction des taux. Chaque simulation se traduit par un profil des marges futures, des marges clientèle ou commerciales et des marges nettes des coûts de financement.
Si les marges sont utilisées comme cibles de la politique de taux, l’objectif est de contrôler le niveau et/ou la volatilité des marges. Par conséquent, il est indispensable de modéliser leur comportement quand les taux varient.
La simulation des marges exige les hypothèses sur les marges commerciales en pourcentage des encours. Ces marges sont les écarts entre taux clients et taux du marché. Elles sont incertaines à cause des aléas commerciaux et ont comme objectif d’éviter d’introduire de nouveaux aléas dans les simulations.
Les hypothèses retenues dans ce type de marges sont supposées constantes et égales à 3% pour les actifs et -3% pour les passifs.
Avec un taux de marché de 8%, le taux moyen des emplois ou les lignes d’actifs est de 11% obtenu en ajoutant à 8% les 3% de la marge commerciale des actifs.
Le coût moyen des ressources ou lignes de passif est de 5%, c’est-à-dire, 8% moins la marge commerciale 3%. En utilisant les données du tableau 6 :
Marge clientèle = (Total Actif * Lignes d’Actif) – (Total Passif*Lignes de Passif)
Marge clientèle = (39*11%) – (30*5%) = 2.79
La marge clientèle nous permet de calculer la marge après financement ou marge nette du coût de financement et ce par le biais du Tableau 7, En effet :
Marge nette du coût de financement = marge clientèle – coût des financements
Coût des financements = impasse de liquidité dans le bilan global*taux du marché
Marge nette du coût de financement = 2.79 – (12*8%) = 1.83
Après l’analyse des deux tableaux, on peut dire qu’il y a une sensibilité des marges aux variations des taux. Cette sensibilité peut s’expliquer par le fait que la valeur de la marge après variation des taux se calcule directement en multipliant les encours par les taux client avant et après la hausse des taux. Les lignes non indexées gardent les taux de 11% (actif) et de 5% (passif) avant et après la hausse des taux de 8% à 11%. Les lignes indexées passent de 11% à 14% à l’actif, et de 5% à 8% au passif, valeurs obtenues en ajoutant les marges commerciales de 3% et de -3% à la nouvelle valeur des taux 11%.Cette modification nous mène à conclure aussi que le changement du taux d’emplois indexés et des ressources indexées entraînent la modification de la marge clientèle. En effet, la marge clientèle s’élève car l’exposition du bilan clientèle est favorable à la hausse des taux.
La question qui doit se poser après l’analyse des différents scénarios est : Comment comparer les résultats obtenus entre différents scénarios?
Les modèles ont précisément pour objet de projeter les résultats comptables et financiers période par période sur une durée aussi longue que souhaitée. Il suffit donc de comparer les séquences de résultats relatives à différents scénarios, ou pour un même scénario économique, comparer les séquences de résultats relatives à différentes politiques financières par exemple.
En outre, un modèle déterministe complet permet de déceler pour chaque scénario les failles comptables ou réglementaires, telles que l'insuffisance de la marge de solvabilité ou le seuil de déclenchement de la provision pour aléas financiers. Cependant, dans certains cas il est intéressant de réduire ces séquences de résultats à un indicateur de rentabilité unique, notamment pour pouvoir classer les politiques financières entre elles.
L'allocation d'actifs est assurément le problème central de la gestion actif passif. Le stress testing apporte un éclairage particulier sur ce problème, orienté vers le contrôle des risques comptables et financiers.
Les modèles de simulation déterministes ont aussi d'autres usages en matière de tactique financière et comptable, ainsi que pour l'étude des garanties et options attribuées.
c: Les simulations et les besoins d'informations
        Tableau 7: Information de base par opération
|
Opération |
Nature du produit |
|
Encours |
Encours initial |
|
Echéancier et amortissement |
|
|
Reconduction et tirage |
|
|
Options offertes (a) |
|
|
Eventuellement : devise |
|
|
Taux |
Taux de référence |
|
Niveau du taux/marge |
|
|
Base de calcul des taux |
|
|
Echéancier de taux (b) |
|
|
Modalités d'indexation spécifiques |
|
|
Caractéristiques des instruments optionnels |
|
|
Clients |
Clients-segments de marché |
(a) Remboursement anticipé.
(b) Périodicité et dates de révisions.
Le recueil d'informations se heurte à toutes les difficultés pratiques signalées à propos des calculs d'impasses, et notamment, le problème des échéances indéterminées ou incertaines.
De nombreux produits bancaires ont des caractéristiques optionnelles comme les prêts à taux fixe remboursables, les dépôts ayant des options nécessaires comme les taux, nature de l'option. Et ces caractéristiques ne suffisent pas seules à anticiper les comportements des clients qui doivent être formulés afin de décrire les usages probables de ces options.
Pour projeter le bilan, les encours et les marges doivent être ventilés par lignes comptables. Mais, pour déterminer des positions de taux et simuler les marges d'intérêt, les encours doivent être ventilés différemment selon leurs sensibilités au taux. Cette ventilation est triple: comptable, financière et commerciale. Cette classification est retenue en raison du non croisement entre les lignes comptables financières (ALM) et commerciales (produits et marchés). Car, à une même ligne comptable correspondent plusieurs lignes ALM et vice-versa.
Les systèmes d'information sont souvent peu adaptés à une gestion détaillée du risque de taux. La comptabilité bancaire ne requiert pas toutes les informations nécessaires. Lorsque l'information existe, elle ne peut être enregistrée d'une manière suffisamment homogène pour être exploitable.
Il est impossible de revenir en arrière sur les opérations passées autrement que par des approximations. L'accessibilité de l'information diffère pour la passé, le présent et le futur. Pour le passé, c'est-à-dire les stocks existants. Seule une information partielle est disponible. Il s'agit de "moyenner" les caractéristiques des encours à partir d'hypothèses plus ou moins réalistes. Pour les productions nouvelles, il faut établir un cahier de charges détaillé recensant toutes les informations requises.
Chapitre 4 : Techniques de dédication :
Les techniques de dédication ont pour objectif de faire en sorte que les flux financiers générés par un portefeuille d'actifs obligataires permettent de faire face aux flux que fait naître un ensemble de passifs.
Deux stratégies de dédication sont présentées: le cash flow matching et l'immunisation. La technique du cash flow matching consiste à construire un portefeuille de placements obligataires qui soit annule les impasses de trésorerie soit rend les flux issus de l'actif toujours supérieurs à ceux issus du passif.
L'immunisation consiste elle à rendre l'actif et le passif de la banque aussi sensible l'un que l'autre aux variations de taux.
Section 1 Cash fIow matching :
A. Dédication d'un portefeuille d'obligations :
Le cash flow matching consiste à construire un portefeuille de placements obligataires tel que les flux futurs qu’il génère soient égaux, à chaque date, aux flux (supposés fixes) générés par les engagements de la banque vis à vis des dépositaires et des clients.
Le cash flow matching intervient sur un groupe de contrats classés par suivant leurs risques. Cette approche repose notamment sur l'idée suivante: les contrats ne sont pas tous exposés de manière identique au risque de liquidation en cas de hausse des taux.
Le principe de construction d'un portefeuille obligataire de cash flow matching est le suivant:
• choisir une obligation à taux fixe dont l'échéance coïncide avec la date la plus éloignée de sortie de fonds.
• investir dans cette obligation un montant tel que le flux généré par cette obligation à son échéance soit égal au flux généré par le passif de la banque d’affaires.
• retrancher aux autres flux résultant du passif de la banque (correspondant donc à des dates antérieures) les montants de coupons détachés par la précédente obligation.
• recommencer pour l'avant dernière date la plus éloignée de sortie de fonds, et ainsi de suite. . .
Formalisation du problème :
Les engagements de la banque donnent lieu à des sorties de fonds de montant .i_{1,……..,n}. On considère un portefeuille obligataire composé de n obligations in fine à taux fixe dont les dates de remboursement coïncident exactement avec les dates de sorties de fonds. On note .ti le flux généré par la jème obligation à la date ti. Dans la suite, représente la quantité de la jème obligation qui entrera dans la composition du portefeuille.
). En d'autres termes, on dispose de lignes
Chapitre 5: Instruments en ALM pour la couverture
Section 1 : Typologie des instruments de couverture
Les instruments financiers les plus utilisés sont ceux à terme se divisent en deux catégories : les contrats à terme et les options. Ces deux types d’instruments sont négociés :
• soit sur un marché réglementé pour lequel les autorités compétentes ont défini les conditions de fonctionnement, d'accès et d'admission aux négociations,
• soit de gré à gré, c'est-à-dire avec pour contrepartie une institution financière spécialisée.
Contrats à terme :
Une opération à terme est une opération de vente ou d'achat de titres dont l'exercice est différé dans le temps, mais dont les conditions sont fixées dès l'origine.
L'acheteur et le vendeur d'un contrat à terme déterminent à la date à laquelle le contrat est noué les conditions de l'opération qui s'effectuera à une date future précisée au contrat (la maturité). Le cours d'un contrat à terme est le prix auquel l'opération s'effectue au terme, Les flux financiers ne sont échangés qu'à la maturité. Dans un contrat à terme, on peut donc avoir une position acheteuse ou une position vendeuse.
Options :
Une option est un titre qui donne à son détenteur le droit et non l'obligation d'acheter ou de vendre une certaine quantité d’un actif financier, à une date convenue et à un prix fixé d'avance.
Une option se caractérise par:
• Sa nature: il peut s'agir d'une option d'achat (call) ou d'une option de vente (put); • L’actif sous-jacent sur lequel porte l'option: il peut s'agir d'une action, d'une obligation ;
• La quantité: il s'agit du nombre d'actifs sous-jacents à acheter ou à vendre.
• Le prix d'exercice: il s'agit du prix de la transaction (Strike) en cas d'exercice de l'option.
• L'échéance: il s'agit de la durée de vie de l'option;
• La prime ou la valeur de l'option ;
• Le mode d'exercice: on parle d'option européenne lorsque l'option ne peut être exercée qu'à l'échéance et d'option américaine lorsqu'elle peut être exercée à n'importe quelle date précédant l'échéance.
Section 2 : Couverture du risque de taux
Les instruments financiers à terme sur taux permettent de limiter la diminution de valeur du portefeuille d'obligations en cas de hausse des taux ou de limiter la diminution de revenus obligataires en cas de baisse des taux. Parmi ces instruments, on note :
Contrats à terme :
On achètera à terme si l’on anticipe une baisse des taux, à l’inverse on vendra à terme pour se prémunir contre une éventuelle hausse des taux.
Contrats de swap :
Un contrat de swap de taux d'intérêt est un contrat entre deux parties qui s'engagent à se payer l'une l'autre à des dates régulièrement espacées le différentiel de taux entre un taux variable et un taux fixe déterminé à l'origine du contrat, l’une payant le différentiel lorsqu'il est positif et l'autre le payant lorsqu’il est négatif. Un swap s'analyse comme la combinaison respectivement d'un" emprunt de taux fixe et d'un prêt à taux variable (swap emprunteur) ou d'un prêt à taux fixe et d'un emprunt à taux variable (swap prêteur). Un opérateur aura recours à un swap de taux fixe contre taux variable s'il craint une hausse des taux d'intérêt. Inversement, en cas d'anticipation de baisse des taux, il aura recours à un swap de taux variable contre taux fixe.
Caps et floors :
Un Cap est une suite d'options d'achat européennes sur taux d'intérêt. A des dates régulièrement espacées, le vendeur du cap s'engage à payer à l’acheteur la différence entre le taux variable et le taux du cap, si cette différence est positive.
Un floor est l'opération symétrique du cap dans la mesure où le flux est payé si la différence est négative. Un opérateur craignant une baisse des taux d'intérêt achètera des floors. Inversement, l'achat de caps lui permettra de se couvrir contre les conséquences d'une hausse des taux d'intérêt. .
Chapitre 6 : La Gestion Du Risque De Change
Section 1 : la mesure du risque de change
A.Les sources du risque de change
Plusieurs facteurs, généralement macroéconomiques, peuvent être à l'origine du risque de change :
• les variations des cours aussi bien sur le marché domestique qu'à l'étranger
• le volume et le sens des flux de marchandises et de capitaux dans un pays
• les évènements politiques prévisibles et imprévisibles
• les anticipations des agents et les opérations spéculatives sur les devises
Tous ces facteurs affectent les cours des devises et exposent de ce fait la banque à un risque de change lequel peut revêtir trois (3) formes : il peut s'agir d'un risque de transaction, de traduction ou de consolidation. Généralement, on parle de risque de :
- transaction, quand il y a une modification de la rentabilité des opérations libellées en devises du fait des fluctuations des taux de change
- traduction, lorsqu'il s'agit pour un établissement de convertir, par exemple en DH (ou devise d'expression), ses résultats libellés en devise (ou devise d'origine). Il s'agit dans ce cas pour l'établissement de ramener dans les comptes sociaux les résultats générés par une activité en devise.
- consolidation, lors de la consolidation des comptes d'un groupe ayant des filiales à l'étranger.
Van Greuning et Bratanovic regroupent les risques de traduction et de consolidation en risque de réévaluation ou de conversion. Ils distinguent également une autre catégorie de risque appelée risque économique ou risque d'activité qui tient compte de l'évolution adverse des taux de change sur la position concurrentielle, par exemple, d'une banque.
Les sources du risque de change étant précisées, quelles sont les techniques de mesure d'un tel risque ?
B.Les techniques de mesure du risque de change
A l'instar du risque de taux d'intérêt, l'on peut évaluer le risque de change par des mesures de volume, de marge et de valeur.
La mesure de marge
Cette mesure permet d'apprécier, à travers la marge d'intérêt, l'impact des variations adverses du risque de change sur la rentabilité de la banque. En effet lorsqu'un établissement de crédit finance une opération dans une devise A en empruntant les ressources nécessaires à cette opération dans une devise B, DUBERNET (1997) démontre que la marge réalisée (exprimée dans la devise B) par l'établissement au dénouement l'opération peut s'écrire :
mb = Rb/Mb = (Ta - Tb) + (Co/Cn - 1)(1 + Ta) où mb = marge exprimée dans la devise B ; Rb = résultat exprimé dans la devise B ;
Ta et Tb = taux d'intérêt respectifs des devises A et B ;
Co et Cn = cours d'achat respectifs au comptant et à terme de la devise B.
A l'analyse, cette formule montre que la marge réalisée est fonction et deux facteurs : le différentiel d'intérêt entre les deux devises (Ta - Tb) et la fluctuation des taux de change entre les deux devises (Co/Cn - 1)(1 + Ta).
La mesure de volume
En calculant la position de change, courte ou longue, sur chaque devise puis la position de change totale, cette mesure donne une idée sur l'assiette du risque de change de la banque comme illustré dans le tableau ci-après :
Tableau 8 : Les positions ouvertes en devises
|
Fin de mois |
USD |
GPB |
CHF |
EUR |
JPY |
Total84 |
|
Total des actifs immobilisés |
||||||
|
Total des dettes à long terme |
||||||
|
Position nette au comptant |
||||||
|
Engagement à terme décalé |
||||||
|
Filiales étrangère/opération |
||||||
|
Position nette sur produits dérivés |
||||||
|
Position nette ouverte effective après couverture |
||||||
|
Position nette ouverte maximale au cours du mois |
Les éléments listés dans ce tableau traduisent une démarche pour calculer la position nette ouverte sur les devises d'intervention d'une banque sur une période d'un mois, par exemple, en tenant compte à la fois des éléments de bilan et de hors bilan. En additionnant leurs valeurs absolues, on obtient la position nette ouverte totale.
La mesure de valeur
La prise en compte des instruments financiers de bilan et de hors bilan et le calcul de leur VAN permet d'apprécier la sensibilité de cette VAN aux fluctuations de taux de change d'une part et de taux d'intérêt d'autre part. En effet pour ces postes, des flux de capital (c'est-à-dire le principal) et d'intérêt ont toujours lieu à l'occasion des opérations sur devises. Les instruments de ce type de mesure ont été présentés au paragraphe précédent sur le risque de taux d'intérêt.
C. Fonds propres et risque de change
Tout comme le risque de taux d'intérêt, le risque de change entame les fonds propres d'un établissement bancaire. C'est pourquoi, pour être en conformité avec les exigences réglementaires en vigueur, la banque doit toujours déterminer l'exposition de ses fonds propres au risque de change dans le souci d'une meilleure gestion de ce risque. Elle peut à ce titre exprimer sa position nette ouverte globale en pourcentage de ses fonds propres éligibles et confronter ces valeurs au ratio des fonds propres en vigueur dans son environnement (exemple : 8% pour le ratio de Cooke). Des actions de redressement s'imposeront alors en cas de non respect de la norme en vigueur. La position nette ouverte globale est la plus grande valeur entre la somme des positions nettes courtes et la somme des positions nettes longues, plus la position nette (courte ou longue) en or (XAU), sans considération de signe
Section 2 : Les techniques de couverture
Pour se couvrir contre le risque de change, il convient d'annuler les positions de change (courte ou longue) dans chaque devise concernée
Elles sont sensiblement les mêmes qu'il s'agisse d'un risque de traduction ou de transaction. Au demeurant, « le premier résultat des recherches en risque de change montre qu'une diversification est profitable et qu'il ne faut couvrir que partiellement un bilan. La partie à couvrir peut l'être relativement facilement en raison du développement des produits de couverture ».
A. La couverture du risque de transaction
Elle se fait par des opérations symétriques d'achat/vente au comptant ou à terme des devises concernées. Ainsi, au comptant ou à terme on:
• Achètera la devise en défaut en cas de position courte
• Vendra la devise en cas de position longue
• Procèdera à des swaps cambistes, des swaps de change et autres options de change
• Financera par des emprunts dans la même devise, les positions de change portant sur les titres étrangers, libellés en devises, et dites positions structurelles
B/- La couverture du risque de traduction
Pour ce type de risque par contre, l'établissement fera périodiquement deux (2) types d'opérations :
• achats de devises si l'on fait des pertes en devises
• ventes de devises en cas de gains.
Il est important de signaler que, ces opérations doivent être égales en montant au résultat (gain ou perte) constitué sur la période.
Chapitre 7 : La mise en œuvre de la gestion Actif-Passif :
L’ALM comporte 2 grandes lignes de réflexion : Le contrôle des risques et la flexibilité du bilan.
Section 1 : Le contrôle des risques :
* Le plafonnement des risques :
Seuls les niveaux hiérarchiques les plus élevés peuvent apporter une réponse. Il est tout à fait souhaitable que dans chaque banque se crée un comité des risques composé de membres de la direction générale mais également du conseil d’administration afin que les actionnaires de la banque soient associés à ses analyses et décisions. En effet, le fonctionnement du comité de risques se manifeste comme suit :
- En premier lieu, le comité des risques se livre à une analyse du niveau de risque que la banque est disposée à assumer, à partir des éléments suivants :
* Les préférences des actionnaires en matière de risque ainsi que leur aptitude, en cas de survenance de pertes, à assurer le sauvetage de la banque ;
* Le montant des fonds propres ;
* Les facilités d’accès de la banque aux différents marchés de capitaux ;
* La taille car, en raison de « too big to fail », les petites banques sont plus exposées au risque que les grandes.
-Cette analyse donne lieu à la fixation de plafonds qui limitent :
* Les pertes éventuelles qu’au maximum la banque est disposée à supporter ;
* Les encours d’actifs et passifs, en fonction de leur classe de taux ou d’échéances.
*L’allocation des fonds propres
A chaque fois qu’elle augmente ses actifs à risque, la banque finance cette augmentation par des ressources supplémentaires, empruntées sur le marché interbancaire et par des fonds propres en quantité conforme aux exigences du ratio de solvabilité. Pour que l’opération soit rentable, il est nécessaire que le rendement des actifs à risque excède le coût des ressources empruntées au taux de marché interbancaire et des ressources propres pour lesquelles les actionnaires attendent une rémunération suffisante.
La marge « rendement des actifs-coût des ressources empruntées » doit assurer la rentabilité des fonds propres imposés par :
  r ? (1 – K).rf + Kpf
[ r – (1 – K).rf].(1 – t) ? Kpf
  (r – rf) ? K. (pf/1-t – rf ) *
Avec :
r : rendement des actifs à risque
rf : taux du marché interbancaire
K : ratio de solvabilité
Pf : rendement des fonds propres attendu par les actionnaires t : taux de l’IS
(r – rf) : La marge qui doit couvrir le risque pris sur le rendement incertain des actifs
Il faut également tenir compte du caractère aléatoire du rendement des actifs supplémentaires. La banque ne cherche pas simplement à maximiser le profit issu de l’augmentation des actifs mais l’espérance de ce profit.
La relation * doit être évaluée en fonction du risque des actifs incertains. C’est pour cette raison qu’une prime de risque doit être rajoutée. Cette prime de risque se calcule comme suit :
  (a / K)*Variance des actifs à risque*(1 – t)
D’où a : Coefficient d’aversion du risque, variance des actifs à risque mesure l’incertitude du rendement.
Donc, la marge (r – rf) doit couvrir à la fois le rendement des fonds propres et la prime de risque.
En général, cette marge est évaluée de 0,6% à 0,8%.
Section 2 : La flexibilité du bilan
La flexibilité d’un bilan dépend de la facilité d’accès d’une banque aux différents marchés de capitaux qui permet l’ajustement approprié et au moindre coût des actifs et passifs.
2 techniques sont tout à fait adaptées à l’objectif de diminution des actifs à risque : La titrisation et la defeasance.
La titrisation : Technique financière américaine connue sous le nom de securization et importée en France sous le nom de titrisation et s’effectue par la transformation de crédits bancaires en titres de créances négociables. La titrisation consiste, pour une banque, à céder en bloc certains de ses crédits à une entité juridique adéquate, le fonds commun de créances. En cédant ses crédits, elle cède aussi le risque qui leur est attaché.
|
Débiteurs |
|
Fonds de Placement Collectif en Titrisation    (CREDILOGI) Paiement |
|
Investisseurs |
On peut définir alors la titrisation comme étant la cession des créances, par un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, à une entité qui finance leur acquisition par une émission de parts qui sont des valeurs mobilières. Les sommes dues aux porteurs de parts sont payés par les sommes provenant du recouvrement des créances. L’entité qui acquiert les créances et émet les parts représentatives de ces créances est le fonds commun des créances.
Octroi
              prêts   Paiement des échéances
(K et intérêt)
K et intérêts   Souscription
surveille que les procédures sont suivies pour l’obtention de la notation et elle fournit les informations requises par les autorités de surveillance.
Le dépositaire :C’est une institution de crédit qui contrôle les opérations de la société de gestion.
FPCT :Est assimilables à une banque et a comme but de financer un portefeuille de crédit par l’émission de valeurs mobilières.
Le mécanisme de l’opération consiste à ce que la banque, après paiement des échéances en capital et intérêts, demande l’agrément du ministère de l’économie et des finances pour accéder au marché de capitaux par un fonds de placement désigné à cet effet. Une fois que la demande est acceptée, la banque cède les fonds de ses débiteurs à un Fond de Placement Collectif en Titrisation (FPCT) qui est dans ce cas CREDILOGI, ce dernier procède à l’émission des FPCT sur le marché de capitaux et par la suite la rencontre directe avec les investisseurs qui vont souscrire ces fonds et par là donner du cash à CREDILOGI en présence du Gestionnaire Dépositaire (Maghreb Titrisation) assurant le bon déroulement de l’opération. Les FPCT donnent le cash à la banque qui va rembourser ses débiteurs en la présence d’un établissement recouvreur pour garantir l’opération.
L’opération de titrisation n’a pas totalement porté ses fruits en matière de disponibilité des ressources à moyen et long terme, et cela résulte essentiellement de l’inexistence au Maroc d’un environnement financier favorable.
D’une part, les coûts nécessaires à la création des fonds communs de placement en titrisation sont relativement élevés, notamment au niveau des frais juridiques de constitution, des coûts d’émission des titres, et des frais de gestion.
Ces coûts dissuadent non seulement les prêteurs ayant des faibles volumes à refinancer, mais renchérissent le coût du crédit hypothécaire pour les ménages.
D’autre part, aucun système de notation n’a été mis en place pour rassurer les investisseurs sur la qualité des émissions. Enfin, la réussite de la titrisation suppose l’existence d’un marché hypothécaire primaire, ce qui n’est pas encore le cas au Maroc.
La defeasance : Traduite parfois par défaussement, la defeasance permet d’éliminer les créances comme les dettes d’un bilan en les transmettant à des tiers. Le mécanisme consiste à ce que la banque cède les créances à un trust, grande entreprise possédant des positions fortes sur plusieurs marchés proches par le rachat de plusieurs petites entreprises afin de limiter la concurrence et gagner de l’ampleur au sein d’un marché, à une valeur nominale de créances de 100 au prix du marché secondaire de ces créances 45 par exemple. Pour financer cet achat, le trust émet un emprunt de 100, souscrit par la banque : 45 sont utilisés pour acheter les créances et 55 pour souscrire des titres sans risque (bons de trésor ou emprunts d’Etat) afin de garantir le remboursement de sa dette et la rémunération des titres qu’il a émis. Le trust conserve les crédits jusqu’à leur échéance et ajuste la durée des titres sans risque à cette échéance. La defeasance permet l’allègement de l’actif en créances à haut risque surtout de celui de l’immobilier.
On peut donner comme exemple de la defeasance la plus importante en France. En effet, il s’agit de la Création d’OIG comme structure de defeasance pour le Crédit Lyonnais, en particulier pour les actifs immobiliers. Le mécanisme est que les engagements du groupe dans le secteur immobilier s’élèvent alors à une centaine de milliard de francs dont la moitié environ (48 milliards de francs) est affectée par la crise. Sur ces 48 milliards d’engagements, 8 milliards sont conservés par la banque et provisionnés à hauteur de 43%. Les 40 milliards restants sont regroupés dans une société ad hoc, l’Omnium Immobilier de gestion (OIG) chargée d’en assurer la gestion centralisée. La defeasance se fait au niveau du groupe. L’OIG se voit confier des engagements qui proviennent aussi bien de la maison-mère que des filiales du groupe. Cette defeasance s’accompagne d’une garantie sur le principal fournie par les principaux actionnaires publics de la banque plafonnée à 14,4 milliards de francs. Cette garantie dont le bilan sera dressé au bout de cinq ans couvre les risques latents appréciés en accord avec la Commission bancaire dans le cadre d’une perspective de valorisation à moyen terme du portefeuille immobilier.
Ainsi, si la banque ne compte que sur ses actionnaires pour souscrire une augmentation du capital en vue de satisfaire ses exigences en fonds propres. 2 techniques remédient à cette situation :
Les prises de participation : Permettent d’accroître les fonds propres d’une ou de plusieurs sociétés. Si on s’intéresse au 2ème cas, on peut relever le mécanisme du fait qu’une société souscrit l’augmentation de capital, qui lui est réservée, d’une banque. Et simultanément, la banque souscrit l’augmentation de capital de la société qui récupère les fonds apportés à la banque. En pratique, il n’y a pas de mouvements de numéraire entre les deux sociétés. Le seul intérêt est la facilité du respect des normes prudentielles et de diversifier l’actionnariat des banques.
L’émission des fonds propres hybrides : On désigne par fonds propres hybrides un certain nombre de valeurs mobilières intermédiaires entre les actions et les obligations. Leur émission procure à la société des ressources au remboursement indéterminé. Parmi les fonds propres hybrides, on peut citer les certificats d’investissement ou les actions sans droit de vote.
Après cette profonde analyse, on peut dire que la gestion actif-passif joue un rôle accru dans la gestion d’une banque et même si la réglementation constitue l’une de ses préoccupations majeures, elle a vocation à contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de la banque.
Section 3 :Construire l’entité actif passif :
Après avoir soulevé tous les risques d’actif passif et pris les mesures adaptées à une urgence éventuelle, on peut aborder sereinement l’organisation de la gestion actif passif au sein de la banque d’affaires.
Le premier pas est donc de créer officiellement l’entité ALM au sein de la banque d’affaires. On doit alors faire distinction entre l’organe de décision , le comité actif passif , le département d’études et la cellule technique actif passif. Et ce vu la pluridisciplinarité de la tâche de l’entité actif passif dont le rôle ne va pas se restreindre à l’un des points suivants mais de l’ensemble :
• Un équilibre comptable
• Un adossement des flux estimés traités comme s’ils étaient certains
• Un raisonnement de « gap » de trésorerie
• Un équilibre des valeurs actuelles estimées à un niveau donné.
A .Rôle du comité actif passif :
Ce comité peut soit être créé indépendamment des directions opérationnelles (technique, financière, commerciale) ou simplement identifié au comité financier.
La tâche initiale du comité actif passif est d’étudier la situation actuelle des risques de bilan et de détenir un cahier de charges de la gestion financière. Après sa fonction est de suivre l’évolution des indicateurs de risque et de veiller à l’adaptation régulière de la politique technique et financière en fonction de la conjoncture et de la réglementation. Il doit aussi avoir la responsabilité de préparer le rapport de solvabilité.
B.Rôle de la cellule technique actif passif :
Pour la cellule technique, il est préférable qu’elle ne soit pas trop réduite en effectif. Il est alors possible de regrouper dans cette cellule un certain nombre de tâches connexes aux études actif passif, telles que la réalisation des tableaux de bord techniques et financiers.
Il est souhaitable aussi de confier des missions de contrôle et d’audit à un organe indépendants des directions opérationnelles (comité d’audit, contrôleur financier, contrôleur général…) et ce afin de débusquer les risques d’actif passif non traités ou non reconnus, de veiller au respect des procédures et à l’application du cahier de charge.
C.Cahier de charges de la gestion financière :
Le cahier de charge de la gestion financière est le résultat d’une analyse approfondie de ses objectifs, de ses contraintes et de l’environnement réglementaire et comptable de l’entreprise. Pour étudier cette gestion, il faut suivre un processus hiérarchisé et guidé par les scénarios actif passif. Ce processus consiste à :
1. Identifier les objectifs et les contraintes
2. Définir la politique financière
3. Rédiger un cahier de charge de la gestion financière
?Les instruments de la gestion actif passif :
L’allocation d’actif :
Une fois connu le passif, on peut vérifier la qualité de l’allocation d’actif ou déterminer une allocation stratégique par classes d’actifs précisant en particulier : a. La part des obligations à taux fixe et leur duration
b. La part des titres à taux variable
c. La part d’actions
d. Les tolérances acceptées au titre de l’allocation tactique.
Si l’allocation d’actifs est pilotée, elle évitera de subir les mouvements de marchés et de brader les actifs, et permettra ainsi de bénéficier des opportunités en renforçant certaines positions en période de baisse des marchés.
Instruments financiers dérivés :
Les instruments financiers dérivés doivent être utilisés dans un objectif de protection de la performance. La grande volatilité des taux du marché et des marché d’actions,se protéger contre le risque de variation des taux ou contre une baisse des marchés boursiers à l’aide des instruments dérivés devient primordial.
Conclusion 1ére partie
Ce premier chapitre a été dédié à la présentation des différentes approches théoriques de l’ALM appliquées aux banques, des différents risques pris en compte par cette notion et des méthodes utilisées pour sa mise en oeuvre.
Nous avons essayé de présenter ce concept dans un cadre simpliste, et ce afin de mettre en valeur son efficacité, et sa nécessité pour le gestionnaire de risque de tout établissement financier.
Comme l'on peut s'en apercevoir au vu de ce qui précède, les techniques de mesure et de gestion des risques sont diverses. Outre les pistes qu'elles offrent au gestionnaire de risque, il est souhaitable , pour plus de commodité, que la hiérarchie bancaire à travers le Comité ALM se fixe d'autres règles de gestion des risques. En général, il s'agit de limites ou seuils d'intervention au-delà desquels la banque doit déclencher des actions de couverture de ses risques de taux d'intérêt et/ou de change. Ces seuils peuvent concerner des éléments tels que la marge d'intérêt, les fonds propres, l'assiette du risque, le volume des encours, les positions en devises ou encore les provisions stop-loss qui sont des provisions destinées à couvrir les excédents de pertes. Par exemple, une banque pourrait juger supportable toute dégradation de sa marge de transformation inférieure à 2% suite à une variation néfaste des taux d'intérêt. Rien ne sera alors initié pour couvrir son risque de taux d'intérêt. Par contre au-delà de ce seuil, elle déclenchera les mesures de couverture idoines pour ne pas détériorer davantage sa situation
NB : les chiffres présentés dans l’étude de cas sont évidemment des chiffres fictifs utilisés uniquement à titre illustratif, afin de préserver la confidentialité des comptes de la CDG Capital
Bilan Actif de la CDG Capital (en milliers de DH)
|
Désignation |
Maturités |
|||||||
|
J/J |
2 à 7J |
8 à 15J |
1 à 3M |
3 à 6M |
1 à 2A |
2 à 3A |
||
|
Opér. Trésor |
205742,4 |
866,4 |
1156 |
8667,2 |
13000,8 |
- |
- |
|
|
et Opér. avec E.C et Assimilés |
||||||||
|
Val. en Caisse |
384,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Banques Centr. TP, SCP |
101212,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Cptes Ordi des E.C et Assimilé |
144,8 |
866,4 |
1156 |
8667,2 |
13000,8 |
- |
- |
|
|
çues en Pension |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Cptes et Prêts de Trésor. |
104000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Prêts Fin. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Autres cptes débiteurs |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Imp et Créances en Souffrance |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opér. avec la Clientèle |
11141,6 |
66851,2 |
89135,2 |
119769,6 |
179654,4 |
83252,8 |
83252,8 |
|
|
Cptes Chèques et Cptes Crts Débiteurs |
784 |
4703,2 |
6271,2 |
470393,6 |
70549,6 |
- |
- |
|
|
Crdts de Trésor. |
845,6 |
5073,6 |
6764,8 |
50736 |
76103,2 |
- |
- |
|
|
Crdts à l’équip. |
364 |
2186,4 |
2914,4 |
21860 |
32790,4 |
82665,6 |
82665,6 |
|
|
Crdts à la ction |
1,6 |
7,2 |
9,6 |
72,8 |
108,8 |
421,6 |
421,6 |
|
|
Crdts Immo. |
0,8 |
6,4 |
8,8 |
68 |
101,6 |
166,4 |
166,4 |
|
|
Autres crdts |
9145,6 |
54874,4 |
73165,6 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opér. / Titres |
602,4 |
3616 |
4821,6 |
239102,4 |
300144,4 |
- |
- |
|
|
Titres de trans. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Titres de plact. |
- |
- |
- |
239102,4 |
300144,8 |
- |
- |
|
|
BT et . |
- |
- |
- |
239102,4 |
239102,4 |
- |
- |
|
|
Titres de propr. |
- |
- |
- |
- |
61042,4 |
- |
- |
|
|
Opér.diver/titres |
602,4 |
3616 |
4821,6 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opér. Diverses |
7280 |
43680 |
58240 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Val. Immo. |
3,2 |
17,6 |
23,2 |
173,6 |
260 |
864,8 |
864,8 |
|
|
Créances Subor. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
TP et Emplois Assi. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Immo. incorp. et Corp. |
3,2 |
17,6 |
23,2 |
173,6 |
260 |
864,8 |
864,8 |
|
|
Intérêts Courus à recevoir |
44,8 |
268 |
357,6 |
2680,8 |
4020,8 |
- |
- |
|
|
TOTAL |
224815,2 |
115300 |
153733,6 |
122986,88 |
497081,6 |
84117,6 |
84117,6 |
Bilan Passif(En milliers de DH)
|
Désignation |
Maturités |
||||||
|
J/J |
2 à 7J |
8 à 15J |
1 à 3M |
3 à 6M |
1 à 2A |
2 à 3A |
|
|
Opér. Trésor. et Opér. avec les E.C et Assimilés |
1084861,6 |
0,8 |
0,8 |
8,8 |
12,8 |
- |
- |
|
Banque Centrales, TP, SCP |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Cptes Ordi. des E.C. et Assimilés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Valeurs données en Pension |
746461,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Cptes et Emprunts de Trésorerie |
338400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Emprunts Financiers |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Autres comptes créditeurs |
- |
0,8 |
0,8 |
8,8 |
12,8 |
- |
- |
|
Opérations avec la Clientèle |
844 |
5065,6 |
6754,4 |
31674,4 |
65440 |
118959,2 |
389595,2 |
|
Cptes Chèques et Cptes Crts Créditeurs |
193,6 |
1161,6 |
1549,6 |
11619,2 |
17429,6 |
38959,2 |
38959,2 |
|
Comptes d’épargne |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Dépôts à Terme de la Clientèle |
- |
- |
- |
20048 |
48000 |
80000 |
- |
|
Bons de caisse |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Opérations / Titres |
21934,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Empr. Obliga. Emis |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Opér. Diverses/Titres |
21934,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Opér. Diverses |
5332 |
31992,8 |
42657,6 |
- |
- |
- |
- |
|
Provisions Risques et Charges, capitaux Propres et Assimilés |
- |
- |
- |
11990,4 |
58248,8 |
58248,8 |
58248,8 |
|
Prov. Risques et Charges |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Prov. Réglementées |
- |
- |
- |
11990,4 |
- |
- |
- |
|
Dettes subordonnées |
  - |
  - |
  - |
  - |
  - |
  - |
  - |
|
Fonds Propres |
  - |
  - |
  - |
  - |
58248,8 |
58248,8 |
58248,8 |
|
Intérêts Courus à Payer |
14,4 |
88,8 |
118,4 |
887,2 |
1330,4 |
  - |
  - |
|
TOTAL |
1112988 |
37148 |
49531,2 |
44560 |
66783,2 |
177208 |
97208 |
Hors Bilan(En milliers de DH)
|
Désignation |
Maturités |
|||||||
|
J/J |
2 à 7J |
8 à 15J |
1 à 3M |
3 à 6M |
1 à 2A |
2 à 3A |
||
|
Engagement de Fin. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Longue |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Courte |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Engagement de garantie |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Longue |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Courte |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Engagement sur titres |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Titres à recevoir |
- |
- |
- |
- |
3340,8 |
- |
- |
|
|
Titres à livrer |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Engagements sur pdts dérivés liés aux taux d’intérêt |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Longue |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Courte |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Engagements en devises |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opér. de change au Cptant |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Longue |
- |
3219,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Courte |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opér. de prêts ou d’empr. en devise |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Longue |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Courte |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opér. de change à terme |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Longue |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Courte |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Divers H. Bilan |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Position Nette par tranche |
Longue |
3219,6 |
- |
- |
3340,8 |
- |
- |
|
|
Courte |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Positions nettes Hors Bilan |
- |
3219,6 |
- |
- |
3340,8 |
- |
- |
|
GAP = Total Actif – Total Passif + Hors bilan
    Chapitre 1 : La méthode des Gaps
Le risque de liquidité représente pour un établissement financier l’éventualité de ne pas pouvoir faire face, à un instant donné, à ses engagements ou à ses échéances même par la mobilisation, c'est-à-dire la cession de ses actifs. Le risque d’illiquidité dépend d’une part de la situation propre à l’établissement, d’autre part de facteurs externes comme l’offre des marchés financiers.
La matérialisation du risque de liquidité peut en effet survenir à l’occasion :
• D’un retrait massif des dépôts à vue.
• D’une crise de confiance du marché à l’égard de l’établissement concerné.
• D’une crise de liquidité générale du marché.
Pour prévenir la CDG Capital contre ce risque nous allons procéder à la méthode de calcul des gaps.
GAP = Total Actif – Total Passif + Hors bilan
|
GAP |
-888172,8 |
81371,6 |
104202,4 |
78426,88 |
433639,2 |
-93090,4 |
-13090 |
Un GAP négatif désigne qu’il y a plus de ressources que d’emplois donc il y a autant d’argent, la banque doit les placer ce surplus à un taux incertain.
C’est le cas du très court terme, notamment le jour le jour et le cas du long terme, notamment 1 à 2 ans et 2 à 3ans. Ceci est dû pour le très court terme à l’importance des opérations réalisées avec les établissements de crédit due principalement aux valeurs données en pension qui sont des emprunts d’autres organismes financiers nationaux et internationaux et qui doivent être affectés à des crédits ou emplois spécifiques. Pour le long terme c’est l’importance des opérations avec la clientèle qui est en jeu et ceci est normal puisqu’il y avait beaucoup de comptes courants et de dépôts à terme au sein de la banque.
Un GAP positif désigne qu’il y a d’avantage d’emplois que de ressources, la banque dans ce cas a besoin de l’argent, elle peut le chercher par exemple sur le marché de capitaux des banques. Ce cas se présente dans le moyen terme qui enregistre des opérations sur titres d’un montant non négligeable provenant des bons de trésor qui ont été placé.
Chapitre 2 : Earning At Risk
|
L’analyse s’appuyant sur la méthode des Gaps paraît insuffisante du fait qu’elle ne donne pas une idée de l’impact sur les résultats de la banque. Contrairement à l’EAR
On suppose qu’il y a une translation parallèle de la courbe des taux, c’est-à-dire que les taux montent avec la même tendance pour le calcul de l’EAR en raison de la simulation de la plupart des banques internationales. Pour notre cas, on prend 50bp, 100bp, 150bp, 200bp tout en sachant que : EAR = ?GAP CUMULE? *VARIATION DE TAUX D’INTERET
Calcul de l’EAR pour 50bp, 100bp, 150bp et 200bp
D’après ces calculs, on remarque que si les taux d’intérêt montent, la marge augmentera pour une fourchette de maturités donnée. Dans le cas où le GAP est négatif, toute baisse de taux entraînera une baisse de marge car on aura plus de ressources et pour les placer il faut des taux supérieurs afin d’augmenter sa rentabilité. Dans le cas de l’EAR, puisqu‘on a la valeur absolue du GAP CUMULE, c’est bien entendu la variation des taux d’intérêt qui influence sur la marge On peut dire qu’il y a une évolution dans le même sens de l’EAR et des taux d’intérêt. En effet, on a un impact négatif sur les résultats en cas de baisse de taux et le contraire est vrai. On voit bien que l’EAR étudie bien l’impact des variations de taux d’intérêt sur la marge ou les résultats d’une banque. Donc c’est un impact assez général Chapitre 3 : Le Ratio de Sensibilité du Taux :                 68 |
La détermination de la position en calculant le Ratio de la Sensibilité du Taux d’intérêt permet de déceler la tendance qui pourra être utile à la banque pour réaliser un résultat assez confortable à :
|
Echéances |
Gap cumulé |
Passifs |
Actifs |
Coût d’une variation adverse de taux de 1% |
|
J/J |
-888172,8 |
1112988 |
224815,2 |
8881,728 |
|
2 à 7J |
-806801,2 |
37148 |
115300 |
8068,012 |
|
8 à 15J |
-702598,8 |
49531,2 |
153733,6 |
7025,988 |
|
1 à 3M |
-624171,92 |
44560 |
122986,88 |
6241,7192 |
|
3 à 6M |
-190532,72 |
66783,2 |
497081,6 |
1905,3272 |
|
1 à 2A |
-283623,12 |
177208 |
84117,6 |
2836,2312 |
|
2 à 3A |
-296713,52 |
97208 |
84117,6 |
2967,1352 |
|
TOTAL |
-3792614,08 |
1629986,4 |
1282152,48 |
37926,1408 |
Après avoir déterminé le profil d’échéances, il s’agit maintenant de déterminer la position de la banque à travers notamment le RST.
RST à 7J = (224815,2 + 115300) / (1112988 + 37148) = 340115,2 / 1150136  = 0,29
RST à 15J = (115300 + 153733,6) / (37148 + 49531,2) = 269033,6 / 86679,2 = 3,1
RST à 3M = (153733,6 + 122986,88) / (49531,2 + 44560) = 276720,48 / 94091,2 = 2,94
RST à 6M = (122986,88 + 497081,6) / (44560 + 66783,2) = 620068,48 / 111343,2 = 5,56
RST à 2A = (497081,6 + 84117,6) / (66783,2 + 177208) = 581199,2 / 243991,2 = 2,38
RST à 3A = (84117,6 + 84117,6) / (177208 + 97208) = 168235,2 / 274416 = 0,61 Position Globale = 1282152,48 / 1629986,4 = 0,78
Après le calcul du Ratio de Sensibilité au Taux d’intérêt, on remarque que la position est courte dans toutes les maturités car il est > 1, cette situation est favorable en cas de hausse des taux car dans ce cas on a des excédents de ressources qu’il faut les placer à un taux supérieur en vue d’une rentabilité importante, sauf dans le cas du très court terme et du long terme, notamment, le jour le jour, 1 à 2 ans et 2 à 3 ans car le RST < 1, cette situation est favorable en cas de baisse des taux car la banque doit emprunter à un taux inférieur pour ne pas trop perdre.
Si on compare le GAP avec le RST, on voit bien une certaine logique. En effet, chaque GAP négatif correspond à une position courte et chaque GAP positif correspond à une position longue.
La logique poursuivie dans le calcul du RST est la même dans le cas des taux fixes. Ce calcul n’est pas erroné dans le cas des taux variables. En effet, le cas où le GAP est négatif ou le RST est en position courte à taux fixe, le GAP est aussi négatif à taux variable car le GAP à taux variable est calculé en retranchant les emplois des ressources. Le raisonnement pour les taux variables est qu’il y a moins de ressources qui constituent les dépôts à vue qui ne sont pas rémunérés et qui sont favorables en cas de hausse des taux.
Chapitre 4 : Exigences en fonds propres pour la couverture du risque de taux :
La méthode consiste à mesurer le risque de taux matérialisé lors d'une modification de la gamme des taux sur les comptes pris à un instant donné c'est-à-dire sans simuler de nouvelles opérations.
Les opérations de bilan et de hors bilan sont réparties sur des échéanciers en fonction de leur durée résiduelle. A partir de ces échéanciers sont déterminés les gaps de taux sur les différentes échéances ou sur des fourchettes d'échéances (ex. : 6 à 12 mois, 12 à 24 mois ).
La méthode du Comité de Bâle raisonne sur plusieurs échéanciers qui sont fonction de la durée résiduelle des opérations. Ceci correspond à un découpage en strates selon la fourchette d'échéance des opérations.
Soumises à une transformation de la gamme des taux, les impasses en taux sont susceptibles de générer des pertes. Par exemple, une sur-consolidation en taux (excédent de ressources à taux fixe) aura pour conséquence une dégradation du résultat brut de l'établissement de 1 % de son montant moyen pour une translation de la gamme de 1 % vers le haut.
La mesure consiste à déterminer, sur chaque fourchette d'échéance, le montant de perte correspondant à l'évolution des taux qui serait défavorable. Ainsi, pour le secteur 6-12 mois, il se peut que la perte survienne si les taux augmentent (ce qui veut dire que l'établissement était surconsolidé à cette échéance). Par contre, l'établissement peut être sous-consolidé sur la fourchette 12-24 mois. La perte surviendrait alors en cas de baisse des taux. La mesure globale consistera à additionner ces deux effets. Elle surestime ainsi le risque en additionnant systématiquement les effets défavorables dus aux situations de sur et de sous-consolidations, alors qu'il est peu probable que l'évolution des taux conduise à la réalisation de ce scénario extrême. Les pertes actualisées de chaque fourchette d'échéance, traduites en termes de consommation de fonds propres, constituent la mesure globale du risque de taux. La méthode met en œuvre un mécanisme complexe de compensation entre les différentes échéances avant de déterminer une consommation globale de fonds propres.
La méthode permet de comparer cette consommation de fonds propres aux fonds propres disponibles pour couvrir le risque de taux, c'est-à-dire aux fonds propres qui n'auraient pas été consommés par la couverture des autres risques (de crédit et de marchés notamment, déterminés respectivement par le ratio de solvabilité et les ratios de couverture des risques de marché).
Section 1 :Les éléments pris en compte par la méthode :
Tous les éléments de l'actif, du passif et du hors bilan sont considérés pour la garantie de taux qu'ils apportent. Les opérations à taux fixe sont prises dans leur intégralité jusqu'à leur échéance. Celles à taux révisable sont prises pour le temps restant à courir jusqu'à la prochaine révision de taux. Celles à taux variable, qui ne comportent pas de garantie de taux, ne sont pas intégrées.
Toutes les opérations sont intégrées avec les intérêts courus non échus qui leur sont attachés.
Le Comité de Bâle préconise un suivi séparé par devise, par filiale, pour les activités de marché (trading) et pour les opérations bancaires classiques.
position dans une zone c'est-à-dire soit seulement une position courte ou seulement une position longue,alors la compensation intra-zone est nulle.
• La position résiduelle s’obtient en sommant tous les gaps pondérés d’une zone.
La compensation inter-zones adjacentes, se fait entre les zones 1 et 2 et entre les zones 2 et 3, quand il y a différence de position entre les deux zones, sinon elle est nulle.
Quand il y a différence de position entre deux zones adjacentes, alors cette compensation est égale au montant le plus petit en valeur absolue des positions résiduelles multiplié par le coefficient 40% et ce quelque soit la zone.
• La position résiduelle 2 est nulle par convention pour les deux premières zones, et est égale à la somme de toutes les positions résiduelles pour la zone3
• La compensation inter-zones 1 et 3 s’obtient en multipliant la plus petite valeur en valeur absolue si on une différence de position entre les zones 1et3 par un coefficient de 150%, la valeur à multiplier est obtenue à partir de la position résiduelle 2. Dans notre cas cette valeur est nulle car la plus petite valeur en position résiduelle 2 est égale à 0.
• La position finale est obtenue en sommant toutes les valeurs de la position résiduelle2.
Le total fonds propres qui représente l’exigence en fonds propres pour la couverture du risque de taux est obtenu en sommant les montants figurants dans la dernière ligne des colonnes de compensation intra-zone, compensation inter-zones adjacentes, compensation inter-zones 1et 3 et la position résiduelle finale, ces derniers montants sont obtenus en sommant les valeurs de chaque colonne.
Donc pour la couverture de notre risque de taux, il faut mettre en provision un montant
45.807.044 Dhs des fonds propres (1 milliard de Dhs), soit 4,58%.
Chapitre 5 : RECOMMANDATIONS :
Pour parfaire la Gestion Actif/Passif de la BOAD, il serait souhaitable :
• D'accroître l'effectif de la DGR car nous trouvons que l'ALM repose sur deux (2) personnes uniquement. Leur absence simultanée, surtout si elle est imprévue, pourrait paralyser cette division.
• D'améliorer le système d'informations pour disposer en temps réel des informations nécessaires aux simulations : courbe des taux, cours de change.
• D'améliorer l'outil de simulation de sorte à fournir des résultats comme l'incidence des risques financiers sur la valeur patrimoniale de la Banque
• De mettre en place un comité de réflexion pour la mise en oeuvre de la mesure de valeur du risque de taux d'intérêt et de faire des propositions à la haute direction de la Banque. Dans un premier temps, ce comité pourrait étudier les conditions d'établissement du bilan en valeur de marché et de proposer une méthode de calcul des VAN, duration et convexité pour que la mesure du risque soit plus précise
Conclusion
« La sagesse fixe la fortune »
Telle est la devise que l'on peut lire sur le fronton de la Banque de France. Qui mieux qu'une institution bancaire se sentirait interpellé par cette assertion, surtout lorsque « la prise de risques calculés, leur mesure et leur contrôle posent quotidiennement des problèmes délicats dans l'univers des banques»
D'après cette analyse, portant à la fois sur la familiarisation du concept de l'ALM et sa relation avec les risques bancaires ,la gestion actif-passif permet aux ´établissements financiers de préserver la marge dégagée par leurs réseaux bancaires et de lisser leurs résultats, quelles que soient les variations des taux d’intérêts.
Les objectifs de la gestion actif passif peuvent ainsi être résumés en trois types de missions : L’analyse des risques économiques (principalement les risques de marché), de choix de stratégies (couverture ou non du risque par exemple) et enfin du suivi de la mise en place de ces stratégies.
Cependant, si les banques marocaines sont d'ores et déjà dans une situation très proche des banques européennes, leur sensibilité au taux monétaire constitue pour elles une forme de risque systémique dont il est important que les banques centrales prennent conscience mais dont il est tout aussi important que les banques tentent elles-mêmes une mesure (mesures de sensibilité, calcul de l'exposition). Quel que soit l'environnement, la gestion ALM devient donc une nécessité pour appréhender ses risques financiers.
BIBLIOGRAPHIE :
• Aswath Damodaran, « Corporate Finance : Theory and Practice », 2nd Edition, Wiley, 2001, NJ, USA, p.150
• Joel bessis . « gestion des risques et gestion Actif/passif des banques », Dalloz, Paris ,1995
• Michel Diestsh et Joel Petey : « Mesure et Gestion du Risque de Crédit dans les Institutions Financières », Revue Banque Edition, Paris, 2003, p.10
• Hennie van Greuning et Sonja Brajovic Bratanovic : « Analyse et Gestion du Risque Bancaire : Un Cadre de Référence pour l'Evaluation de la Gouvernance d'Entreprise et du Risque Financier », 1ère éd., Editions ESKA, Paris, 2004, p.9
• Thèse d’un master « finance et stratégie » sciences po paris faite par Julien Vintzel
• Revue de la Stabilité Financière, N°6, Juin 2005, p.92 et 93.
• « La titrisation » N°59 de la revue d’économie financière.
• Circulaire de Bank Al Maghreb N°9/G/96 Du 29/03/96 Relative aux positions de change des établissements bancaires
• Sylvie de Coussergues : « Gestion de la Banque », 2ème édition, DUNOD, Paris, 1996, p.200 et p.216
• Crédit Lyonnais, Rapport annuel 1993, p. 39
• Pierre VERNIMMEN : « Finance d’entreprise », 6e édition, DallozSirey, 2005
WEBOGRAPHIE :
•
•
•
•
